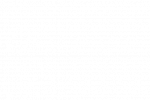Changer de stratégie sur le Karabagh

Changer de stratégie sur le Karabagh
Dans le conflit du Haut-Karabagh, l’Occident ne doit plus fonder son action politique sur le respect de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Trop de violences ont été commises contre la minorité arménienne.
A Marseille, le 24 avril, lors d'une marche commémorant le génocide de 1915, une banderole en soutien des Arméniens du Haut-Karabagh a été déployée. | BORIS HORVAT / AFP
Par Gérard Malkassian et Michel Marian
Il y a quelques semaines le conflit du Haut-Karabagh s’est réveillé, le temps de prélever en quelques jours un tribut d’une centaine de morts, principalement militaires. Puis il a disparu à nouveau de l’actualité, mais pas des préoccupations de certains analystes qui, comme Jacques Attali, y décèlent le détonateur possible d’une troisième guerre mondiale parce qu’il se superpose à la ligne de haute tension russo-turque.
Pour l’opinion internationale, c’est plutôt l’incompréhension qui domine. Comment peut-on se battre, aux portes de l’Europe et au XXIe siècle, pour une zone enclavée de 4000 km carrés ? Comment prendre au sérieux une guerre picrocholine ? Les grands principes invoqués par les belligérants, l’intégrité territoriale prônée par l’Azerbaïdjan contre l’autodétermination revendiquée par les Arméniens du Karabagh, paraissent dérisoires au regard d’un enjeu inférieur à un département français et surtout de la centaine de morts par an sur la ligne de cessez-le-feu, qui viennent s’ajouter aux 30 000 victimes de la guerre qui a suivi l’écroulement de l’Union soviétique.
Certes, la défense de l’intégrité territoriale est un outil nécessaire à la communauté internationale pour parer aux déflagrations en chaîne que peuvent produire les grands bouleversements géopolitiques. Il en fut ainsi pour la décolonisation. Il en a donc été de même lors de la chute du communisme, où la règle adoptée a été la reconnaissance de souveraineté pour les républiques « fédérées », pas pour les entités de rang inférieur, telles que la « région autonome » du Haut-Karabagh. Et l’adoption d’une règle d’autodétermination, comme la demandent les Arméniens, serait difficile à exporter à toutes les collectivités atteignant un seuil de 150 000 habitants. Voilà pourquoi, face à la demande récurrente de l’Azerbaïdjan, que l’intégrité territoriale soit reconnue comme base d’un règlement, la communauté internationale s’exécute.
Mais elle s’exécute avec réticence, sans condamner la république du Haut-Karabagh comme elle le fait pour l’Abkhazie ou l’Ossétie. La première raison de cette réticence est géopolitique : la sécession du Karabaghn’est pas le signe de l’avancée ou du retour d’un empire, la Russie ayant montré encore récemment qu’elle a des œuf, et surtout des armes, dans les deux paniers, continuant ainsi la politique de Staline qui avait rattaché la région à l’Azerbaïdjan mais en maintenant son caractère distinct. Elle ne nuit à aucun équilibre diplomatique essentiel. Voilà pourquoi un accord américano-franco-russe, vieux de deux décennies, a créé un « groupe de Minsk », sous l’égide de l’OSCE, dont l’action a été surtout de laisser le conflit pourrir sous cloche, en offrant aux Arméniens l’espoir d’une reconnaissance de facto et en tolérant des Azerbaïdjanais un discours constant de menace militaire et l’exutoire d’offensives sporadiques facilitées par leur beaucoup plus grande capacité d’achat d’armes modernes.
Après la dernière attaque de l’Azerbaïdjan, dont l’origine ne fait plus de doute, cette satisfaction commune dans l’impasse n’est plus de mise. Car une nouvelle guerre devient plus probable, à la fois du fait du déséquilibre des armements et des difficultés économiques de ce pays pétrolier, qui rendent plus tentante l’aventure militaire. Et elle serait surtout plus dangereuse, étant donné la proximité du front syrien, l’imprévisibilité d’un président turc qui a clamé, pendant les 5 jours du conflit, son soutien « jusqu’au bout « à l’Azerbaïdjan ainsi que les possibles résonances religieuses de cet affrontement ancré dans les histoires nationales.
Souffler sur des braises aussi chaudes dans le sud du Caucase devient une imprudence majeure. Le temps est sans doute venu pour les Occidentaux de changer de stratégie et, d’abord, d’accepter une nouvelle exception au principe d’intégrité territoriale. Car le Kosovo et le Sud Soudan sont devenus indépendants, malgré les règles établies. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas un point de non-retour avait été atteint du fait des exactions commises par le précédent pouvoir central, au nom du droit historique des Serbes dans un cas, de l’application de la charia dans l’autre.
La relation entre Azéris et Arméniens est de même nature : des pogroms anti-arméniens ont été, en 1988-1989, la réplique immédiate aux velléités de sécession. Ces extrémités de violence se sont prolongées jusqu’à présent : des civils arméniens ont été tués de sang-froid et mutilés lors de la dernière offensive. La seconde raison de la retenue occidentale dans la défense, en ce cas, de l’intégrité territoriale vient sans doute de là : de la certitude des horreurs auxquelles donnerait libre cours une reconquête azérie. Cette gêne est ravivée par le souvenir douloureux d’un génocide dont on a célébré le centenaire l’an dernier sans que le gouvernement turc ait fait un pas vers des excuses en cette année symbolique. Certes l’Azerbaïdjan n’est pas responsable de ce crime, mais il contribue financièrement à la propagande de négation du génocide des Arméniens, et le discours de haine raciste qu’il tient ouvertement absout le pire, pour le passé et l’avenir.
La gêne morale doit déclencher un acte positif. La reconnaissance d’une exception arménienne, et donc l’abandon du soutien à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans les déclarations internationales à venir. Ceux-ci n’impliquent pas un soutien au principe d’autodétermination, mais la nécessité d’une solution qui protège les populations arméniennes dans un territoire soustrait à la souveraineté de Bakou. De multiples formules et découpages sont possibles. À condition de préférer désamorcer un conflit vénéneux. Un accord de paix global accompagné de l’ouverture d’un tribunal qui fasse la lumière sur les crimes, d’où qu’ils viennent, commis pendant cette période, offrirait une base plus durable à cette paix.
François Hollande a déclaré à plusieurs reprises sa volonté de faire avancer la paix au Karabagh, l’Allemagne préside l’OSCE et a indiqué sa disposition à traiter le sujet : il leur appartient aujourd’hui d’engager leurs partenaires américain et russe dans une voie d’avenir, qui ne soit ni stérile ni cynique.