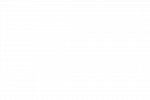Etat d’urgence : l’ère du soupçon, du flou et de l’arbitraire

Etat d’urgence : l’ère du soupçon, du flou et de l’arbitraire
Par Camille Bordenet
Depuis le 14 novembre, assignations à résidence et perquisitions peuvent être prononcées au nom de motifs très flous. Une logique dénoncée par de nombreux avocats.
Manuel Valls à l’Assemblée nationale, le 16 février, lors du vote sur la prolongation de l’état d’urgence. | ALAIN JOCARD/AFP
Trois mois déjà que l’état d’urgence est entré dans nos vies, au lendemain des attentats qui ont frappé la France le 13 novembre 2015. Trois mois que plusieurs centaines de personnes ont été perquisitionnées ou assignées à résidence, l’Etat ayant considéré, sans plus de justifications, qu’il existait « des raisons sérieuses de penser que [leur] comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ». Trois mois que la France s’est installée dans une « ère des suspects » pour reprendre l’expression du défenseur des droits, Jacques Toubon. Trois mois, encore, durant lesquels pourra perdurer ce régime du soupçon, le Parlement ayant entériné, le 16 février, une nouvelle prolongation de l’état d’urgence, jusqu’au 26 mai.
Depuis le 14 novembre 2015, quelque 400 assignations à résidence ont été prononcées et environ 281 personnes vivent toujours sous le joug de cette mesure administrative d’exception. Condamnées à être surveillées et regardées comme des suspects pour une durée indéterminée, certaines le seront donc peut-être encore jusqu’à fin mai. La menace que ces hommes et ces femmes sont censés représenter n’est pourtant que potentielle, en tout cas non prouvée. Mais sous ce régime du soupçon, le principe de précaution prévaut. Les mesures ont une « vocation préventive » – selon les mots du ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve – et visent à répondre au moindre doute sur la dangerosité. Au risque de l’arbitraire : car pour l’heure, ces milliers de perquisitions – plus de 3 300 – et ces centaines d’assignations n’ont permis d’ouvrir que cinq procédures antiterroristes.
Ces mesures exceptionnelles, le ministère de l’intérieur les justifie par une situation d’« urgence absolue ». Elles « visent à faire face à un péril grave et imminent pour l’ordre public » – comme le justifie l’Etat dans un des mémoires en défense consultés par Le Monde. Péril imminent qui, comme l’écrit le Conseil d’Etat dans une décision du 27 janvier, « n’a pas disparu compte tenu du maintien de la menace terroriste et du risque d’attentats ».
Notes blanches
« Dans un tel contexte », l’Intérieur estime ainsi – décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre 2015 à l’appui – qu’on ne peut pas « exiger de l’administration qu’elle établisse avec certitude l’existence de cette menace » : il doit être admis que ces mesures préventives, « qui ne constituent pas des sanctions », reposent seulement sur « des raisons sérieuses de penser »… Ces raisons sérieuses n’étant elles-mêmes établies que « par l’existence d’indices » ainsi que « par des notes blanches [produites par les services de renseignement, anonymes et non sourcées], et non par des faits démontrés ou encore moins par des condamnations pénales ». Dans le cadre de ce régime dérogatoire, des soupçons, à condition qu’ils soient suffisamment étayés, suffisent donc pour prendre des mesures contraignantes. Et l’administration n’a pas à démontrer la certitude du danger. L’état d’urgence n’est pas un régime de la preuve.
Pour autant, « l’administration ne s’avance pas sur du flou, assure au Monde la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur. Les raisons sérieuses doivent être étayées par des faits précis et circonstanciés. Aucune des mesures prises ne peut être fondée sur des éléments que nous ne serions pas ensuite en mesure d’assumer et d’étayer devant la personne concernée et le juge ».
C’est pourtant le « flou » et l’arbitraire dans lequel certaines de ces mesures administratives sont prises que dénoncent plusieurs avocats de personnes assignées, estimant que les craintes du ministère, aussi sérieuses soient-elles, ne sauraient l’exonérer de prouver ce qu’il avance. Ainsi, parce qu’il n’a étayé aucun des trois motifs avancés dans l’arrêté et la note blanche pour justifier l’assignation à résidence d’Halim Abdelmalek, 35 ans, gérant de société, le ministère de l’intérieur a été renvoyé dans les cordes par le Conseil d’Etat, qui a suspendu la mesure – une première depuis le début de l’état d’urgence. Plusieurs tribunaux administratifs ont eux aussi décidé de suspendre ou d’annuler des assignations pour les mêmes raisons – en tout,douze d’entre elles ont ainsi été remises en cause par la justice administrative depuis le 14 novembre.
Dossiers complexes
« L’état d’urgence est devenu l’ère du soupçon et les notes blanches, les reines de la preuve. Preuve que fabrique le ministère de l’intérieur à défaut de pouvoir la produire », dénonce Me Bourdon, qui a défendu Halim Abdelmalek.
« D’un petit élément, d’un soupçon, le ministère de l’intérieur fait des extrapolations qui relèvent du mensonge, affirme un autre avocat, Me Alimi, qui défend plusieurs assignés. C’est toujours la même méthode : il avance des choses dans une forme de prédiction, après il essaie de les établir avec une perquisition, et quand il ne trouve rien, il tente néanmoins d’obtenir le maintien de l’assignation devant le tribunal administratif avec des notes blanches. »
A ces accusations, le ministère de l’intérieur répond souvent par le secret-défense et la nécessaire protection des sources. « L’administration de la preuve est rendue plus difficile par les contraintes propres au travail des services de renseignement, qui doivent s’abstenir de révéler des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou qui pourraient compromettre une enquête en cours », écrit-il ainsi dans l’un de ses mémoires.
Sans nier certaines dérives et bavures, on ne saurait accuser l’Intérieur d’être à chaque fois dans l’exagération. Car certains dossiers, complexes, laissent persister le doute pour tous leurs acteurs – avocats et journalistes compris – et sont symptomatiques de la difficulté à établir s’il existe vraiment des « raisons sérieuses de penser » qu’un individu est menaçant. « C’est rare, mais il existe quelquefois des dossiers tangents », concède Me Alimi, qui rappelle cependant que l’appréciation de la dangerosité d’un individu est un concept « infiniment subjectif ».
L’art de la dissimulation
Le cas de S., assigné à résidence depuis novembre et dont le tribunal administratif, puis le Conseil d’Etat, ont rejeté le recours, illustre bien cette difficulté. Pour justifier son assignation, le ministère fait valoir que S., « ancien militaire entraîné notamment à l’usage des armes », serait un « islamiste radical favorable au djihad et susceptible de vouloir se rendre en Syrie pour rejoindre un groupe de combattants ». Le groupe de combattants en question serait composé de deux personnes connues des renseignements « pour leur implication dans les filières djihadistes à destination de la Syrie » ; l’un a été « mis en examen à la suite de son séjour en Syrie au sein de l’Etat islamique », l’autre est parti rejoindre les rangs de l’organisation terroriste, précise la note blanche.
Dans le cas de S., il semble donc que ce soient ses fréquentations, plus que son comportement, qui inquiètent le ministère. A travers ce cas, la question se pose donc de savoir si un individu, parce que certaines de ses connaissances sont parties faire le djihad, doit lui-même être considéré comme soutenant le djihad et susceptible de partir le faire. « Je ne suis pas responsable des choix de mes connaissances. Ce n’est pas parce que certaines décident de se rendre en Syrie que je vais faire pareil », fait valoir au Monde l’intéressé, qui assure n’avoir jamais nourri le projet de partir. « Connaître une personne ne signifie pas adhérer à ses idées, loin s’en faut », souligne aussi Me Alimi, son avocat. Et S. de mettre en avant le quotidien des plus « banals » de sa famille, loin d’agir comme si elle préparait un départ.
Mais justement, la banalité ne suffit pas, ou plus, à lever les soupçons du ministère : et si l’islamiste soupçonné pratiquait la taqiya, cet art de la dissimulation prôné par certains mouvements radicaux, pour se fondre dans la population en pays laïque ? Dans deux de ses mémoires en défense consultés par Le Monde, l’Intérieur fait ainsi valoir qu’il ne faut pas négliger « les techniques de dissimulation, librement accessibles sur Internet, des personnes surveillées ». « Les intéressés sont incités à adopter un comportement neutre, voire à donner des gages de ce qu’ils sont particulièrement bien intégrés, pour ne pas éveiller les soupçons », est-il aussi souligné. Ces techniques de dissimulation sont, selon la DLPAJ, « un phénomène assez généralisé ».
Logique discriminatoire
Dans le cas de S., l’Intérieur fournit même, dans son mémoire en défense, un article de la revue francophone de l’organisation Etat islamique, Dar Al-Islam, titré « Les règles de sécurité du musulman ». Et écrit : « La menace à l’ordre public peut être constituée alors même que l’intéressé a des activités dormantes ou souterraines – dans le cas du terrorisme –, n’a jamais été condamné et présente toutes les apparences de la normalité. »
« D’apparence normale », S. aurait donc possiblement des « activités dormantes ». Ces insinuations laissent perplexes. « Le ministère de l’intérieur a développé un sophisme consistant à dire que les musulmans “radicaux” font œuvre de dissimulation, S. nie les allégations, donc il est dans la dissimulation », dénonce Me Alimi. L’avocat estime qu’il y a « un vrai développement d’une rhétorique raciste consistant à dire que tout musulman, même lorsqu’il présente les apparences de la normalité, peut être a priori un terroriste potentiel ».
Cette logique du soupçon en vient à placer avocats et journalistes dans des positions inconfortables, les conduisant quelquefois à préjuger des apparences : est-ce qu’on peut estimer que tel individu « a l’air » radical parce que sa barbe est longue, qu’il porte le qamis et sa femme le hidjab ? Parce qu’il fréquente telle mosquée réputée salafiste ou connaît tel imam fondamentaliste ? Une logique discriminatoire qui, par extension, pousse à distinguer le « bon » du « mauvais » musulman.
Reste que le ministère de l’intérieur n’échappe pas, lui non plus, au doute. « On s’interroge toujours sur la nécessité d’abroger des arrêtés d’assignation, il y a des cas où on campe sur deux positions, expliquait l’une de ses représentantes lors d’une audience devant le Conseil d’Etat, en janvier. Et parfois, quand on envisage d’abroger, ce sont les renseignements qui préconisent de ne pas le faire. »
Au 12 février, le ministère a déjà abrogé de lui-même 50 arrêtés d’assignation, estimant, « à la réflexion et au vu des éléments nouveaux », que les mesures n’étaient pas justifiées. Un mouvement qui devrait se poursuivre puisque, dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 26 mai, le ministère de l’intérieur s’apprête à réexaminer les quelque 281 assignations encore en vigueur et donc à en lever un certain nombre pour « recentrer ». Autant de dossiers pour lesquels le ministère reconnaîtra ainsi, en creux, son erreur d’appréciation et le fait que la menace que ces individus étaient censés représenter était peut-être inexistante, ou à tout le moins insuffisamment prouvée. Autant de cas qui démontreront les limites, en termes d’efficacité contre la menace terroriste, de ce régime du soupçon.