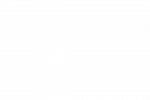Europe : vaincre la tyrannie de la peur
Europe : vaincre la tyrannie de la peur
Par Marie Charrel
Comment et pourquoi le rêve européen a-t-il viré au cauchemar ? En attendant les Hannah Arendt de demain qui nous en feront comprendre les raisons, il convient de ne pas céder à la peur de l’autre, du réfugié, du futur.
Norbert Hofer (à droite), le candidat du FPÖ arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle autrichienne, le 24 avril. | ROBERT JAEGER / AFP
Il y a quelque chose de pourri en Europe. Un vent fétide. Un souffle de mauvais augure. Dimanche 24 avril, l’extrême droite du FPÖ est arrivée en tête au premier tour de l’élection présidentielle autrichienne, avec 36,4 % des suffrages. Le mouvement n’avait pas enregistré un tel score depuis la seconde guerre mondiale. L’humiliation des partis traditionnels est totale. Norbert Hofer, le candidat du FPÖ, offre le visage amical d’une extrême droite décomplexée sur la forme. Sur le fond, elle reste âprement xénophobe, islamophobe, eurosceptique.
En Slovaquie, le leader néonazi Marian Kotleba, gouverneur de la région Banska Bystrica, renforce son influence jour après jour. Le 5 mars, son parti, Notre Slovaquie, est entré pour la première fois au Parlement, avec 14 députés. Dans son fief, Kotleba organise des milices de « défense locale » contre les Roms et malmène les artistes. Il considère ces derniers comme un ramassis de « décadents ».
Partout, en Europe centrale et orientale, les gouvernements se crispent sur la question des migrants. En Hongrie, le controversé leader nationaliste Viktor Orban résume sa politique en deux mots : « zéro réfugié ». Son pays refuse d’appliquer le programme de répartition de 120 000 réfugiés voté à la majorité par les chefs d’Etat européens, le 22 septembre 2015.
Pendant ce temps, des milliers de Syriens s’entassent dans des camps le long de la frontière gréco-macédonienne ou sur les îles hellènes. Ils y survivent dans des conditions sanitaires effroyables, indignes de l’Union européenne (UE), dont l’ambition politique originelle était pourtant d’incarner l’avant-garde en matière de droits de l’homme.
Même les europhiles convaincus vacillent
Jamais, depuis sa naissance, l’UE n’a été aussi violemment tiraillée par des forces centrifuges. Elle ne fait plus rêver. A la crise des réfugiés et la montée des populismes s’ajoutent la crainte du terrorisme, les séquelles de la crise de 2008, le dossier grec et la tentation de la sortie. Le 23 juin, le Royaume-Uni déterminera par référendum s’il veut rompre avec Bruxelles. Les eurosceptiques danois et néerlandais rêvent de lancer une initiative similaire dans leur pays. La monnaie unique, autrefois synonyme de prospérité, fait désormais figure de repoussoir…
Même les europhiles convaincus vacillent. Mario Monti, président du conseil italien entre 2011 et 2013 et ancien commissaire européen au marché intérieur, a ainsi confié son inquiétude au site d’information Politico, le 24 avril. Pour la première fois, il redoute sérieusement que l’Union européenne ne marche droit vers sa désintégration.
Que nous arrive-t-il ? Comment et pourquoi le rêve européen a-t-il viré au cauchemar ? Quelle est la mécanique des courants qui sapent ses fondations ? Pour le comprendre, il convient d’abord d’éviter deux écueils. Le premier serait de céder aux sirènes des Cassandre. Quand tout va mal, rien n’est plus facile que prédire le pire. Le réflexe n’est pas nouveau. Sur le Vieux Continent, les déclinologues nihilistes ont toujours semblé plus crédibles et moins suspects que les optimistes lénifiants. Pourtant, rien ne fait moins avancer le débat que les professeurs de désespoir. Ils ne proposent rien, à l’exception de leur fascination pour le néant.
Le second écueil serait de se tourner exclusivement vers le passé pour comprendre le présent. Certes, il est tentant de comparer la crise de 2008 à celle des années 1930. De rapprocher la montée des populismes d’aujourd’hui à celle des ligues d’extrême droite de l’époque. Et d’en conclure que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous courons à la catastrophe. Sophisme !
« Ramener quelque chose d’inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l’esprit, et procure en outre un sentiment de puissance », prévenait Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles. Expliquer le présent en se référant aux causes du passé est la meilleure façon de passer à côté des faits nouveaux. De s’enfermer dans le fantasme au lieu d’appréhender la réalité. Le fourvoiement – pour ne pas dire la bêtise – est alors assuré.
Une pensée nouvelle ne naîtra pas tout de suite
Non, l’Europe d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec celle des années 1930. Le souligner n’est pas minimiser le danger, ni nier la résurgence des vieux réflexes nationalistes. C’est un prérequis indispensable à l’émergence d’une pensée nouvelle. Mais celle-ci ne naîtra pas tout de suite.
Après tout, il a fallu du temps aux historiens et politologues du XXe siècle pour comprendre comment l’Europe a pu sombrer dans la folie meurtrière de la seconde guerre mondiale. Les Origines du totalitarisme, l’ouvrage fondateur d’Hannah Arendt, fut publié en 1951 aux Etats-Unis, et vingt ans plus tard seulement en France. La philosophe allemande y explique comment les régimes d’Hitler et de Staline, inédits, sont nés de la décomposition des sociétés de classes, ravagées par la crise, en sociétés de masses déstructurées, faites d’individus isolés et furieux. Qui seront séduits par l’idéologie totalitaire.
En attendant les Hannah Arendt de demain, il convient de ne pas céder à la tyrannie de la peur. Celle de l’autre, du réfugié, du futur. Du côté des peuples, elle nourrit les instincts grégaires et acrimonieux. Du côté des élites, elle pousse à la lâcheté et sème les graines de la discorde. Tout en faisant le lit des populismes et du repli sur soi.
Vaincre la tyrannie de la peur : voilà ce à quoi nous, citoyens, dirigeants, salariés, artistes, chercheurs, devons œuvrer aujourd’hui. La tâche est sisyphéenne. Elle appelle la modestie et la lucidité. Elle exige un combat permanent contre la condescendance et le nihilisme. Le chemin sera semé de pièges. Le retour en arrière est pourtant à proscrire. Il faut imaginer Sisyphe heureux…