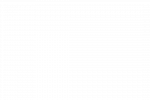Le Conseil d’Etat plaide pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte
Le Conseil d’Etat plaide pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte
Par Emeline Cazi, Jean-Baptiste Jacquin
Une étude remise au premier ministre préconise de mettre ces vigies civiques sous l’aile du Défenseur des droits.
Le scandale des « Panama papers », l’affaire du Mediator comme le démarchage illégal des fortunes françaises par UBS ou les privilèges fiscaux accordés par le Luxembourg à certaines grandes entreprises n’auraient jamais éclaté au grand jour si une personne isolée n’avait décidé de tirer le signal d’alarme. Au risque de compromettre sa carrière professionnelle. Certains de ces lanceurs d’alerte se retrouvent en effet poursuivis en justice par leurs anciens employeurs. Une étude réalisée par le Conseil d’Etat à la demande du premier ministre et rendue publique mercredi 13 avril recommande que la France se dote de meilleurs outils pour assurer une efficacité aux alertes lancées, un encadrement pour éviter les abus et délations malveillantes et une réelle protection de ces vigies civiques.
Malgré six lois en neuf ans qui ont cherché à les protéger à des degrés divers, on est loin du compte. « Il en résulte un manque de cohérence, des lacunes en matière de procédure et, au final, peu de protection effective des lanceurs d’alerte », constate Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d’Etat.
Définir un socle commun
Les lois ont en particulier omis, à l’exception de celle sur le renseignement de 2015, la question du secret professionnel. Or, le viol de ce secret (médical, fiscal, lié à la défense nationale, etc.) est pénalement répréhensible dans de nombreux domaines. « Si la loi ne précise pas les dérogations au secret professionnel, il n’y aura pas de lanceurs d’alerte », prévient M. Sauvé. C’est donc par des lois sectorielles que le législateur devrait définir, secret par secret, quelles sont les exceptions ou, à défaut, les personnes habilitées à recevoir une alerte sans lever le secret professionnel.
Mais auparavant, c’est bien la définition d’un socle commun par la loi qui figure au premier rang des quinze propositions approuvées par l’assemblée générale du Conseil d’Etat. Le groupe de travail qui a réalisé cette étude a d’abord tenu à s’entendre sur une définition précise du lanceur d’alerte. C’est « un acteur civique qui signale, de bonne foi, librement et dans l’intérêt général, des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant des intérêts publics ou privés, dont il n’est pas l’auteur ». Il peut être salarié, collaborateur occasionnel ou extérieur. Une définition qui a ainsi conduit à rejeter fermement, à une voix discordante près, l’idée de rémunération des lanceurs d’alerte. « On ne fait pas un geste civique pour de l’argent », tranche M. Sauvé. D’ailleurs, le groupe de travail, présidé par Emmanuelle Prada Bordenave et auquel ont participé des représentants d’associations comme Transparency International ou la fondation Sciences citoyennes, parle d’« alerte éthique ». S’inspirant de ce qui a été mis en place au Royaume-Uni et en Irlande, il préconise des mécanismes pour favoriser en priorité l’alerte interne à l’administration ou à l’entreprise concernée.
Le Conseil d’Etat estime que le canal hiérarchique ou un canal interne spécifique (déontologue, service d’inspection…) sont les mieux à même pour prendre en compte rapidement et efficacement une alerte émanant d’un collaborateur. A condition que le dénonciateur soit protégé (comme la personne éventuellement visée tant que les faits ne sont pas établis) et averti des suites données à son information. Cette solution interne ne semble pas adaptée aux cas où la fraude est organisée en système, comme dans l’affaire des prothèses mammaires de la société PIP ou dans celle des logiciels antipollution truqués chez Volkswagen.
Un portail unique
« Si et seulement si un tel recours [interne] se heurte à l’absence de réponse apportée dans un délai raisonnable ou s’avère impraticable, un canal externe pourra alors être choisi », note le rapport. Mais pour le Conseil d’Etat, il ne s’agit pas ici de divulguer des informations aux médias ni au public qui ne peuvent être alertés « qu’en dernier recours ». « L’alerte externe » est destinée aux autorités administratives compétentes (Agence du médicament, Autorité des marchés financiers, future Agence de prévention et de détection de la corruption prévue dans le projet de loi Sapin II, etc.), aux ordres professionnels ou à la justice. Il est proposé, pour faciliter l’accès à l’institution compétente, de passer par un portail unique qui serait assuré par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement prévue par la loi Blandin de 2013 (et toujours pas installée !).
Pour mieux protéger les lanceurs d’alerte contre les velléités de représailles, le Conseil d’Etat propose de lister très largement ce que ces dernières pourraient être, comme le non-renouvellement d’un CDD, espérant ainsi les bannir. Surtout, il propose d’étendre la compétence du Défenseur des droits, qui pourrait être saisi par les personnes concernées sans attendre l’issue des procédures judiciaires.
Quelques-unes des propositions de cette étude pourraient être déjà intégrées dans le projet de loi Sapin II sur la corruption qui viendra en discussion à l’Assemblée nationale d’ici à l’été. Mais d’autres lois seront nécessaires. Le développement d’une culture de l’alerte en France reste un travail de longue haleine.