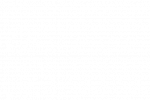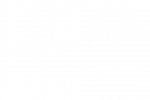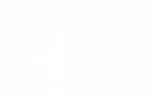Rwanda : au tribunal, les bourgmestres font profil bas
Rwanda : au tribunal, les bourgmestres font profil bas
Par Christophe Châtelot
Tito Barahira et Octavien Ngenzi, jugés à Paris pour génocide dans la ville de Kabarondo, minimisent leur rôle.
C’est souvent le cas dans les procès en assises, même s’ils traitent, comme c’est le cas depuis le mardi 10 mai à Paris, d’un sujet aussi exceptionnel que le génocide de 1994 au Rwanda. Lors de ces toutes premières journées consacrées à l’étude de leur personnalité et qui balaient en accéléré l’ensemble de leur vie, les accusés cherchent à apparaître sous leur meilleur profil avant que l’examen des faits et la succession des témoins à la barre ne nuancent le tableau.
Exposé durant deux jours au palais de justice de Paris, ce concentré de la vie de Tito Barahira (64 ans) et d’Octavien Ngenzi (58 ans), deux Rwandais poursuivis pour génocide et crimes contre l’humanité, n’a donc qu’effleuré le cœur du dossier : le massacre de milliers de personnes à Kabarondo, petite ville de l’Est rwandais proche de la Tanzanie, aux premiers jours du tsunami de sang et de larmes qui, d’avril à juillet 1994, allait engloutir ce pays de la région des Grands Lacs d’Afrique australe. Trois mois de folie meurtrière planifiée par des extrémistes hutu au cours desquels 800 000 Rwandais, des Tutsi pour la plupart, furent impitoyablement massacrés.
Tito Barahira et Octavien Ngenzi ont un point commun. Ils furent, successivement de 1977 à 1994, bourgmestres, terme hérité de l’époque coloniale belge, de Kabarondo. Une petite ville d’agriculteurs où tout le monde connaît, bien entendu, les deux hommes qui occupèrent la même fonction, non élective, mais attribuée à l’époque par décret présidentiel sur proposition du ministre de l’intérieur.
Massacres systématiques
Cette précision est fondamentale. A la faveur de quelques questions aux accusés, le procureur général Philippe Courroye ainsi que les avocats des parties civiles ont déjà montré qu’elle constituera l’un de leurs angles d’attaque. « Les préfets et les maires étaient des relais essentiels de l’Etat dans la mise en œuvre du génocide », est venu expliquer à la barre Stéphane Audoin-Rouzeau, chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Octavien Ngenzi, ingénieur agronome de formation, dirigeait la ville au moment des faits qui leur sont reprochés. Tito Barahira travaillait alors à la division locale d’Electrogaz, la société nationale d’électricité, mais avait, laisse entendre Philippe Courroye, conservé « prestige et autorité » sur ses anciens administrés. Selon l’acte d’accusation, des témoins directs viendront dire à la barre l’avoir vu organiser et participer à la tuerie dans l’église de Kabarondo où des milliers de Tutsi – sans distinction d’âge ni de sexe –, qui croyaient y avoir trouvé refuge, furent systématiquement massacrés. C’était le 13 avril 1994, sept jours après l’attentat meurtrier, dans la capitale Kigali, contre l’avion du président (hutu) rwandais Juvénal Habyarimana qui allait déclencher le génocide.
Les deux accusés décrivent une autre réalité, qui laisse également entrevoir leur ligne de défense. Ils tentent de couper le cordon qui les relierait au reste de l’entreprise criminelle. A l’entendre, Octavien Ngenzi, fort respectueux vis-à-vis de la cour présidée par la conseillère à la cour d’appel de Paris, Madeleine Mathieu, aurait été le premier surpris d’apprendre sa nomination au poste de maire, fonction consistant, dit-il, à « l’administration de la ville et assurer le bien-être de la population ». Aucun des deux ne nie la réalité du génocide, « une question tranchée juridiquement depuis longtemps », a rappelé Philippe Courroye, seulement leur responsabilité dans le drame et d’avoir agi de concert.
Dans le box des accusés, les deux hommes semblent d’ailleurs presque s’ignorer. Aucun geste complice ne rapproche Tito Barahira – taciturne sexagénaire aux cheveux et moustache grisonnants, installé dans un fauteuil destiné à apaiser les douleurs de la maladie rénale qui le ronge – d’Octavien Ngenzi, plus volubile, s’exprimant en français quand son voisin a recours aux traducteurs de kinyarwanda, sa langue d’origine.
C’est d’ailleurs à la faveur de ce procès que les deux hommes se sont retrouvés, vingt-deux ans après le drame de Kabarondo. Avant cela, ce furent des années d’errance et de séparation familiale entamées quelques jours seulement après le massacre de l’église alors que les rebelles tutsi du Front patriotique rwandais investissaient leur région. Leur parcours les mènera dans les camps de réfugiés du Burundi ou de Tanzanie voisins du Rwanda, en passant par le Kenya, pour finir par des arrestations à Mayotte, en 2010, pour Octavien Ngenzi, et dans les environs de Toulouse pour Tito Barahira, trois ans plus tard. Le procès dira s’ils ne cherchaient alors qu’à fuir la guerre, ses dévastations et son lot de vengeances, parfois aveugles, dans un pays désormais dirigé par les anciennes victimes, ou s’ils appartenaient à cette cohorte de bourreaux tentant d’échapper à la justice.