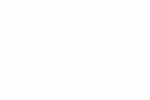Au château du Courbat, les forces de l’ordre épuisées viennent se reconstruire

Au château du Courbat, les forces de l’ordre épuisées viennent se reconstruire
Par Camille Bordenet (Le Liège (Indre-et-Loire), envoyée spéciale)
Unique en France, ce centre de soins accueille policiers et gendarmes qui combattent le burn-out, la dépression et l’alcoolisme.
Quatre fois par jour (à 7 h 45, 9 h, 14 h et 16 h 30), l’appel aux troupes. Redonner des repères aux patients fait partie de la reconstruction. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
L’air est encore frais en ce matin de juin, les oiseaux piaillent dans les grands cèdres, les canards glissent sur l’étang. Médicaments avalés à l’infirmerie, les résidents du château du Courbat pressent le pas tandis que la cloche sonne neuf heures, brisant le silence du domaine aux airs de monastère. C’est l’heure de l’appel des troupes, comme quatre fois par jour, devant le bureau de Billy Titus, le « PAMS » – pour policier assistant médico-social.
On énonce les activités de la journée : marche du vendredi, atelier d’écriture, équithérapie, rendez-vous médicaux. Le programme est chargé. Cet encadrement, qui pourrait paraître un peu militaire, plaît à Michel (tous les prénoms ont été modifiés), la quarantaine, venu ici pour retrouver des repères. « Refaire surface », surtout. Douze ans que ce CRS épuisé n’avait pas eu de journées rythmées par des horaires « normaux ».
Burn-out, dépression
Ici, dans ce bout du monde de l’Indre-et-Loire perdu au milieu des champs de blé, on panse les plaies à l’âme des forces de l’ordre. Les patients sont pour la moitié policiers, gendarmes, pompiers ou agents pénitentiaires, pour l’autre, des hommes et des femmes de la région. Tous combattent burn-out, dépression ou alcoolisme. Parfois les trois. Chaque année, ils sont plus de trois cents à venir, pour un mois ou deux. Le temps de se reconstruire. « Notre objectif premier est de permettre aux forces de l’ordre un retour en service dans les meilleures conditions physiques, psychiques et sociales », explique Frédérique Yonnet, la directrice.
Créé par et pour des CRS en 1953, unique en France et reconnu d’utilité publique, cet établissement de soin spécialisé en addictions et burn-out est géré par l’Association nationale d’action sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur (ANAS) et financé par l’Assurance maladie.
Attentats, plan Vigipirate, état d’urgence, COP21, manifestations, Euro de football… « Les forces de l’ordre sont dans un état d’épuisement généralisé », constate Mme Yonnet. Et les patients qui arrivent au Courbat sont « de plus en plus jeunes ». Ici, l’assassinat de leurs deux confrères à Magnanville (Yvelines) a créé un choc. Chacun s’est senti rattrapé par l’horreur et visé en tant que policier. Devant le château, le drapeau français est resté en berne.
Après la succession d’attentats, le centre vient de mettre en place une prise en charge du stress post-traumatique. La directrice ne s’attend pas à voir arriver les patients qui pourraient être concernés avant quelques mois. Pour l’instant, état d’urgence oblige, « ils ne veulent pas lâcher le terrain ». Après Charlie Hebdo, en janvier 2015, il avait fallu attendre plusieurs mois avant de voir arriver les policiers au bord du gouffre. Le centre avait accueilli soixante-dix patients, contre cinquante-six en temps normal.
Deux patients du Courbat regardent l’hommage national rendu vendredi 17 juin au couple de fonctionnaires du ministère de l’intérieur tués quelques jours plus tôt par Larossi Abballa. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
Michel, lui, s’est effondré il y a peu. « Cassé ». Dix-sept ans à porter l’uniforme avant de le déposer au placard, en mai. Face aux difficultés personnelles et professionnelles, la bouteille était devenue la compagne de ses nuits blanches. Ici, entre les mains bienveillantes du personnel encadrant, il retrouve un peu de quiétude, loin des pavés des manifestants contre la loi travail, des projectiles de Nuit debout et des feux de palettes de Calais. « Depuis plus d’un an, on a été envoyés sur tous les fronts… », raconte-t-il, traits tirés et regard sombre perdu dans le vide.
« Un numéro, un matricule »
Journées de quatorze heures contre dix en temps normal, jours de repos et congés à la trappe, déplacements permanents, « forcément, la vie de famille en prend un coup ». Michel s’est séparé de sa femme il y a trois ans. S’il a « signé pour ça » et si la période est exceptionnelle, « ils ont tiré sur la corde », considère-t-il. Et sans contrepartie. Pas étonnant que des compagnies se soient mises en arrêt faute de pouvoir faire grève, juge-t-il. Entré dans la police par amour du métier, Michel s’est vu devenir « un numéro, un matricule ». « J’ai l’impression que là-haut, dans les bureaux, ils prennent la carte de France et tirent aux fléchettes pour savoir où ils vont envoyer les compagnies. Ils nous emploient pour tout et pour rien. »
Deux fois par semaine, la marche en groupe permet de laisser vagabonder ses idées dans la nature. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
La surcharge de travail serait supportable si la reconnaissance était là. Mais pour Michel, les CRS ont « toujours le rôle des agresseurs », sorte de réceptacle de la vindicte populaire. « On prend les coups pour l’Etat, parce qu’on représente la loi, mais au moindre dérapage, notre parole est mise en doute et les médias nous enfoncent. » Se faire caillasser, insulter et traiter « d’enculés de flics », ou encore cracher dessus, est devenu routinier.
Face aux provocations, il faut garder son sang froid, « ça fait partie du job ». « Mais comprenez qu’après plusieurs heures, si on nous donne le droit de riposter, on riposte. » Au risque d’intervenir à l’encontre de manifestants qui ne sont « pas forcément les bons ». Au risque que parfois, « certains collègues craquent », concède le CRS. « Les manifestants n’imaginent pas que malgré notre devoir de maintien de l’ordre, il nous arrive de partager leurs revendications. »
Une affiche qu’a fait faire le Courbat en hommage aux forces de l’ordre. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
Commandant d’une unité de gendarmerie, vingt-sept ans de métier derrière lui, Philippe, 47 ans, a tenu ce « rythme infernal » jusqu’en décembre 2015. Joignable 24h/24, rappelable sur ses jours de congés, même quand la glacière était prête pour partir en week-end. « Après les attentats, il a fallu tout de suite montrer du bleu et du blanc partout pour rassurer la population, faire quelque chose à tout prix », soupire-t-il. La petite pierre verte autour de son cou, cadeau de sa plus petite fille avant son entrée au Courbat – « pour se sentir bien » – détonne avec sa carrure imposante.
Tabou
En décembre, il est monté à 21,17 de tension. « Burn-out », a dit le médecin. « Mais chez nous, les militaires, le burn-out, ça n’existe pas ». Dire que l’on va mal reste un tabou. Il y a aussi la culpabilité de « lâcher les collègues, déjà en sous-effectif ». « En tant que patron d’unité, vous avez l’impression de lâcher vos soldats. » Au début de son arrêt, Philippe ne pouvait s’empêcher de retourner à la caserne. Et de garder son téléphone de service allumé. « Conscience professionnelle », dit-il. « Addiction », pense plutôt Billy, le PAMS. Cet ex-CRS et ex-patient du Courbat est bien placé pour comprendre le malaise des patients, il a lui-même été victime d’épuisement professionnel il y a plusieurs années. Son bureau, c’est « le bureau des pleurs », celui où la soupape des costauds lâche, où des années de pression se déversent.
Au Courbat, policiers et gendarmes partagent la même rancœur contre « la politique du chiffre » – « la bâtonnite » comme on dit dans le métier –, symbole de l’ère Sarkozy, et qui n’a, selon eux, « jamais été vraiment abandonnée depuis ». Tous y voient le moment où leur profession a basculé vers « une course aux résultats et à la performance ».
La prise de médicaments à l’infirmerie a lieu trois fois par jour. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
Avec, paradoxalement, « de moins en moins d’effectifs et de moyens », souligne Paul, 38 ans, policier dans les transports : « j’ai déjà vu des collègues interpeller pour un petit morceau de shit parce qu’ils n’avaient pas fait leur chiffre à la fin du mois ». Idem pour Max, policier dans un service d’enregistrement des plaintes, qui a craqué parce que ses collègues et sa hiérarchie lui reprochaient son manque de rapidité. « Mais quand il s’agit des plaintes de femmes battues, je préfère les prendre correctement, plutôt que de faire de l’abattage. » Et puis il y a les humiliations de ceux qui jouent « aux petits chefs ». Gardien de la paix, Fabien, 42 ans, se souvient de cette phrase de son patron, de dix ans son cadet : « Vous n’êtes qu’un pion sur mon échiquier. »
Insultes et agressions lors des contrôles
Paul se dit que la pression du métier serait peut-être plus supportable, et l’alcool, un refuge moins tentant, s’il y avait de l’écoute. « C’est ce qui nous manque le plus. On est vraiment livrés à nous-mêmes. » Les images des suicides sur les voies restent imprimées sur sa rétine et reviennent parfois par flash, sans prévenir. « Sept en deux ans », il n’oubliera jamais. « Pas une fois on ne m’a demandé comment j’allais, ni proposé un débriefing ou un suivi psychologique. »
Sans parler des insultes et agressions lors des contrôles – « on ne sait jamais si on va rentrer indemne le soir » –, de la surexposition à l’heure où chaque intervention est filmée et postée sur les réseaux sociaux, de la parole mise en doute face aux interpellés… Face à l’angoisse qui l’assaillait le soir, l’alcool est devenu « un refuge ». « Ça commence par quelques verres en rentrant, pour arrêter le petit vélo dans la tête. On ne se voit pas partir. »
Au coeur de la prise en charge au Courbat, le programme de réathlétisation, pour retrouver une santé physique. Pour certains, le sport devient un exutoire. | Cyril Chigot / Divergence pour Le Monde
Ce soir est le dernier de Paul au Courbat. Il se sent « remis sur pied » et a hâte de retrouver son épouse et ses quatre enfants. Un peu moins de reprendre le travail, même s’il sera désormais dans les bureaux. « Pas encore prêt à reprendre le terrain », ose-t-il dire. Une chose est sûre : il sera très attentif à ses collègues en détresse. S’il le peut, il leur conseillera de se faire aider. Il y a le Courbat, mais aussi le service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) du ministère de l’intérieur, qui compte une soixantaine de psychologues partout en France.
« Surmortalité par suicide »
« Il ne faut pas attendre d’être à bout et risquer de commettre l’irréparable », insiste Paul. Car au Courbat, tous ou presque disent avoir connu un collègue qui a mis fin à ses jours, souvent avec son arme de service et sur son lieu de travail. Une étude réalisée par GendXXI, une association professionnelle de gendarmes, souligne que de 2006 à 2015, à structure démographique équivalente, « on constate une surmortalité par suicide dans la gendarmerie et la police, significative par rapport à la moyenne française ».
Le Courbat lui-même compte deux anciens patients qui ont mis fin à leurs jours. Alors ici, les policiers accueillent diversement la possibilité qui pourrait leur être donnée de porter leur arme hors service, même après l’état d’urgence. « C’est à double tranchant », résume Fabien.
Comme Paul, tous appréhendent la reprise. Surtout le regard des collègues et de la hiérarchie. Il y a la peur de rechuter, aussi. Et puis la versatilité de la population. « On nous aime et nous remercie pendant quinze jours, après on nous déteste à nouveau », déplorent-ils. « Il va falloir retourner dans la fosse aux loups », lâche Philippe. Pourtant, aucun d’entre eux ne s’imaginerait changer de métier.
Des mesures pour prévenir le mal-être professionnel et les suicides dans la police
Sollicitée par Le Monde à propos de l’épuisement professionnel qui traverse les rangs de la police et des réponses qui y sont apportées, la Direction générale de la police nationale (DGPN) n’a pas souhaité s’exprimer. Un certain nombre de mesures ont toutefois été mises en place.
Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) : créé en 1996 après une vague de suicides, ce service du ministère de l’intérieur placé sous l’autorité d’une psychologue est composé d’une soixantaine de praticiens répartis sur l’ensemble du territoire. Ils « assurent une écoute, un soutien et un accompagnement des policiers en difficulté, organisent des permanences et des séances d’information, selon le ministère de l’intérieur. Des actions de prévention sont également menées, notamment avec des groupes de parole ».
Plan d’action antisuicide : le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a mis en œuvre ce plan en janvier 2015 pour renforcer la prévention à la suite d’un pic du nombre de suicides dans la police en 2014 (cinquante-cinq, contre une quarantaine en moyenne les années précédentes). Parmi les mesures : le recrutement de psychologues supplémentaires au sein du SSPO, une collaboration plus étroite entre le centre du Courbat et la DGPN pour suivre les retours en service des policiers après un congé maladie long, un renforcement de la prévention auprès des jeunes policiers, mais aussi la poursuite d’un dispositif permettant aux policiers de déposer leur arme de service à la fin de leur vacation grâce à des casiers individuels.
Pôles de vigilance suicide : ils ont été progressivement mis en place depuis janvier 2013 au sein de chaque département français dans les services territoriaux de la police nationale. « Sous l’égide du médecin de prévention, ils réunissent les professionnels de soutien pour la mise en œuvre d’une prévention coordonnée et anticipée », écrit le ministère de l’intérieur.
Guide santé et sécurité au travail : dans le prolongement d’un plan de prévention des risques psychosociaux du ministère de l’intérieur, ce livret pédagogique – que Le Monde a pu consulter – a été conçu en 2013 à destination des chefs de service et recense l’ensemble des dispositifs de soutien médicaux, sanitaires et psychologiques à disposition des policiers et de leur hiérarchie.