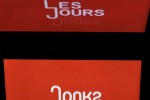Chronique d’une Marocaine qui joue les filles de l’air

Chronique d’une Marocaine qui joue les filles de l’air
Par Fatym Layachi
L’actrice franco-marocaine Fatym Layachi raconte ses débats de Lagos à Casablanca, en passant par Paris, sur l’impossible définition d’une africanité.
Vol AT555 Casablanca-Lagos. Dans cet avion qui se dirige vers la mégalopole tentaculaire, la capitale économique du Nigeria, je me suis subitement sentie viscéralement africaine. Me voilà à l’ouest de ce continent, dans le golfe de Guinée, de l’autre côté du Sahara. Me voilà en Afrique, comme on dit. La chaleur est écrasante, humide, le balai cahoteux de cette cité de 10 ou 20 millions d’habitants, nul n’est capable de compter le nombre d’âmes qui y vivent, s’impose à moi. Tout va vite, très vite. On y vit la grande vie, bling-bling à coups de pétrodollars, ou on y survit, dans les coupures de courant et les ordures.
Dans ce pays, comme souvent, c’est la culture mondialisée qui permet de tisser des liens. Ou du moins de commencer le tissage. C’est grâce à ma passion pour les manucures impeccables que je suis devenue copine avec Adanya après qu’on se soient complimentées sur la couleur de nos vernis à ongles. Comme quoi, les préoccupations girly, de Casablanca à Lagos, ça rapproche.
Parisienne sans talons
Adanya est une jeune femme sublime dont l’allure ferait pâlir d’envie la plus branchée des Londoniennes. Elle est passionnée de littérature américaine et fière de parler yoruba dans sa vie quotidienne. Elle appartient à cette génération de Nigérians bien nés et qui ont décidé de rentrer au pays, devenu en 2014 la première puissance économique du continent devant l’Afrique du Sud, et bien loin devant le Maroc qui semble si petit vu de Lagos. La presse parle de « repats » pour qualifier les Nigérians comme la belle et distinguée Adanya.
J’ai passé de délicieux moments à discuter et faire la fête avec elle, dans les clubs exubérants des beaux quartiers de la mégalopole. Un après-midi, autour d’une tasse de thé, Adanya glisse dans la conversation : « Pour nous les Africains, ce n’est pas comme pour vous ! » Nous ? Vous ? Nous sommes seules. Elle parle de moi en disant « vous » ? Là, je bloque. Reprenons : je m’appelle Fatym, je suis née et j’ai grandi au Maroc, pays africain, au nord du Sahara certes, mais en Afrique. Ne suis-je pas censée être africaine ? Ce n’est même pas un ressenti, c’est de la géographie.
Mais visiblement, à Lagos, je suis trop blanche pour être africaine et de l’autre côté, à Copenhague, je suis trop foncée pour être européenne. Je m’empresse donc de demander à Adanya ce que je suis, à ses yeux. Après un long moment de louvoiements, elle lâche avec cet accent nigérian si charmant : « Tu es française et musulmane. » Ce n’est pas faux. Je suis aussi française. Mais ce n’est que partiellement vrai. Je ne réponds pas, je lis la confusion qui envahit son visage. Elle est dubitative. « Comment ça se fait que tu sois musulmane et que tu ne sois pas voilée ? Et que tu sois parisienne et tu ne portes pas de talons ? » La mondialisation des clichés ne connaît pas de frontières. Le voile, c’est une nouvelle mode dont je ne suis pas très fan, même lorsqu’il est griffé Dolce & Gabbana, et les talons sont de moins en moins à la mode en journée. Même le saint patron de l’allure, Karl Lagerfeld, le confirme.
Adanya rajoute un nuage de lait dans son thé et finit par conclure que, finalement, je suis arabe comme « Jasmine dans Aladdin ». Ah ! ce serait tellement poétique d’imaginer ma mère en Orientale sublime m’initiant au couscous et aux cornes de gazelle en m’aspergeant d’eau de fleur d’oranger. Joli tableau, presque érotique, pour éveiller les fantasmes. Mais c’est loin de la réalité. Ma mère est sublime mais elle n’a rien d’un rêve orientaliste éculé. Elle n’a aucune idée du temps de cuisson d’un œuf à la coque. Elle manque toujours de coriandre dans sa cuisine. Elle mange des sushis commandés sur Internet. Elle écoute Lou Reed, lit des romans suédois un peu sombres et puis elle est secrètement amoureuse de Kevin Costner. Pour le tableau de Delacroix, il faudra repasser ! Aux yeux d’Adanya, en tout cas, ma petite personne et le Maroc ne sont pas « exactly Africa ». Cet échange me fait soudain appréhender Lagos. A défaut d’y être une âme sœur africaine, à défaut d’appartenir à cette mégapole fascinante, je ressens pourtant un lien étrange et inqualifiable.
Mantra afroptimiste
Vol AT554, Lagos-Casablanca. Je me ressource en famille et retrouve mes amis africains, pardon, marocains. Et me voilà à jouer à l’anthropologue de salon enquêtant sur le sentiment identitaire des miens. Car j’ai désormais très envie de savoir si mon entourage ressent ou pas ce fameux panafricanisme. De la Constitution à la COP22, qui doit se tenir à Marrakech à la fin de l’année, les discours officiels sont clairs : le Maroc affirmer sa place sur le continent où le roi a d’ailleurs multiplié les visites officielles. Et pourtant, le racisme quotidien dont sont victimes les Subsahariens au Maroc est indéniable, écœurant.
« L’Afrique, c’est l’avenir ! » Ce mantra de Hassan, un ami d’enfance, n’a rien de l’angélisme militant. Il parle en capitaine d’industrie marocain qui, comme le veut le roi, lorgne sur le sud du Sahara. Il vante une croissance à deux chiffres qui fait rêver les investisseurs du monde entier. Et malgré son cynisme, il n’a pas tort. Le lendemain, je passe prendre des nouvelles d’Amine. Lui a la chance (ou pas) de n’avoir quitté ni ses rêves ni sa dégaine d’adolescent révolté. Je lui demande comment il vit son identité continentale. Il m’explique que « l’Afrique, c’est la base ». Il écoute Bob Marley, a un poster un peu jauni de Thomas Sankara sur le mur. Il mélange tout, fait des amalgames et des raccourcis.
J’ai tout de même l’impression d’avoir grandi dans un pays qui se conçoit un peu comme une île, loin de son continent, les yeux rivés sur un autre pas si proche.
Il est temps de retourner à ma vie « normale », celle dans laquelle, a priori, tout est plus simple parce que plus globalisé. Parce que je ne suis pas très douée en graphisme et encore moins en 3D, quand je dessine le monde, je le mets à plat, et le centre à Paris. C’est plus simple. Pour reprendre pied dans ma vie, donc, je sors dîner avec d’anciens copains de fac, travaillant pour la plupart dans la communication. L’idée de parler de tout et de n’importe quoi m’enchante. Entre deux plats, on commente l’actualité. Florian me demande mon avis sur la question des banlieues. Aurais-je été élevée au rang de sociologue par contumace ? Suis-je en train d’y être réduite ? Oui, c’est plutôt ça ! Je n’ai pas un nom à coucher dehors, mais assez facile tout de même à caser dans une boîte à clichés. Malheureusement pour Florian, à part citer Thomas Guénolé, mon politologue de chevet quand il s’agit des cités, je ne vois pas comment éclairer sa lanterne. Surtout que, jusqu’à récemment, de la banlieue, je ne connaissais que le théâtre des Amandiers. A priori, je suis plus à l’aise pour parler de la radicalité des choix scénographiques de Philippe Quesne que des cellules dormantes du djihadisme. Mais bon, Florian aime mettre les gens dans des cases. Lagos me manque subitement.
Fatym Layachi est une comédienne marocaine. Elle a notamment tourné dans Marock de Laïla Marrakchi (2005), Un film de Mohamed Achaour (2011), Femme écrite de Lahcen Zinoun (2012), La Fleur d’Aghmat de Farida Bourkia (2013) et The CEO de Kunle Afolayan (2016).