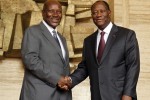Dominique Besnehard : « On ne rend pas magnifique qui n’a pas de talent »

Dominique Besnehard : « On ne rend pas magnifique qui n’a pas de talent »
Propos recueillis par Pascale Krémer
Ancien agent d’acteurs, Dominique Besnehard est devenu producteur. Sa série « Dix pour cent », sur les coulisses du cinéma, a été un vrai succès critique et populaire. Une seconde saison est en préparation.
Je ne serais pas arrivé là si…
Si je n’avais pas eu un frère jumeau. Comme il était de santé assez fragile, il avait toute l’attention de ma mère et de ma sœur aînée. Mon père, lui, travaillait dans sa supérette à Houlgate, il n’avait pas le temps de s’occuper de moi. Et finalement, cela m’arrangeait. J’étais libre, j’allais et venais dans la rue, dans les magasins, chez les voisins. L’été, je partais chez mon grand-père à la campagne et en colo. J’ai appris à être autonome, à communiquer avec les autres, à m’occuper d’eux. Toute la vie, cela m’a servi.
Vous n’aidiez pas à l’épicerie ?
J’y rejoignais ma mère le soir. C’était la Ménie Grégoire d’Houlgate. Elle parlait beaucoup avec les clients − et moi, j’adorais les écouter raconter leur vie. Ma mère avait un côté rebelle : mon grand-père, un paysan qui avait des terres et de l’argent, voulait qu’elle épouse un propriétaire terrien, mais elle lui avait préféré mon père, un boulanger. Ce grand-père peu aimable, je lui dois d’avoir pu regarder la télévision − à la maison, nous ne l’avons eue que pour mes 12 ans, en 1966. Il l’avait achetée pour voir le général de Gaulle. J’ai découvert les feuilletons et les variétés. Une révélation ! Je voulais faire partie de cet univers fascinant. J’attendais impatiemment la « Tournée des idoles » au casino d’Houlgate, je lisais Mon film et Cinémonde, Salut les copains, Télé 7 jours, Ciné revue… Je découpais les articles, les photos, je les collais dans des cahiers. Mon journal intime, c’était ça. J’écoutais les 45 tours de Sylvie Vartan, je faisais du théâtre au patronage, mes parents nous emmenaient au cinéma à Trouville ou Deauville. Et j’étais amoureux de Marlène Jobert ! Dans Ciné revue, il y avait la rubrique « Où leur écrire ? ». Je ne m’en privais pas. C’est la télé qui a été ma source de culture.
Quels ont été vos premiers contacts avec une culture plus classique ?
J’ai eu une bonne fée, une professeure de français extraordinaire. Madame Schoenfeld. Je vais encore la voir régulièrement dans le Sud. C’était une mère célibataire venue de la capitale s’installer à Deauville. Elle amenait un parfum de Paris, de théâtre, elle nous racontait ses soirées à la Comédie-Française… Elle a monté une troupe, nous a emmenés le week-end en voiture voir des pièces à Caen, et même à Paris. Elle m’a fait lire Anouilh, Camus, Sartre, découvrir le théâtre d’Ariane Mnouchkine, de Roger Planchon. Surtout, elle m’a donné confiance, en me disant : « Dominique, si tu veux faire ça, fais-le, suis ta passion. » Je sais qu’elle a eu la même influence sur Valérie Bonneton, qui l’a eue aussi comme prof. Cette confiance, ensuite, c’est moi qui l’ai donnée aux autres, comme directeur de casting, puis agent d’acteurs.
Après le bac, vous êtes reçu au concours de l’Ecole supérieure de théâtre, la fameuse école de la rue Blanche, en section technique « Mise en scène, régie »…
Je veux être un artiste, mais j’ai conscience de mes limites, donc je prends un chemin de traverse. J’ai 19 ans, une chambre de bonne près de l’Arc de Triomphe… A nous Paris ! Je passe mes journées avec de jeunes acteurs, avec Fanny Cottençon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine Frot, Christophe Malavoy (beau comme un Dieu), Laurent Malet… Je suis le cours de théâtre de Madeleine, la femme de Louis Jouvet, la classe de mise en scène du réalisateur Gérard Vergez, je fais de la figuration à la Comédie-Française pour gagner ma vie. Je suis heureux, dans mon élément ! Et quand même un peu surpris que certains élèves passent leur temps au café, n’aillent pas voir les pièces des autres. Tous ne sont pas aussi passionnés que moi.
Comment avez-vous démarré dans le cinéma ?
Alain Quercy, un ancien jeune premier des années 1950 devenu réalisateur télé, était le père d’un copain de lycée. Pour l’adaptation en feuilleton du roman Ces grappes de ma vigne, il m’a demandé, puisqu’il me savait passionné, de réfléchir au casting. Il a pris tous ceux que je suggérais, même le rôle principal, Jean-Luc Boutté, que j’avais croisé à la Comédie-Française. J’ai été assistant stagiaire sur le film. Puis tout s’est enchaîné, j’ai eu cette chance, ne jamais galérer. Ensuite, il y a eu le casting d’enfants d’Un sac de billes de Jacques Doillon. J’avais trouvé le truc, pour les enfants : le père Di Falco, qui faisait faire du théâtre aux élèves, m’autorisait à entrer dans les écoles privées de la rue Madame. Ensuite, Claude Berri m’a remarqué, demandé de faire tous ses castings, présenté à Claude Sautet, Roman Polanski, Pierre Granier-Deferre, Jean-Jacques Beineix…
Quelles qualités faisaient de vous un directeur de casting si recherché ?
Il faut être curieux, avoir de l’intuition, savoir déceler au premier regard une sensibilité, un tempérament, les blessures qui font les grands interprètes. Je suis heureux d’avoir découvert des gens qui n’étaient pas dans le métier (Béatrice Dalle, Emmanuelle Seigner, Juliette Binoche, Gérard Darmon…), ou dévoilé d’autres facettes des comédiens que j’aimais. On se sent un peu démiurge. Mais on ne rend pas magnifique qui n’a pas de talent.
Vous avez ensuite été agent d’acteurs durant vingt et un ans chez Artmédia, un métier que vous avez contribué à sortir de l’ombre…
Grâce à Claude Berri, à 24 ans, je rencontre Marlène Jobert, qui me demande d’être son agent. Avec elle, j’apprends ce qu’est le quotidien d’une actrice. Ses doutes, ses craintes, ses blessures. Un agent artistique accompagne dans les choix, les contrats, parfois même aux impôts ou en correctionnelle. Etre l’agent de Béatrice Dalle, par exemple, m’a procuré d’immenses joies et certaines nuits d’angoisse… Ce métier est un sacerdoce, les acteurs aiment qu’on soit à leur disposition. Jean-Claude Brialy m’a appelé tous les jours pendant les vingt et une années où j’ai été son agent. On ressent une culpabilité permanente. De n’avoir pas décroché tel rôle, pas assez fait pour untel, trop pour une telle… Quand les gens qu’on aime ne travaillent pas, il est compliqué de trouver les mots, d’affronter leur désespoir…
Etre l’agent artistique des idoles de votre enfance, était-ce votre plus grand bonheur ?
Je suis passé de l’autre côté de la télé de mon enfance. Et j’ai rarement été déçu par les gens que j’aimais alors : Marlène Jobert, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant… Avec Sylvie Vartan, que j’ai rencontrée en 1981, cela ressemblait à des retrouvailles tant elle faisait partie de ma vie. Les acteurs sont attachants, bouleversants, généreux. Et aussi impitoyables, capricieux, puérils, insupportables, égocentriques. C’est cette dualité qui les rend si intéressants. Jouer, c’est donner son émotion au public, mais également être centré sur soi, s’aimer. Les comédiens sont de grands narcissiques − comme les politiques qui, soi-disant, veulent sauver le monde mais agissent aussi pour eux. Je ne pourrais pas vivre sans eux. J’aime leurs angoisses.
Votre pire et meilleur souvenir d’agent ?
J’ai joué les pompiers sur des tournages où les deux acteurs principaux se détestaient. J’ai vu s’évanouir une actrice qui avait abusé de la chirurgie esthétique, et à qui j’ai dû avouer que c’était parce que les réalisateurs la trouvaient infilmable qu’elle ne tournait plus. Je me suis caché dans un placard de mon bureau pour échapper à une comédienne en manque de rôles qui me poursuivait… J’en suis sorti un peu trop vite, elle m’a vu et frappé. Mais c’est peut-être avec Sophie Marceau que j’ai vécu à la fois le plus agréable et le plus violent.
A quelles occasions ?
Avec elle, j’ai fait des voyages formidables, en Russie ou en Chine, où elle jouit depuis La boum d’une popularité incroyable. Les Chinois nous demandaient, en s’excusant presque si nous acceptions de faire des télés qui ne réunissaient qu’une centaine de millions de téléspectateurs. Le jour où elle présentait un film nouveau, les DVD pirates étaient déjà en vente dans la rue. Grâce à elle, j’ai vu ce qu’était la mondialisation. Et puis, il y a eu cette remise de Palme d’or à Cannes, en 1999. Elle avait passé la journée avec des enfants malades, elle atterrissait dans cette foire aux vanités qu’est aussi Cannes. Elle a improvisé un long monologue confus. C’était un naufrage en direct, et je ne pouvais pas monter sur scène la chercher. Terrible. Anjelica Huston a été formidable. Le soir, au dîner, elle lui a dit : « Ce n’est pas grave. On est des acteurs, mais on est avant tout des êtres humains. » Elle avait raison. Ce dérapage a rapproché Sophie du public.
Vous êtes producteur depuis 2006, et votre série, Dix pour cent, diffusée à l’automne 2015 sur France 2, a été un grand succès, avec une moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs par épisode. Vous décrivez un monde du cinéma assez hystérique. Vos acteurs préférés ne vous en veulent pas ?
Dans Dix pour cent, on est au-dessous de la réalité. Il y a peut-être encore plus de violence dans ce métier. Et il est de plus en plus compliqué d’y durer, de faire des carrières de quarante ans, comme celle d’une Nathalie Baye. Les acteurs sont plus nombreux, plus périssables, le public leur est moins fidèle. Dans cette série, rien n’est inventé, tout repose sur ce que j’ai vécu, les passions et les névroses que j’ai côtoyées. Nous avons essuyé une vingtaine de refus d’acteurs. Cécile de France, Julie Gayet, Laura Smet et Nathalie Baye ont eu cette capacité d’autodérision qui n’est pas si courante chez les acteurs français. Françoise Fabian, aussi. Elle s’amusait que l’on puisse faire dire par Line Renaud, à son sujet, qu’« à son anniversaire, les bougies avaient coûté plus cher que le gâteau ». Dans la deuxième saison, qui sortira en avril 2017, nous parlerons couple, sexualité, pertes de mémoire, drogue, ce sera toujours tendre – parce que c’est pour cela que ça marche –, mais peut-être plus cruel.
Vous comparez souvent les acteurs aux politiques, que vous connaissez également pour avoir soutenu Ségolène Royal, François Hollande ou Anne Hidalgo…
Je trouve le milieu du cinéma somme toute moins hystérique que celui de la télévision ou de la politique. Il peut y avoir une vraie solidarité entre acteurs dans les moments difficiles. Ségolène Royal, qui m’avait demandé de l’aider pendant la campagne présidentielle, m’a évacué un beau jour comme si je n’avais été qu’une lubie. Je lui donnais « une image trop parisienne. » J’ai cru que c’était la plus belle rencontre de ma vie, finalement cela a été une grande blessure. D’autant qu’elle a mis en danger le festival de cinéma francophone d’Angoulême, qu’elle avait d’abord soutenu, en coupant les subventions. J’ai dû trouver des sponsors, j’ai reçu l’aide de Bertrand Delanoë, qui présidait l’Association internationale des maires francophones. Le festival est devenu énorme, il en est à sa 9e édition, il a survécu. Mais j’ai vu de près combien hommes et femmes politiques pouvaient être narcissiques, cyniques, capables de violence. Des acteurs, en pire !
Dominique Besnehard présente, depuis le 2 mai, l’émission « Place au cinéma », tous les lundis soir sur France 5.
En février 2014, il a publié (avec Jean-Pierre Lavoignat) Casino d’hiver, aux éditions Plon (480 pages, 21 euros). Le livre est sorti en mai en version poche, aux éditions J’ai lu. (567 pages. 9 euros)
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici.