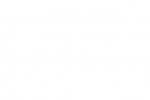L’Arte Povera résiste aux lois du marché

L’Arte Povera résiste aux lois du marché
M le magazine du Monde
Créé en Italie en 1967, ce mouvement artistique entendait marquer son refus du mercantilisme. Le Centre Pompidou lui consacre une exposition avec une nouvelle génération d’artistes.
Arte Povera. C’est avec ce cri de guerre que le critique d’art italien Germano Celant propulse, en 1967, une douzaine d’artistes transalpins comme Mario Merz, Alighiero Boetti ou Giulio Paolini, tous en quête d’un art subversif et radical. Présentés dans le cadre d’une exposition pluridisciplinaire jusqu’au 29 août au Centre Pompidou, à Paris, ces créateurs ont fait des petits.
Aujourd’hui, sans se réclamer d’une filiation directe, une jeune garde recherche elle aussi une frugalité des formes, loin de l’hyperbole et de l’outrance du marché de l’art. Bien malin qui pourrait donner une définition précise d’un Arte Povera qui sonne plus comme une attitude qu’un courant. Ce n’est « ni un mot d’ordre ni un mode d’emploi », avance Frédérique Paul, commissaire d’« Un art pauvre » à Beaubourg. Pour Germano Celant, la formule –controversée – signifiait un refus du mercantilisme et des acquis de la culture. « L’important était de corroder, graver, briser. Tenter une décomposition du régime culturel imposé », écrira-t-il dans la revue Flash Art.
Une dimension politique
La tribu ainsi estampillée questionnait les limites de l’art, mais aussi la place de l’homme, l’ordre souterrain des choses, à coups de matériaux naturels ou de récupération dont elle réactivait la force symbolique : la paille chez Mario Merz, les branches d’arbre chez Giuseppe Penone, la laine brute chez Jannis Kounellis, le givre chez Pier Paolo Calzolari… Bien que le groupe se soit affirmé pendant les années de plomb, la dimension politique était plus criante dans leurs actes que dans leurs créations artistiques.
En 1967, le critique d’art italien Germano Celant invente le terme « Arte Povera ». Au même moment l’artiste Alighiero Boeti crée une affiche « Manifesto », acte fondateur du mouvement. | COLLECTION CENTRE POMPIDOU, MNAM/CCI/BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY, PARIS/A. PAOUNOV. ADAGP
Et pourtant, organiser aujourd’hui une exposition autour de l’Arte Povera n’a rien d’anodin, quand les inégalités se creusent, quand, des « indignés » espagnols aux révoltés de Nuit debout, gronde partout en Europe un appel à résister aux lois du marché. Cette simplicité fait sens aussi quand l’art plébiscité par les millionnaires glisse vers la coûteuse machinerie high-tech. Si l’expression « art pauvre » disparaît vers 1972, son esprit perdure chez les enfants de la crise comme Katinka Bock, Gyan Panchal ou Guillaume Leblon. Non que ces jeunes gens couvent une quelconque révolution. Leurs liens avec l’Arte Povera sont, au minimum, distants.
De leurs aînés, ils ont toutefois retenu une humilité des formes, un goût de la soustraction plus que de l’addition, une attention aux petits riens. Les environnements fragiles de l’Ecossaise Karla Black se composent de feuilles de papiers et de pigments ou poudres de maquillage. Son confrère américain Gedi Sibony construit ses sculptures à base de chutes de moquette et de carton, tandis que le Français Gyan Panchal s’approprie les objets déclassés, ravivant l’aluminium d’un isolant avec une feuille d’argent, ou lustrant d’un frottis coloré une barre de fer abandonnée.
Chacun à sa façon renoue avec des gestes élémentaires, questionne les matériaux
sans qualités. Un air de famille ne suffit pas à faire bande. Pourtant la curatrice Françoise Cohen les a regroupés en 2011 au Carré d’art de Nîmes dans l’exposition « Pour un art pauvre ». Un titre aux allures de manifeste. L’idée ? « Chercher une morale de l’art », confie aujourd’hui la commissaire. Cette éthique a trouvé refuge au Centre international d’art et du paysage de Vassivière, dans le Limousin, dont la programmation privilégie les formes rugueuses et frêles, à la limite de la disparition.
Mais ne parlez pas à sa directrice, Marianne Lanavère, d’art pauvre. « C’est un art simple, de l’inachèvement, de l’irrésolution », corrige-t-elle. Aux produits finis, léchés, prêts à accrocher comme on parle de prêt-à-porter, à un « art désigné », manufacturé, elle oppose les « formes mutantes », proches du corps. Proches de la main aussi et des techniques archaïques. « C’est une manière différente d’envisager le travail, résume Gyan Panchal. Veut-on déléguer à une dizaine d’assistants et perdre le contrôle, le regard, le toucher, ou est-ce qu’on ne veut pas perdre de vue l’objet premier de notre travail ? »
Vue de l’exposition de Lydia Gifford « I am vertical/ Je suis verticale » au Centre international de l’art et du paysage de l’île de Vassivière. | LYDIA GIFFORD/AURÉLIEN MOLE, 2016
En creux se posent aussi les questions environnementales et le grand cycle de la matière. La Britannique Lydia Gifford, qui y a exposé jusqu’au 12 juin, a opté ainsi pour les supports modestes, à l’échelle du corps humain et en lien avec le paysage. « J’essaie de persuader les artistes que j’invite à ne pas produire de déchets à partir d’une œuvre, de ne pas faire
de grande pièce en résine », précise Marianne Lanavère. La Brésilienne Fernanda Gomes, exposée en 2013 à Vassivière, avait recyclé les socles et bancs rescapés d’une exposition précédente. Un art de la décroissance ? Plutôt une saine écologie de l’art.
« Un art pauvre », Centre Pompidou, Paris 4e. tél. : 01-44-78-12-33. Jusqu’au 29 août,
www.centrepompidou.fr
« I am Vertical/Je suis verticale. », Lydia Gifford. Centre international de l’art et du paysage,
île de Vassivière, Beaumont-du-Lac. tél. : 05-55-69-27-27. jusqu’au 12 juin. www.ciapiledevassiviere.com