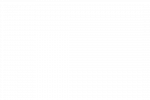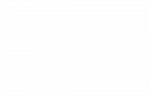« Brexit » : Bruxelles tente d’éviter la contagion

« Brexit » : Bruxelles tente d’éviter la contagion
Par Cécile Ducourtieux (Bruxelles, bureau européen), Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen)
Le président du Conseil européen prévoit une réunion sans les Britanniques, avant le sommet des 28 et 29 juin.
Le président du Conseil de l’Europe, Donald Tusk, le 24 juin, à Bruxelles. | FRANCOIS LENOIR/REUTERS
Au fond, personne, à Bruxelles, ne voulait réellement croire qu’un tel scénario fût possible. Il y a un an jour pour jour, c’était la Grèce, en quasi-faillite qui semblait, bien malgré elle, tout près de quitter l’Union européenne. Au matin du vendredi 24 juin, tout le monde découvrait avec effroi que le Royaume-Uni, membre du club depuis 43 ans, puissance économique et militaire de premier plan, avait choisi, démocratiquement, de prendre le large. Dans la capitale des Vingt-Huit, soudain devenus 27, le choc est considérable.
Tandis qu’à Londres, Nigel Farage, le leader du parti europhobe UKIP, affirmait que « l’aube se lève sur un Royaume-Uni indépendant », à Bruxelles, les « élites » qu’il dénonce régulièrement se réveillaient avec une fameuse gueule de bois. Depuis 2010, l’Union est en « polycrise », selon l’expression du président de la Commission, Jean-Claude Juncker : crise de l’euro, crise grecque, crise des réfugiés, crise sécuritaire et terrorisme, sans oublier les relations plus que difficiles avec la Russie et la guerre en Ukraine ou les atteintes à l’état de droit en Pologne… Mais, vendredi matin, l’Europe semblait plus fragile encore, confrontée pour la première fois depuis sa fondation, à l’idée que le projet communautaire est réversible.
Au Berlaymont, le siège de la Commission européenne, au Juste Lipse, celui du Conseil, et tout près de là, au Parlement européen, c’était le branle-bas de combat dès l’aube. A 7 heures, les chefs des principaux groupes politiques du Parlement faisaient le point et évoquaient une mini-session d’urgence, convoquée a priori pour mardi 28 juin. Le président de l’assemblée, Martin Schulz, a exprimé l’espoir qu’il n’y aurait pas de « réaction en chaîne », évoquant le « chemin dangereux » que prendraient les pays tentés de se distancier de l’Union. Donald Tusk, le président du Conseil, invitait à ne pas tomber dans « des réactions hystériques » et affirmait que l’UE était « déterminée à conserver son unité ».
Elan aux partis populistes et eurosceptiques
Les réunions vont se multiplier, d’ici le sommet européen des 28 et 29 juin : ministres des affaires étrangères sociaux-démocrates à Luxembourg, vendredi après-midi, collège des commissaires européens convoqué pour dimanche 26 juin, ministre des affaires étrangères des six pays fondateurs à Berlin, samedi matin. Le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel devraient, eux, se rencontrer lundi dans la capitale allemande. Et Donald Tusk devrait convoquer une réunion informelle à 27, sans le Royaume-Uni, juste avant le sommet européen.
La machine communautaire, avec ses quelque 40 000 fonctionnaires et ses dirigeants, tous habitués à un fonctionnement bien huilé, est entrée en territoire totalement inconnu. Son agenda est à terre, le Brexit l’a fait exploser. Dans l’immédiat, l’objectif est seulement d’éteindre l’incendie, sans dramatiser davantage une situation jugée déjà grave.
La crainte immédiate est celle d’une contagion. Le référendum britannique va donner un élan supplémentaire aux partis populistes et eurosceptiques, voire europhobes, qui sont désormais aux portes du pouvoir dans plusieurs États membres. Si d’autres quittent le navire, l’Union serait, cette fois, vraiment en danger de mort.
« Leave means leave »
Aux Pays-Bas, l’extrême droite emmenée par le député Geert Wilders, appuyé par divers mouvements populistes et des intellectuels europhobes, compte bien surfer sur la vague britannique. Un peu avant que Marine le Pen réclame une consultation populaire en France et dans tous les pays de l’Union, le leader du parti pour la liberté s’imaginait déjà en premier ministre organisant un « Nexit », la sortie des Pays-Bas de l’Union et même, dans leur cas, de l’euro. En Hongrie, le premier ministre en exercice, Viktor Orban, a déjà promis un référendum sur la politique migratoire de l’Union.
Paris, Berlin et Bruxelles entendent prendre très vite la main et envoyer un message clair : le Royaume-Uni a choisi de partir et « leave means leave » - quitter veut dire quitter - comme le dit M. Juncker. L’Union doit en tirer les conséquences et entrer - malgré les tentations de certains - dans une négociation dure avec Londres. Pour les dirigeants, il faut forcer un divorce net, rapide, tel que le prévoit l’article 50 du traité de Lisbonne, avec sa « clause de cession » qui n’a jamais été activée. « Les négociations de sortie doivent être conclues au maximum dans les deux ans, il ne peut pas y avoir de traitement spécial » a tweeté vendredi, Manfred Weber, président des conservateurs du PPE, majoritaire au Parlement européen. « On ne peut pas attendre les discussions au sein des tories », précise-t-il en s’inqiètant de la volonté de M. Cameron de ne pas déclencher l’article 50 avant son remplacement en octobre.
En théorie, l’Union a deux ans pour détricoter les relations nouées avec Londres depuis 1973. Puis, le Royaume-Uni devra renégocier sa relation commerciale et politique avec les 27. Là aussi, les dirigeants de la Commission ont fait passer un message sans ambiguïté : pas question pour les Britanniques de continuer à profiter comme si de rien n’était, gratuitement qui plus est, du marché intérieur. Sans droits de douane, avec la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des services. Le pays devra payer son écot au budget de l’UE, se soumettre à ses lois, à la Cour de justice, etc.
« Un avant et un après »
Dans les faits, les 27 sauront-ils faire front et trancher franchement le cordon ? Certains ne risquent-ils pas de reculer au moment de sauter et de plaider la conciliation, voire le statu quo avec Londres ? Surtout si les marchés financiers accusent trop violemment le coup ? C’est le pari que faisaient les « brexiters » britanniques. Au cours des derniers jours, certains, à Bruxelles, doutaient même de l’attitude allemande, même si le ministre des finances Wolfgang Schauble était monté au créneau.
Le départ des négociations du divorce pourrait être donné dès le Conseil européen des 28 et 29 juin prochain, à Bruxelles, prévu de longue date mais qui sera, pour le coup, totalement concentré au Brexit. À moyen terme, quelle sera la réaction des institutions bruxelloises ? « Il y aura un avant et un après référendum » répétaient, sur tous les tons, les dirigeants au cours des dernières semaines.
Une refondation de l’UE parait bien nécessaire. Car l’Europe n’en a pas fini avec ses « autres » crises et le départ du Royaume-Uni risque, en outre, de peser sur le couple franco-allemand, déjà en très petite forme. Londres était considéré comme l’indispensable « sparing partner » de Paris et de Berlin, l’élément nécessaire à l’équilibre entre les deux capitales. Londres était en ligne avec l’Allemagne sur les sujets économiques, plus en phase avec la France dans les domaines de la défense et des affaires étrangères.
Mais quelle réforme pourrait être appliquée à l’Union ? M. Tusk, appelle à en finir avec ce qu’il estime être l’utopie fédéraliste et à reconnaître que l’euroscepticisme est une réalité qu’il n’est plus possible d’ignorer. Le , conseille, lui, de « finir ce qui a été commencé ». « Je ne crois pas que nous devrions faire un pas important dans l’approfondissement ou l’élargissement de l’Union » a expliqué le social-démocrate néerlandais Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe.