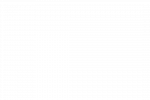« ce que nous connaissons aujourd’hui en France n’a rien à voir avec l’Italie des années de plomb »

« ce que nous connaissons aujourd’hui en France n’a rien à voir avec l’Italie des années de plomb »
Par Jean-Louis Fournel et Professeur à Paris 8
Le comparatisme historique auquel se livrent certains spécialistes a ses limites, surtout si l’on ne s’interroge pas sur les pratiques différenciées du maintien de l’ordre, pense Jean-Louis Fournel spécialiste de l’Italie en réaction à la tribune de Marc Lazar.
Même mâtinés de quelques références historiques habilement sélectives, les vagues analogies qui prennent le risque de faciliter des amalgames ne relèvent pas d’une analyse historique toujours très convaincante et débouchent encore moins sur des questionnements fructueux. Les interrogations suscitées par les pratiques actuelles de certains manifestants doivent-elles confluer vers des hypothèses insidieuses de dérives « terroristes » potentielles ? Il est permis d’en douter. À moins de vouloir retomber dans la très créative logique des élucubrations de MM. Bauer, Guéant et Sarkozy dans l’affaire dite de Tarnac.
Avant d’aller rechercher de partielles (et donc partiales) analogies historiques, il serait sans doute utile de se demander d’abord si, aujourd’hui, en dehors des dérapages individuels qui ont toujours existé, les formes systématiques prises par le maintien de l’ordre depuis trois mois lors des manifestations de masse n’ont pas quelques effets sur les façons de manifester dans les têtes de cortège. N’importe quel témoin ayant assisté à l’une ou l’autre des récentes manifestations a pu à cet égard remarquer que les forces de l’ordre mettaient à l’œuvre une tactique plutôt inédite de contrôle de très « rapproché » de la tête des manifestations (un peu à la façon dont elles peuvent à l’occasion le faire pour des manifestations de lycéens afin d’éviter tout incident), de séparation de celle-ci par rapport au reste du cortège (selon la technique de la « nasse ») et de blocages systématiques et répétés de la progression de l’ensemble de la manifestation, ce qui, très mécaniquement, ouvre la voie à des affrontements, dans un cycle action-réaction que l’on peut regretter mais qui est somme toute assez prévisible.
Après, ou en même temps, il est certes loisible de poser aussi les questions que se pose M. Lazar puisque l’histoire est faite pour penser le présent mais à condition de le faire sans privilégier les seuls arguments qui étayent la thèse que l’on a décidé a priori de défendre. Alors oui, il n’est pas absurde de soutenir que la violence de certaines manifestations dans l’Italie des années 1967-1977 a pu constituer pour certains une première expérience d’une violence politique considérée comme légitime et favoriser le basculement de quelques-uns dans la clandestinité armée et dans le « terrorisme ». Il n’est pas davantage déplacé d’évoquer la place que pouvait avoir dans la formation politique de certaines personnes dans les années 1960-1970 la conviction ancrée que la violence pouvait être accoucheuse de l’Histoire. Il est aussi juste de répéter que les mots entraînent parfois des actes (à condition d’ajouter que ce n’est pas toujours le cas…). Toutefois cela n’induit évidemment aucune causalité immédiate expliquant, et encore moins prophétisant, un passage à l’acte.
« Qualité des temps » différente
Et, surtout, la nécessaire rigueur de l’analyse requiert d’ajouter que les événements évoqués se passaient dans une « qualité des temps » qui n’a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui. Bien sûr M. Lazar n’oublie pas de faire allusion rapidement à cette obligation de méthode et il se réfère longuement au climat social et politique italien des années 1970 ; mais il le fait avec une orientation univoque en ne considérant que ce qui peut nourrir la thèse implicite du danger imminent d’un passage quasiment naturel de la conflictualité sociale radicale au « terrorisme », sans insister sur ce que peut apporter au raisonnement la prise en compte des différences avec la situation française aujourd’hui.
Il ne suffit pas de rappeler le nombre de grévistes en Italie si on ne dit pas explicitement qu’évidemment on n’est pas dans la même situation en France en 2016, ni qu’on ne se situe pas en 2016 quelques années après un bouleversement comme celui des années 68 - et ce ne serait pas inutile de tirer les conséquences de ce simple constat… Il ne suffit pas de rappeler la différence entre les terrorismes « noir » et « rouge », si on se passe de prendre en compte les effets de leurs chronologies et modalités respectives (le terrorisme noir a commencé immédiatement dès 1969 sur le mode de l’ultra-violence aveugle, et ce plusieurs années avant le terrorisme « ciblé » émanant des groupes clandestins se réclamant de l’extrême-gauche). On peut souligner enfin avec une apparente équanimité les dérives et les dérapages policiers de jadis et de naguère, voire de maintenant, mais cela relève de nuances tout à fait secondaires dans l’argumentation, si on ne s’interroge pas sur ce que produisent les pratiques différenciées de maintien de l’ordre.
Quant à ce qui se passa dans les années 1970 en Italie, on pourrait même revenir au moins sur quelques éléments. Dans ces manifestations des années 1970, il n’était pas exceptionnel que la police tirât à balle réelle sur les manifestants (ce qui on en conviendra n’était pas sans conséquence sur les réflexions et les éventuelles pratiques violentes de ces derniers) : on n’est bien heureusement pas dans ce cas en France même si certaines pratiques récentes de « maintien de l’ordre » sont inquiétantes. Par ailleurs, le cycle de conflictualité sociale aiguë et généralisée dans lequel ces manifestations s’inscrivaient, et qui est justement rappelé dans l’article, n’a strictement rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui en France.
Le climat politique de l’Italie durant ces années-là était marqué par ce que l’on appela la « stratégie de la tension », née des menées des services secrets en liaison avec une partie de l’extrême-droite italienne et de la droite de la démocratie chrétienne : ce n’est pas seulement un très vague terrorisme noir, relevant d’un activisme symétrique de l’autre « terrorisme d’extrême-gauche », qui est à l’origine de ces centaines de morts, c’est une stratégie politique de l’extrême-droite italienne qui conduisit à une série d’attentats de 1969 à 1980, nourrissant ainsi une crainte, parfaitement compréhensible, d’un coup d’état fascisant sur le modèle des régimes qui - ne l’oublions pas - gouvernèrent le Portugal, l’Espagne et la Grèce jusqu’au milieu des années 1970. Enfin, un gouvernement démocrate-chrétien à bout de souffle était dans les faits soutenu alors par un Parti communiste (PCI), enfermé à partir de 1974 dans la politique de « compromis historique », pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la lutte armée des Brigades rouges mais beaucoup avec l’analyse du coup d’état de Pinochet au Chili, ce tournant stratégique provoquant une sorte d’appel d’air à la gauche du PCI.
Toutes ces choses (et d’autres encore) sont désormais de l’ordre de l’acquis du travail des historiens, pas d’une position politique et idéologique, et elles mériteraient sans aucun doute d’être prises en compte dès lors que l’on se hasarde au comparatisme historique, d’autant plus que M. Lazar est un éminent spécialiste de ces questions et que son raisonnement intègre une partie d’entre elles (mais une partie seulement : celles qui peuvent justifier ces interrogations rhétoriques finales). À moins qu’il ne s’agisse de se lancer dans des conclusions biaisées, quelque peu hâtives, et, destinées avant tout à susciter des prophéties auto-réalisatrices, à stigmatiser tout mouvement protestataire un peu trop radical ou à attiser les peurs, ce dont notre pays n’a de toute évidence nul besoin en ce moment.
Jean-Louis Fournel, est professeur d’italien à l’Université Paris 8