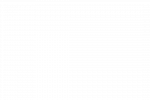Jean-Marc Simon, l’ambassadeur décomplexé

Jean-Marc Simon, l’ambassadeur décomplexé
Par Thomas Hofnung
Après avoir achevé sa carrière diplomatique en Côte d’Ivoire durant la crise électorale de 2010-2011, l’ancien du Quai d’Orsay s’est lancé dans les affaires. A Abidjan.
C’est un honneur qui est décerné à titre exceptionnel par l’Etat pour « services rendus à la République ». En octobre 2011, Jean-Marc Simon a été élevé à la dignité d’« ambassadeur de France » par le premier ministre de l’époque, François Fillon. Une distinction à vie qui lui a été octroyée au lendemain de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire, durant laquelle il a joué un rôle actif qu’il détaille dans un livre paru récemment, Secrets d’Afrique (éd. Cherche Midi). « C’est surtout honorifique, cela m’autorise par exemple à assister à la conférence des ambassadeurs à l’Elysée fin août », minaude-t-il, pas peu fier en réalité. Jean-Marc Simon, alias « JMS », fait en effet partie d’un club très fermé dans lequel on retrouve de prestigieux aînés tels Saint-John Perse ou Paul Claudel.
Au-delà de la carte de visite, ce titre lui permet aussi d’arrondir ses fins de mois et de conserver son passeport diplomatique. Ce privilège a son importance pour un retraité actif, toujours tiré à quatre épingles, qui continue de voyager régulièrement depuis qu’il a quitté le Quai d’Orsay en 2012. Plutôt que de pantoufler dans son fief de Senlis, dans l’Oise, où il aurait pu s’adonner paisiblement à sa passion des chevaux, Jean-Marc Simon a en effet créé son entreprise de consulting, Eurafrique Stratégies. Et se présente désormais comme l’ambassadeur des entreprises françaises en Afrique, le continent où il a accompli l’essentiel de sa carrière.
« Sur le dessus de la pile »
Cette reconversion expresse a fait jaser sur les bords de Seine, dans les couloirs feutrés du Quai. « JMS », lui, assume, sans complexe. Comme tout le reste. « C’est moi qui ai demandé à être entendu par la Commission de déontologie de la fonction publique, assure-t-il. J’ai pu expliquer que mon but était d’aider les entreprises françaises à gagner des parts de marché. Pourquoi ne pas utiliser mon carnet d’adresses dans les pays que je connais le mieux pour faire remonter le dossier des entreprises tricolores sur le dessus de la pile ? »
Théoriquement, comme le rapporte le journaliste Vincent Jauvert dans son livre La Face cachée du Quai d’Orsay (éd. Robert Laffont, avril 2016), un délai de trois ans est censé être respecté avant qu’un ancien représentant de la République fasse des affaires dans le pays où il a été en poste. Mais le diplomate Jean-Marc Simon a su visiblement trouver les arguments qui ont fait mouche : « Quand je me rends à Abidjan, j’y croise trois anciens ambassadeurs américains qui font des affaires sans que personne n’y trouve rien à redire », argue-t-il.
Du secret de la diplomatie au secret des affaires, le « businessman » Jean-Marc Simon reste évasif sur l’identité de ses clients, et sur les contrats en cours de négociation : « Une entreprise qui construit des ponts métalliques, une autre qui cultive des fruits et légumes. » On l’a vu récemment aux côtés d’Alassane Ouattara et d’Alpha Condé, les présidents de Côte d’Ivoire et de Guinée, lors de l’inauguration d’un pont reliant leurs deux pays. On l’aperçoit aussi à Libreville, capitale du Gabon, où il fut en poste de 2003 à 2009, et où il était déjà « très proche des milieux économiques », selon un témoin qui l’a fréquenté à cette époque.
« Il ouvre beaucoup de portes à Abidjan », confie aujourd’hui un Français installé sur place. Toutefois, son entregent est loin de faire l’unanimité : « Beaucoup d’entrepreneurs se méfient de lui, car il a la réputation de défendre davantage les intérêts d’Ouattara que ceux de ses clients potentiels », persifle un autre. Dans la métropole ivoirienne, certains évoquent aussi le luxe avec lequel cet ami du président serait reçu sur les bords de la lagune Ebrié. Il n’en a cure, et affiche – toujours sans complexe – sa proximité avec Alassane Ouattara. En novembre 2013, il n’a laissé à personne d’autre le soin de prononcer le discours de réception du « tombeur » de Laurent Gbagbo sous les ors de l’Académie des sciences d’outre-mer, à Paris. L’occasion de retracer le parcours du président ivoirien et, comme de bien entendu, de lui tresser des lauriers.
Adepte de la diplomatie parallèle
Dans une carrière bien remplie débutée dans les années 1970 et qui l’a mené de N’Djamena à Libreville en passant par Beyrouth, Téhéran, Bangui et Abuja, la Côte d’Ivoire restera le point culminant. En 2010, alors qu’il s’apprêtait à prendre une retraite paisible après cinq années passées à Libreville à amadouer un Omar Bongo déclinant aux prises avec sa succession et l’affaire des « biens mal acquis », Paris l’appelle pour une ultime ambassade, à Abidjan. Une mission périlleuse : coupé en deux depuis près de dix ans, le pays se prépare enfin à aller voter à l’élection présidentielle dans un climat tendu.
« JMS » n’hésite pas longtemps. « C’est un ambassadeur atypique, qui s’épanouit dans les postes sensibles et qui prise la diplomatie parallèle », note le journaliste et écrivain Antoine Glaser, qui l’a côtoyé pendant des années. Et d’ajouter : « Il ne faut pas oublier que Jean-Marc Simon est très proche de Michel Roussin, son parrain en quelque sorte au sein de la Chiraquie. » Il fut son directeur de cabinet adjoint lorsque M. Roussin était ministre de la coopération (en 1993), après avoir eu des responsabilités importantes dans les services de renseignement extérieurs. « JMS » est, par ailleurs, colonel de la réserve citoyenne, et n’hésitait pas à revêtir le treillis pour des visites de terrain quand il était en poste en Afrique.
En 2009, sa feuille de route pour Abidjan est claire : il s’agit d’accompagner en douceur le processus électoral, de rassurer le président sortant Laurent Gbagbo sur les intentions de Paris alors que l’amitié entre le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, et le candidat Alassane Ouattara n’est un mystère pour personne. « Nous n’avions pas de candidat », répète aujourd’hui Jean-Marc Simon.
A Abidjan, l’ambassadeur de France remplit sa mission avec application, nouant un dialogue de bon aloi avec un homme qu’il qualifie dans son livre de « tribun », davantage « militant » que stratège. Mais, en décembre 2010, quand Laurent Gbagbo décide de passer en force au lendemain du second tour de la présidentielle, le 28 novembre, à l’issue duquel il est donné perdant, le diplomate français ne tergiverse pas. Face au blocage de la Commission électorale indépendante (CEI), organisé par le pouvoir, il enjoint son président, le prudent Youssouf Bakayoko, de proclamer devant les caméras les résultats dont il dispose et qui sont en faveur d’Alassane Ouattara. Dans la foulée, la Cour constitutionnelle, contrôlée par le régime, invalide le vote dans plusieurs régions du Nord, donnant la victoire de justesse au président sortant. « Une véritable forfaiture », lance Jean-Marc Simon.
La crise est enclenchée et va durer jusqu’au dénouement, à Abidjan, où l’on retrouve Jean-Marc Simon. A l’aube du 11 avril 2011, alors que Gbagbo et ses troupes tiennent toujours la résidence présidentielle, malgré les raids héliportés de l’ONU et de l’armée française, et qu’elles s’apprêtent à lancer une offensive contre des forces pro-Ouattara désorganisées, l’ambassadeur appelle l’Elysée : « Après une nuit de bombardements, Gbagbo allait surgir sur les écrans télé pour dénoncer un coup d’Etat de la France, il fallait agir vite. » Paris ordonne alors à la force « Licorne » de passer à l’action : après avoir annihilé les dernières lignes de défense de Gbagbo, un détachement de blindés encercle la résidence présidentielle et perce même le mur d’enceinte à coups d’obus. Les hommes de Guillaume Soro n’ont plus qu’à cueillir le président devenu rebelle.
L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire Jean-Marc SImon avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le 7 avril 2011, à Abidjan. | AFP
A Abidjan, les partisans de l’ancien dirigeant, aujourd’hui dans les geôles de la Cour pénale internationale à La Haye (Pays-Bas), ne digèrent toujours pas cet épisode douloureux et accusent l’ambassadeur Simon d’avoir avalisé un « hold-up électoral ». Mais il en faudrait bien davantage pour déstabiliser cet homme placide, qui estime n’avoir fait que son devoir. « C’est un diplomate qui a du flair, il sait de quel côté penche le rapport de forces et où il faut se placer », estime un observateur averti des relations franco-africaines.
Le changement dans la continuité
« Ce qui est bon pour la France est bon pour l’Afrique » : cette maxime attribuée à Jacques Foccart, Jean-Marc Simon en a fait son viatique. Dans son livre, il assume tout. Le Rwanda ? La France n’a fait que soutenir un gouvernement légal et œuvrer pour la paix… Le soutien indéfectible à Bongo malgré la corruption ? « On a souvent reproché à Omar Bongo et à sa famille d’avoir des intérêts personnels dans de nombreuses affaires, sociétés ou banques locales, mais n’était-ce pas aussi un moyen de participer au développement du pays et cela ne valait-il pas mieux que l’attitude de certains dirigeants qui investissent leur fortune à l’étranger ? », écrit-il, faussement candide.
Au beau milieu de ses Mémoires, pauvres en révélations en dépit du titre alléchant, l’ambassadeur publie aussi des photos retraçant sa longue carrière. Sur la première d’entre elles, il est décoré par Hissène Habré. C’était il y a trente ans, à N’Djamena. Le mois dernier, l’ancien dictateur du Tchad, chassé du pouvoir en 1990 par Idriss Déby, a été condamné à la réclusion à perpétuité par les Chambres africaines extraordinaires, à Dakar, pour les violations massives des droits de l’homme commises sous son règne. Mais Jean-Marc Simon lui voue toujours une « certaine admiration » : « Il a fait la guerre, mais c’était un homme intègre qui avait une bonne formation intellectuelle et le sens de l’Etat. » Les crimes abominables commis sous son autorité ? « On savait que cela existait, répond-il, mais on n’en parlait pas. Ce n’était pas un sujet pas à l’époque. »
Cela l’est devenu depuis, sous la pression d’une société civile qui, sur le continent, se mobilise de plus en plus. Mais visiblement pas pour l’ambassadeur Jean-Marc Simon, un homme formé au siècle dernier, à l’époque de la guerre froide, où Paris avait les yeux rivés sur Kadhafi plutôt que sur les exactions perpétrées par un régime « ami ». Les choses ont-elles véritablement changé ? « Durant ma carrière en Afrique, quatre présidents se sont succédé à l’Elysée. Chacun d’entre eux a annoncé la rupture dans notre politique vis-à-vis du continent, mais la réalité a toujours fini par s’imposer, autrement dit la continuité », lâche-t-il, goguenard.
Thomas Hofnung, ancien journaliste chargé de l’Afrique et des questions de défense à Libération, est chef de rubrique à TheConversation.fr. Il est l’auteur de La Crise ivoirienne (éd. La Découverte, 2011).