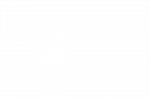« En Russie, il faut interrompre la transmission du VIH chez les usagers de drogue »

« En Russie, il faut interrompre la transmission du VIH chez les usagers de drogue »
Par Paul Benkimoun
Le directeur du Centre fédéral russe de lutte contre le sida appelle les autorités à favoriser les traitements de substitution plutôt que le sevrage.
Vadim Pokrovsky, directeur du Centre fédéral russe de lutte contre le sida, lors de la conférence mondiale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud, le 19 juillet. | Marcus Rose / Marcus Rose
Partout dans le monde, le nombre de nouvelles infections par le VIH diminue ou demeure stable. Seule exception, la région Europe orientale et Asie centrale voit le sien continuer de croître : l’augmentation a été de 57 % entre 2010 et 2015, avance le Programme commun des Nations unies contre le VIH-sida (Onusida), alors que se tient du 18 au 22 juillet à Durban (Afrique du Sud) une conférence mondiale sur le sida. Deux pays de la région concentrent 85 % de cet accroissement : la Fédération de Russie et l’Ukraine. Le nombre de morts dans la région s’est accru de 22 % entre 2010 et 2015.
A la différence des autres parties du monde, la moitié des nouvelles infections a lieu chez des usagers de drogue injectable, et un tiers chez leurs partenaires ou chez des clients de prostituées. Pourtant, la Russie se refuse à développer les programmes de réduction des risques chez les usagers de drogue injectable, contrairement aux vœux de Vadim Pokrovsky, directeur du Centre fédéral russe de lutte contre le sida, présent à la conférence de Durban. Il exprime en termes mesurés le besoin d’un changement radical de politique.
Où en est l’épidémie d’infection par le VIH en Russie ?
Vadim Pokrovsky : Nous connaissons une augmentation des cas, même si une détection renforcée peut y contribuer : nous avons dépassé le million d’infections et avons enregistré 100 000 nouveaux cas en 2015, dont 56 % chez des usagers de drogue injectable. L’injection de drogue est la principale voie de transmission. Etre efficace implique d’interrompre la transmission du VIH parmi les usagers de drogue.
Comment y parvenir si la politique officielle en Russie s’oppose toujours à la réduction des risques chez les usagers de drogue injectable ?
La politique de traitement de la toxicomanie, qui vise au sevrage de la drogue, n’est pas très efficace. Impossible de s’attendre à ce que tous les usagers qui s’injectent de la drogue y souscrivent et arrêtent les injections. Nous savons que le VIH se transmet par les seringues et les aiguilles. Il faut donc changer la voie d’administration du produit. C’est possible avec différents opiacés de substitution comme la méthadone, la buprénorphine ou la morphine, qui sont pris par voie orale. S’il n’y a pas d’injection, il n’y a pas de transmission.
Nous avons vu les résultats obtenus dans les pays comme l’Espagne, les Pays-Bas ou la France, qui ont mis en place des programmes de substitution : ils ont obtenu durablement des taux très faibles d’infection parmi les usagers de drogue injectable. Mais nos décideurs estiment qu’il vaut mieux traiter l’usage de drogue en vue du sevrage que de donner gratuitement de la méthadone. C’est le principal point de discussion avec eux.
Je crains fortement que si nous ne parvenons pas à arrêter l’épidémie chez les usagers de drogue, celle-ci se répande dans le reste de la population. Déjà, nous avons de nombreuses infections lors de rapports hétérosexuels avec des usagers de drogue : 42 % des nouvelles infections ont lieu en Russie chez des personnes qui ne consomment pas de drogue mais sont les partenaires sexuels d’une personne qui s’injecte un produit.
Quels sont les arguments opposés à la mise en place de programmes de réduction des risques par la substitution ?
Généralement, l’argument est de ne pas remplacer une dépendance par une autre. Mais, entre une dépendance qui est responsable de la transmission du VIH et une dépendance qui ne l’est pas… Nos dirigeants estiment que la meilleure stratégie est de détecter et mettre immédiatement sous traitement les personnes séropositives, car celui-ci permet aussi de protéger les partenaires [ce qu’on appelle « traitement comme prévention » ou TASP].
S’y ajoutent les coûts d’une politique de réduction des risques – certains estimant que les usagers de drogue ne méritent pas qu’on dépense l’argent public pour eux – et les difficultés à travailler avec ce public. Il y a des obstacles culturels. Certains pensent ainsi que l’éducation religieuse est plus efficace que l’éducation sexuelle pour éviter la transmission du VIH…
Les usagers de drogue viennent-ils dans les structures de santé ?
Ils sont réticents. Si l’on vient dans une structure publique et que l’on s’identifie comme usager de drogue, l’équipe soignante est tenue de transmettre cette information aux autorités sanitaires. Les usagers de drogue craignent donc d’être pénalisés dans la recherche d’un emploi, de se voir interdits de conduire un véhicule… Si les centres médicaux proposaient de suivre un programme méthadone et pas uniquement un traitement de sevrage, ils seraient plus attractifs.
Cette population de personnes séropositives est-elle constituée de marginaux ?
Nous avons mené une étude l’an dernier auprès de 7 000 personnes vivant avec le VIH. Elle montre que 60 % d’entre elles travaillent et que 10 % font des études. Ce sont des gens économiquement actifs. Ce serait une grande erreur de négliger ces personnes. Nous avons présenté ces résultats au ministre de la santé. Il est d’avis qu’il faut faire quelque chose, mais n’a pas encore décidé quoi.
Pensez-vous qu’il soit possible de mettre en place des programmes de substitution pour réduire les risques au niveau de certaines municipalités ou régions, sans que cela soit la politique fédérale ?
C’est la tradition russe, que la politique soit décidée au sommet et chemine du haut vers le bas. Nos décideurs sont ceux qui forment l’opinion. A l’échelon intermédiaire, il y a des gens qui comprennent l’importance d’être efficaces, mais qui ne savent pas comment cela doit se traduire concrètement. Je reste optimiste, car le seul chemin pour interrompre la transmission du VIH chez les usagers de drogue injectable est de créer des programmes de substitution pour réduire les risques.