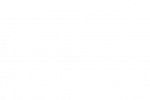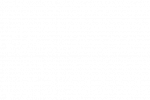Déchéance de nationalité : comment François Hollande s’est condamné à renoncer

Déchéance de nationalité : comment François Hollande s’est condamné à renoncer
Par David Revault d'Allonnes
L’abandon de la révision constitutionnelle par le chef de l’Etat mercredi illustre sa perte d’autorité. Un cruel aveu de faiblesse politique.
C’est sous les ors du salon Napoléon-III de l’Elysée que François Hollande, dans une allocution télévisée voulue courte et solennelle, a dû se résoudre à jeter la dernière pelletée de terre sur la réforme constitutionnelle qu’il avait annoncée dans son discours au Congrès réuni à Versailles le 16 novembre. Et, du même coup, sur une partie de ses attributs présidentiels. « J’ai décidé (…) de clore le débat constitutionnel », a abdiqué peu après midi le chef de l’Etat, qui avait reçu un peu plus tôt dans la matinée les présidents de l’Assemblée et du Sénat, Claude Bartolone et Gérard Larcher. Et constaté avec eux l’impossibilité de trouver une voie de conciliation entre les deux textes votés, d’une part par la majorité de gauche du Palais-Bourbon, de l’autre par la majorité de droite du Palais du Luxembourg.
Il n’y aura donc ni Congrès ni révision constitutionnelle pour François Hollande. Cruel aveu de faiblesse politique, cuisante démonstration d’impuissance présidentielle. Condamné à renoncer, il a dû procéder en personne à l’enterrement d’une réforme engagée il y a plus de quatre mois, au lendemain des attentats du 13 novembre. Quatre interminables mois de ping-pong entre Assemblées, de positionnements tactiques autant qu’idéologiques à droite comme à gauche, et de débats qui, paradoxalement, ont laissé de marbre une opinion pourtant très majoritairement favorable à la mesure la plus contestée, contenue dans l’article 2 : celle étendant la déchéance de nationalité aux binationaux nés français.
Cette sortie, ou plutôt cette voie sans issue, bien sûr, était prévisible. Même si M. Hollande, en cette fin de quinquennat, dédaigne de moins en moins de jouer de l’effet de surprise, dont il aura usé tout au long de la sinueuse trajectoire de ce texte. D’abord, en dégainant devant le Congrès, le 16 novembre, cette disposition empruntée à l’extrême droite et à la droite, dans le même mouvement qu’une révision constitutionnelle. Puis en la maintenant, le 23 décembre, contre toute attente et contre la volonté de sa ministre de la justice d’alors, Christiane Taubira, et d’une partie de sa majorité, crispée par une transgression considérée comme majeure. Mais abandonner était devenu une nécessité.
Rapport de force historiquement bas
De bonne guerre après cette retraite en rase campagne, M. Hollande a tenté d’habiller sa défaite en endossant la position régalienne et sécuritaire, la seule au fond qui lui ait véritablement réussi dans ce quinquennat devant l’opinion : « Je ne dévierai pas des engagements que j’ai pris (…) pour assurer la sécurité de notre pays. »
Mais l’uniforme du chef de guerre ne peut plus camoufler ce que révèle cet épisode : le rapport de force historiquement bas dont doit désormais s’accommoder le chef de l’Etat. François Hollande n’est certes pas le premier président à n’être pas en mesure de rassembler un Congrès sur une réforme. Mais il réussit là à ne pas être en capacité de faire voter par la droite une mesure pourtant tirée de ses propositions, après avoir déchiré la gauche, non plus sur le seul terrain économique et social cette fois, mais sur celui, infiniment plus déstabilisant, des « valeurs ». Un conseiller du président doit en convenir : « C’est un échec, bien sûr. Quand un président présente une révision constitutionnelle et qu’au bout de quatre mois la révision est abandonnée, vous ne pouvez pas expliquer que c’est une victoire. »
Mais que diable était-il allé faire dans cette affaire ? La genèse de cette piteuse opération remonte aux premières heures de l’après-13 novembre, au sommet d’un exécutif en état de tétanie. Les scénarios du pire y sont alors envisagés : de nouveaux attentats, une « déferlante du FN » et un enchaînement de violences. Un conseiller résume :
« La question, c’était : Comment le pays résiste à des chocs à répétition, comment on arrive à faire corps ? Et comment le président continue à être audible dans tout ceci ? Il a donc accepté, pour que sa voix continue à porter en période de tempête, de prendre des symboles qui ne faisaient pas partie de sa culture politique. »
« Ça a été une erreur d’analyse »
François Hollande en était persuadé : la déchéance de nationalité, qui n’avait initialement suscité que peu de réticences au Parti socialiste avant de rencontrer peu à peu de plus en plus de réticences, serait rapidement digérée par son camp, avec la pression de l’opinion. Il n’en a rien été. « Ça a été une erreur d’analyse », concède un de ses conseillers. Le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation, en quelques semaines, aura déchiré son gouvernement et sa majorité. Et ce, de manière bien plus sûre et profonde que les textes économiques qui avaient suscité l’ire des frondeurs socialistes.
Quant à la droite, nonobstant l’effet de souffle des attentats du 13 novembre et l’union sacrée qu’ambitionnait de construire un président alors porté par un regain de crédibilité dans l’opinion, la compétition interne en vue de la primaire et la volonté de ne pas faire de cadeau politique à M. Hollande, à un peu plus d’un an de la présidentielle, l’a emporté. L’impossibilité était à la fois tactique et idéologique. Entre la majorité des députés de gauche, qui refusait de distinguer les binationaux du reste de la nation, et celle des sénateurs de droite, rétive à la création d’apatrides, il s’avérait impossible de faire voter le texte dans les mêmes termes, puis par les trois cinquièmes des parlementaires réunis en Congrès.
La synthèse, pour une fois, était impossible. Et François Hollande a immédiatement engagé la bataille sur la responsabilité de l’échec en faisant peser celui-ci sur la droite : « Je constate aussi qu’une partie de l’opposition est hostile à toute révision constitutionnelle, qu’elle porte sur l’état d’urgence ou même sur l’indépendance de la magistrature, je déplore profondément cette attitude. » Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, dans le même mouvement, accusait la droite de « dérobade », alors que le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, tempêtait : « Chacun pourra juger de la sincérité, de l’engagement des uns des autres. »
Proche de la paralysie politique
Mais cette tentative de contre-offensive n’a que peu pesé face au feu nourri et à la quasi unanimité qu’a fait contre lui, dans la classe politique, le président. Les attaques, à peine l’abandon officialisé par le chef de l’Etat, ont plu sur lui. De toutes parts. Venant du Front national, bien sûr. De la droite, fort logiquement. « Nous sommes au cœur du système de M. Hollande. A force de promettre tout et le contraire de tout, (…) il condamne le pays à un blocage et à de l’immobilisme », a fustigé Nicolas Sarkozy, alors que François Fillon s’est « félicité de l’abandon de ce projet inutile ». Quant au chef de file des frondeurs du PS, le député Christian Paul, il a dénoncé un « fiasco politique » et « quatre mois de controverse infernale » : « Le pays en sort divisé et la gauche terriblement affaiblie. »
C’est cependant surtout l’état politique du président qui, à ce stade, inquiète. Jamais M. Hollande n’avait semblé si proche de la paralysie politique. Au point de désespérer jusqu’à son premier cercle, déjà catastrophé par les mésaventures du projet de loi El Khomri, l’échec du remaniement et le rejet massif de l’opinion exprimé dans les sondages. « Il faut que les gens, à gauche, arrêtent de dire qu’on est mort en 2017 ou qu’on a trahi. Il faut arriver à restabiliser la situation, sortir de cette espèce de tempête permanente », préconise un membre du premier cercle, et dont le projet politique, pour sauver un président en état d’urgence, se résume à ceci : « On a trois mois pour convaincre les gens que l’échec n’est pas totalement inéluctable. » Vaste programme.
Abandon de la réforme de la Constitution : « Une démonstration de l’impuissance » du président
Durée : 03:39
Images :
Le Monde.fr / Donald Walther