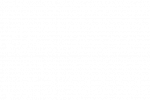Revers en série pour la gauche en Amérique latine

Revers en série pour la gauche en Amérique latine
Par Anne-Aël Durand
La destitution de Dilma Rousseff au Brésil et les manifestations contre le chavisme à Caracas sont deux nouveaux coups durs d’une longue série dans le sous-continent.
Manifestation contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro, le 1er septembre à Caracas (Venezuela). | Fernando Llano / AP
En votant la destitution de Dilma Rousseff mercredi 31 août, les sénateurs brésiliens ont mis fin à treize ans de pouvoir du Parti des travailleurs au Brésil. Le lendemain, au Venezuela, un million de personnes défilaient contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. Dans le reste de l’Amérique latine (Argentine, Bolivie…), la gauche qui était au pouvoir accumule les revers. Comment expliquer cet effondrement ?
« Virage à gauche » entamé au Venezuela et au Brésil
Se réclamant de Simon Bolivar, symbole de l’indépendance de l’Amérique latine, et du Cubain Fidel Castro, Hugo Chavez arrive au pouvoir par les urnes en décembre 1998. Nationalisations, programmes sociaux… son ambition d’instaurer au Venezuela le « socialisme du XXIe siècle » secoue l’Amérique latine.
Quatre ans plus tard, deuxième surprise : un ancien syndicaliste ouvrier, Luis Inacio Lula da Silva, est élu en 2002 au Brésil, sur la promesse d’une meilleure redistribution des richesses du pays. Laminée par la crise financière, l’Argentine bascule à son tour en 2003, en élisant Nestor Kirchner.
La vague se poursuit au cours de la décennie : Evo Morales en Bolivie (2005), Michelle Bachelet au Chili (2006), Daniel Ortega au Nicaragua (2006), Alan Garcia au Pérou (2006), Rafael Correa en Equateur (2007), Fernando Lugo au Paraguay (2008)… dans un mouvement loin d’être homogène. « Il faudrait mettre un "s" à gauche, car il y a de grandes différences et parfois de fortes tensions, entre ces différents régimes, nuance Olivier Compagnon, directeur de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. Deuxièmement, il n’est pas certain que toutes les politiques aient été de gauche. Ainsi, si Lula est parvenu à faire sortir 35 millions de personnes de la pauvreté, il n’a pas remis en cause le modèle libéral. »
Alternances, échecs électoraux et destitution
Au fil des années, les leaders de gauche accroissent leur mainmise en Amérique latine. Ils sont réélus (Correa, Morales) ou négocient leur succession : Cristina Kirchner remplace son mari en 2007, Dilma Rousseff prend la suite de Lula en 2010, Hugo Chavez désigne son successeur, Nicolas Maduro, avant sa mort en 2013.
Le premier coup d’arrêt électoral intervient en Argentine en novembre 2015, avec l’élection inattendue à la présidence argentine du libéral Mauricio Macri, qui met fin à douze ans de pouvoir du clan Kirchner, en promettant du « changement » et le retour d’un programme néolibéral.
Le 6 décembre 2015, au Venezuela, Nicolas Maduro, successeur de Chavez, subit une sévère déroute électorale aux législatives. L’opposition réunie dans le mouvement de la « Table de l’unité démocratique » emporte 99 des 167 sièges à l’assemblée, ne laissant que quelques dizaines de députés chavistes. Le 1er septembre dernier, l’opposition fait une démonstration de force à Caracas, en réclamant un référendum pour révoquer le président.
En février 2016, en Bolivie, Evo Morales essuie lui aussi son premier revers. Les électeurs refusent que la Constitution soit changée pour permettre au président, au pouvoir depuis dix ans, de solliciter un quatrième mandat.
Parallèlement, au Brésil, le scandale de corruption lié au groupe pétrolier Petrobras, révélé en 2014, éclabousse la coalition au pouvoir. En décembre 2015, une procédure de destitution est lancée contre Dilma Rousseff. Lâchée par ses alliés, elle est écartée du pouvoir provisoirement en mai, puis définitivement par un vote du Sénat le 31 août, et remplacée par Michel Temer. Un coup de tonnerre qui laisse le Parti des travailleurs exsangue.
Ailleurs, les prochaines échéances électorales sont périlleuses : au Chili, Michelle Bachelet, dont la cote de popularité est en berne, a annoncé qu’elle ne se représenterait pas en 2018, Rafael Correa jette aussi l’éponge pour 2017 en Equateur.
Victimes de la crise économique
Ces effondrements électoraux successifs sont d’abord liés à la crise économique qui frappe d’Amérique latine, restée très dépendante de l’exportation des matières premières. « Le virage à gauche s’est traduit par des politiques de redistribution sociale massives s’appuyant sur un contexte de croissance, explique Olivier Compagnon. Mais les Etats n’ont pas su réformer leur économie et la diversifier. Il y a un synchronisme frappant entre la chute des matières premières – pétrole, sucre, soja, gaz – et les difficultés politiques. »
L’exemple le plus flagrant est le Venezuela. Le pays, dont l’économie repose à 95 % sur le pétrole, a pu financer ses populaires « misiones », programmes de santé ou d’alphabétisation des quartiers, lorsque le baril dépassait les 100 dollars – or il n’en vaut plus que 40 dollars. Soumis à une forte inflation, le Venezuela peine à importer les biens de première nécessité et a décrété en janvier l’état « d’urgence économique ». De quoi alimenter une forte impopularité du pouvoir.
Certains gouvernements d’Amérique latine ont aussi été victimes de l’usure du pouvoir et des difficultés à renouveler les équipes dirigeantes. « En Argentine, le kirchnérisme a été dans l’incapacité de faire émerger des successeurs crédibles. C’est aussi vrai en Equateur ou en Bolivie. Ces régimes sont assez personnalisés et ne reposent pas sur des partis solides mais sur des coalitions d’intérêts », analyse Olivier Compagnon.
Une alternative encore floue
Si les gouvernements de gauche peuvent être crédités d’avoir réduit la pauvreté et les inégalités, les politiques redistributives sont très dépendantes de la conjoncture. Même avant sa destitution, Dilma Rousseff avait pris le tournant de la rigueur. En Argentine, le programme de Mauricio Macri, d’inspiration néolibérale, risque de remettre à plat la politique sociale.
Sur le plan politique, les contours de l’alternance sont difficiles à définir. Les coalitions sont hétérogènes : au Venezuela où la « table de l’unité démocratique » agrège différents partis, de la droite à l’extrême gauche, qui s’unissent dans la dénonciation de Nicolas Maduro, mais ne forment pas un ensemble cohérent.
Olivier Compagnon évoque une inquiétude plus large : « Quelles seront les conséquences sur l’état des démocraties latino-américaines ? Aujourd’hui, on peut légitimement se demander où va la dérive autoritaire de Nicolas Maduro au Venezuela et comment le “coup d’état parlementaire” qui vient de se produire au Brésil fragilise ou pas cette jeune démocratie. »