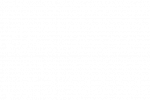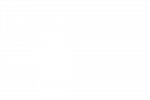A Haïfa, le Technion attire toujours plus d’étudiants français

A Haïfa, le Technion attire toujours plus d’étudiants français
Par Marine Miller
Attirés par sa réputation scientifique ou par une émigration durable en Israël, de plus en plus d’étudiants français rejoignent le Technion, l’institut technologique de Haïfa.
A Haïfa, sur les pentes luxuriantes du mont Carmel, le campus du Technion semble désert. Pourtant, c’est ici que bat le cœur scientifique de la « Silicon Wadi », la Silicon Valley israélienne. « 1 600 start-up sont sorties du Technion ces vingt dernières années, 811 sont encore actives et 296 ont été rachetées ou fusionnées », décompte Moshe Sidi, vice-président de l’université. Parmi les succès les plus connus : la clé USB, un médicament contre la maladie de Parkinson ou Rewalk, un robot pour aider les paraplégiques à marcher à nouveau.
Créé en 1912 dans la Palestine de l’Empire ottoman, le Technion est d’abord conçu pour former des ingénieurs capables de construire les infrastructures d’Israël. Aujourd’hui, l’institut technologique est devenu un centre de recherche et d’innovation qui rivalise avec le célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT), à tel point que la formule « MIT du Moyen-Orient » est régulièrement utilisée pour désigner le Technion.
Si le campus semble désert en cet été 2016, ce n’est pas seulement à cause de la chaleur écrasante ou des examens, c’est parce que le secret de sa réussite se niche d’abord dans ses laboratoires. Morgan, Jeffrey, Coralie et David, quatre chercheurs en contrat post-doctoraux et en thèse, ont été recrutés par le professeur de chimie Ilan Marek. Ces quatre étudiants français et belges n’en doutent pas : pour eux, le laboratoire du chercheur franco-israélien est « l’un des meilleurs au monde ».
Morgan, 27 ans, indique avoir envoyé plusieurs candidatures de post-doctorat aux laboratoires de chimie les plus réputés. « Celui du Technion était dans mon top 3, avec celui de l’université Saint Andrews en Ecosse », précise le jeune homme. Jeffrey, étudiant belge en thèse, explique avoir quitté l’Europe pour faire « une chimie très spécifique dans un endroit exotique ». Mais aussi pour les moyens qui sont déployés dans les laboratoires de l’institution de Haïfa. « La Belgique, qui n’est pas un pays pauvre, n’a pourtant clairement pas les mêmes moyens financiers que le Technion », estime le thésard. Un argument convaincant pour ces jeunes chercheurs en chimie, qui ont besoin d’un matériel de pointe très coûteux.
En quête d’excellence
Depuis quelques années, sur le marché des étudiants internationaux, le Technion concurrence directement les plus grandes universités mondiales. « Nous avons aujourd’hui 1 200 étudiants internationaux sur 14 000 étudiants, soit 30 % de plus qu’il y a sept ans », explique Muriel Touaty, représentante du Technion en France. Illustration par l’exemple dans le laboratoire du chimiste Ilan Marek : sur seize chercheurs, quatre sont israéliens (dont deux Arabes israéliens), un est belge, trois sont indiens, trois chinois, trois français et deux allemands.
« Il y a encore quelques blocages qui agissent sur les étudiants plus jeunes – comme le fait qu’Israël est perçu comme un pays à risques géopolitiques et que c’est un Etat juif, explique Sébastien Linden, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France en Israël. Mais ces freins ne rentrent absolument pas en considération pour le choix des étudiants en doctorat ou post-doctorat. C’est la logique de la recherche mondialisée qui prévaut, celle de la compétition pour entrer dans les meilleurs laboratoires. » D’autant que, selon lui, le Technion, comme le MIT, « jouit d’une reconnaissance institutionnelle immédiate dans le milieu de la recherche et de l’innovation ».
Pour être compétitive, l’université a organisé ses laboratoires sur le modèle américain. « Les labos fonctionnent comme des start-up », explique Ilan Marek. « Après le stage post-doctoral, lorsque le chercheur est embauché par le Technion, il reçoit un laboratoire rénové qui peut coûter de 300 000 à 600 000 euros, et une somme d’argent qui permet d’acheter tout un équipement et de commencer une recherche en incluant les salaires des premiers doctorants ou des post-docs. » Cette somme d’argent, qui s’appelle « Start-up Money » ou encore « Seed-Money » (capital d’amorçage), est variable en fonction des disciplines mais peut atteindre 1,5 million d’euros, voire plus dans certains cas, selon le chercheur.
En plus des jeunes chercheurs en quête d’un post-doc dans un laboratoire prestigieux, les étudiants des écoles d’ingénieurs françaises ont depuis quelques années la possibilité de faire une partie de leurs études au Technion grâce à des accords de coopération. « De Polytechnique à l’Institut Mines Télécom, Paris Sciences Lettres, Paristech et des universités telles que Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Strasbourg, les accords de coopération avec le Technion sont passés de 0 à 30 en 10 ans », détaille Muriel Touaty. Ce qui répond à une volonté explicite de multiplier les liens avec « les institutions d’excellence françaises », selon Moshe Sidi.
Eva, 22 ans, étudiante ingénieure en 4e année à l’école Polytechnique, a choisi de poursuivre un master en sciences des matériaux au Technion. « J’étais curieuse de découvrir la start-up Nation et de vivre une expérience à l’étranger dans un établissement qui est à la pointe du domaine qui m’intéresse. » La jeune fille, qui estime « posséder une solide culture générale scientifique », a dû néanmoins se remettre rapidement au niveau des étudiants du Technion, qui suivent les cours de science des matériaux depuis quatre ans.
En quête de racines
Si ces étudiants venus des grandes écoles d’ingénieurs ou ces jeunes docteurs en quête d’un post-doc prestigieux sont attirés par la réputation des chercheurs du Technion, Israël attire aussi une autre catégorie d’étudiants, ceux qui effectuent leur « alya » (immigration des juifs en Israël).
Yoni, 23 ans, vient ainsi d’intégrer le département de génie civil après une année de préparation au Technion. « J’ai quitté la France à 19 ans avec un bac scientifique sans mention. Je voulais faire mon alya et commencer des études en Israël. En faisant des simulations, j’ai très vite compris que je n’avais pas le niveau pour entrer directement au Technion. » L’exigence académique au Technion est élevée et ceux qui n’ont pas les notes suffisantes au bac ou aux tests psychométriques doivent passer par une année de remise à niveau.
Direction Tsahal, l’armée israélienne, pour Yoni. Outre la formation militaire, il apprend l’hébreu et les fondements de la culture israélienne. « J’ai appris beaucoup de choses à l’armée, et déjà à me détacher de la culture française. Ici, les rapports à la politesse, au formalisme et à la hiérarchie sont totalement différents de nos standards français. »
Alexandre, 27 ans, aurait pu intégrer une classe prépa scientifique en France et passer les concours des écoles d’ingénieur après avoir obtenu son bac S en 2006 avec mention très bien. Au lieu de suivre ce chemin qui lui semblait déjà tracé, il décide alors de partir un an en Israël, « pour voir si ça lui plaît ». Eduqué dans une école juive parisienne, il poursuit ses études dans une yeshiva, un centre d’étude talmudique, à Jérusalem pendant un an. Puis il est admis au Technion sans faire l’armée en raison de sa surdité.
Sébastien Linden, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France en Israël
« Je me sens bien à ma place ici. La mentalité me correspond. Les Israéliens ne sont pas pressés de faire des études et d’entrer dans une carrière. Ils font l’armée, voyagent, trouvent un travail, se lancent dans les études et font un autre métier », raconte l’étudiant français en génie biomédical. « J’ai l’impression que ce que l’on construit ici au Technion participe à la vie du pays. La France est une nation déjà construite dans laquelle il faut trouver, puis conserver sa place toute sa vie », conclut Alexandre, qui semble ne plus vouloir rentrer en France.
Prendre son temps, « digérer » les années d’armée (36 mois pour les garçons et 24 mois pour les filles), voyager, grandir et se lancer enfin dans les études. « L’enseignement supérieur israélien est adapté à la sociologie de ses étudiants, qui sont plus matures et plus motivés », analyse Moshe Sidi. Un modèle d’enseignement et de recherche qui séduit aussi de plus en plus d’institutions. « Il y a un intérêt croissant des établissements français à venir en Israël, Polytechnique, Sciences Po, HEC, l’ESCP et désormais les universités nouent des partenariats avec les universités israéliennes, ce qui montre que la tendance va se poursuivre », souligne Sébastien Linden.