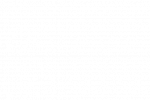Jens Weidmann (Bundesbank) : « Si les taux remontent, les dettes ne seront plus supportables »

Jens Weidmann (Bundesbank) : « Si les taux remontent, les dettes ne seront plus supportables »
LE MONDE ECONOMIE
Président de la Bundesbank depuis 2011, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), Jens Weidmann a reçu, à Francfort, les journaux du réseau Europa, « Le Monde », « La Stampa », « Süddeutsche Zeitung » et « The Guardian ».
Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, à Francfort, en avril. | DANIEL ROLAND / AFP
Dans l’entretien qu’il a accordé aux journaux du réseau Europa, dont Le Monde, Jens Weidmann, le président de la banque centrale allemande, évoque la crise que traverse l’Europe et les « erreurs » faites lors de la création de l’euro, exprime son scepticisme au sujet d’un renforcement de l’union politique, évoque la politique monétaire de la BCE et le rôle, excessif que l’on fait jouer, selon lui, aux banques centrales, il revient, enfin, sur le « Brexit ».
Selon le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l’Union européenne traverse « une crise existentielle ». Partagez-vous la même inquiétude ?
Beaucoup de citoyens estiment que l’Europe a perdu de sa puissance de rayonnement, et ils projettent sur elle les côtés sombres de la mondialisation et des migrations. Par ailleurs, le discours traditionnel des institutions européennes, selon lequel c’est en donnant plus de pouvoir à Bruxelles et en allant plus loin dans l’intégration que l’on résoudra les crises, ce discours-là ne convainc plus. L’intégration n’est pas un but en soi. Il faut lui donner du sens.
Rétrospectivement, la création de l’euro a-t-elle été une erreur ?
Non, mais au moment de sa création comme après, des erreurs ont été faites, à la fois dans les Etats-membres et dans l’organisation même de l’union monétaire. A l’époque, la Bundesbank avait signalé que toutes les conditions pour une union monétaire stable n’étaient pas remplies. Elle avait souligné à quel point il était important que les Etats-membres conduisent une solide politique budgétaire et que les économies soient structurellement compétitives. Depuis la crise, on a essayé de corriger ces erreurs, avec plus ou moins de succès.
Le président de la BCE, Mario Draghi, veut une union politique…
Avant la création de l’union monétaire, Helmut Kohl disait déjà qu’il fallait la compléter par une union politique. Cela supposerait que les Etats délèguent leurs droits souverains au niveau européen, en particulier ce qui est au cœur du pouvoir des parlements : le vote du budget. Je ne sens pas à l’heure actuelle une volonté de franchir ce pas. Au contraire, dans la dernière période, les marges de manœuvre de chacun ont plutôt été renforcées. Les gouvernements et les parlements nationaux ne veulent pas que Bruxelles s’immisce dans leurs affaires. Cela vaut en particulier pour les règles budgétaires de l’UE, qui sont de plus en plus remises en question.
D’un côté, la France, l’Espagne et le Portugal dépensent plus qu’ils ne doivent. D’un autre, les taux sont de plus en plus bas. A quel moment les Etats devraient-ils dépenser, si ce n’est pas maintenant ?
En Europe, il n’y a pas un manque de dettes, il y en a trop. Et les taux bas fragilisent la discipline budgétaire. L’accumulation des dettes peut devenir un problème, si les taux remontent. Ce jour-là, les dettes ne seront plus supportables.
Beaucoup de citoyens réclament la fin de l’austérité…
La vraie austérité n’existe que dans très peu de pays. La France ou l’Espagne, avec leur politique budgétaire, sont depuis des années au-delà des limites du Pacte de stabilité. En Italie, le déficit n’a fini par reculer que parce qu’il y avait moins d’intérêts à rembourser. Et en Allemagne, l’équilibre budgétaire a été facilité par la baisse des taux.
Beaucoup souhaitent que le gouvernement allemand investisse davantage pour l’Europe…
Pour moi, il est naïf de croire que l’Allemagne pourrait soutenir la conjoncture en Europe grâce à un programme d’investissements. D’abord, parce qu’en matière économique les effets de contagion d’un pays à l’autre sont très limités, comme le montrent nos calculs et ceux des autres économistes. Ensuite, parce que ce qui est déterminant pour la croissance d’un pays, c’est d’abord sa situation propre. Je ne parle pas ici seulement des rues et des ponts, mais de facteurs au moins aussi importants tels qu’une administration qui fonctionne, une justice efficace et un niveau d’éducation élevé.
La BCE va intervenir sur les marchés financiers à hauteur de 80 milliards d’euros par mois jusqu’en mars 2017. Doit-elle prolonger ce programme de rachats de titres, vu que l’inflation est toujours aussi faible ?
Lors de sa dernière réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE a débattu des nouvelles prévisions. Puisque les perspectives d’inflation ont à peine changé, il a considéré, à juste titre, qu’il n’y avait pas matière à modifier la politique monétaire.
La BCE doit-elle achever son programme en mars pour ensuite monter les taux sans tarder, ou bien souhaitez-vous une remontée progressive afin de ne pas affoler les marchés financiers ?
Il a été décidé que le programme de rachat de titres irait au moins jusqu’en mars 2017. Pour la suite, il nous reviendra, au sein du conseil des gouverneurs, de prendre des décisions en fonction des données dont nous disposerons à ce moment-là. A cet égard, nous ne devons pas ignorer les risques d’une politique monétaire ultra-restrictive, qui sont d’autant plus importants que se prolonge la phase des taux bas. Les éventuels problèmes de telle institution financière ou de tel budget national ne doivent pas nous empêcher de normaliser la politique monétaire, tant que c’est nécessaire.
La BCE est responsable de la politique monétaire et de la supervision bancaire. Y-a-t-il un risque de conflit entre les deux objectifs ?
A mes yeux, ce danger existe. C’est pourquoi je plaide, comme le ministre allemand des finances, pour que l’on sépare clairement les deux fonctions. Mais cela suppose une modification des traités européens, ce qui n’est pas réaliste aujourd’hui.
Y a-t-il trop de banques en Europe ?
Sur quelques marchés, une consolidation présenterait des avantages. Comme superviseurs, cependant, nous ne pouvons ni ne devons organiser les choses. Nous ne sommes pas des planificateurs, et ce n’est pas nous qui pilotons la politique industrielle.
Les négociations concernant le Brexit traînent en longueur. En quoi est-ce un problème ?
Le fait de ne pas savoir quand et dans quelles conditions va se faire la séparation pèse sur l’économie, c’est indéniable. C’est pourquoi il faut que les choses soient claires le plus vite possible. En même temps, la sortie d’un pays de l’UE est une première qui nécessite des discussions complexes, et c’est l’intérêt de tout le monde qu’elles se passent bien. L’Europe ne doit ni faire un exemple ni créer un précédent laissant croire qu’un pays peut bénéficier d’avantages à la carte.
En Grande-Bretagne, beaucoup remarquent que le Brexit n’a pour l’instant engendré aucune catastrophe.
La Grande-Bretagne n’a pas encore déclenché le processus qui doit conduire à sa sortie. Ce n’est pas parce que la réaction a été modérée après le référendum que la sortie n’aura pas de conséquences négatives. La Grande-Bretagne est très liée économiquement à l’UE et à l’Allemagne, l’UE est son principal partenaire commercial. Si on complique l’accès au marché des deux côtés, la croissance va s’en trouver affectée, en particulier en Grande-Bretagne.
Quand Londres quittera l’UE, les Britanniques pourront-ils garder le passeport européen ?
Le passeport européen est lié au marché intérieur et tombe automatiquement à partir du moment où la Grande-Bretagne n’appartient plus à l’espace économique européen. Cela aura sans doute un effet décisif sur l’avenir de la City.
Le Brexit est-il une chance pour Francfort ?
Il est certain que certains patrons vont reconsidérer le lieu de leur siège social. Francfort est un centre financier majeur, le siège d’importantes autorités de régulation et de supervision, et elle sait accueillir les nouveaux venus. Je ne crois pas cependant à une migration en masse de Londres vers Francfort.
Comment votre travail de banquier central a évolué ces dix dernières années ? Est-il devenu plus difficile ?
Le rôle et la perception des banques centrales ont peu à peu changé en dix années de crise. On attend beaucoup des banques centrales. Cela m’inquiète, car la BCE ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Pourquoi ?
On considère que les banques centrales peuvent résoudre des problèmes qui vont bien au-delà de la politique monétaire. Pendant la crise, la BCE a souvent été décrite comme « le seul acteur capable de faire quelque chose dans la zone euro », alors même qu’il était évident que la réponse à beaucoup de problèmes était politique.
Comment en est-on arrivé là ?
La crise financière et les hésitations des politiques nous ont poussés dans ce rôle, et nous nous sommes laissé faire. Le résultat, c’est que nous nous sommes mis à intervenir toujours plus sur les marchés, et que ce rapprochement avec la politique financière est aujourd’hui problématique. Le système de l’euro est devenu pour une large part le créancier des Etats européens. Cela nuit à la discipline de marché et, pour nous, il devient plus difficile de renoncer à une politique monétaire expansionniste et aux mesures spécifiques qui vont avec.