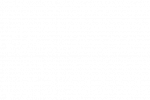Nicolas Hulot : « Rien n’est pire que de renoncer »

Nicolas Hulot : « Rien n’est pire que de renoncer »
Propos recueillis par Annick Cojean
L’ancien reporter-producteur de l’émission Ushuaïa, devenu militant écologiste, a renoncé à se présenter à la présidentielle de 2017. Pour « Le Monde », il revient sur son parcours et assure qu’il a toujours « l’intention de peser » dans le débat politique.
Je ne serais pas arrivé là si…
… si je n’avais pas compris, très jeune, que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, que rien n’est jamais acquis, que tout est aléatoire, et qu’il y a urgence à profiter intensément de chaque instant sans remettre au lendemain.
Une histoire familiale perturbée est-elle la source de cette leçon ?
Je suis né dans une famille bourgeoise : mon premier domicile se situait rue du Ranelagh, dans le 16e arrondissement de Paris, et mon école était Saint-Jean-de-Passy. Mon arrière-grand-père maternel était issu d’une des deux cents familles les plus fortunées de France, mon grand-père paternel – qui inspira Jacques Tati – était lui-même un grand architecte, ancien Prix de Rome. Cela aurait pu faire de moi un gosse de riches, ce qui n’est certes pas une tare mais ne facilite pas l’émancipation ni l’innovation. Seulement voilà : avant que je n’intervienne et prenne moi-même mille chemins de traverse, des ruptures et accidents de parcours avaient déjà ruiné ce bel agencement.
Mon père, aventurier, avait « emprunté » les bijoux de sa mère pour aller chercher de l’or au Venezuela avec une bande de loustics qui allait de Clouzot, l’auteur du Salaire de la peur, à celui qu’on appelait Papillon. Il en revint persona non grata dans sa famille dont l’héritage lui échappera. Quant à mon grand-père maternel, joueur invétéré, il a dilapidé toute sa fortune au casino et fut donc banni par les siens. On m’avait même raconté, enfant, qu’il était mort ! Quand ma mère allait lui rendre visite, elle nous laissait dans la voiture en prétextant aller voir un ami. C’est vous dire combien le silence prévalait dans cette famille qui, même ruinée, s’efforçait de sauver les apparences. Jusqu’à ce que tout s’accélère avec la mort précoce de mon père, seul et déprimé, quand j’avais 15 ans, puis le suicide de mon frère quand j’en avais 19. Tout cela vous balance dans la vie brutalement. Et vous oblige à prendre seul votre envol.
Lesté d’un poids certain…
J’ai à vie un poids dans l’estomac et dans l’esprit. Et, au plus profond de moi, un manque, une tristesse, une solitude. Que je m’efforce d’occulter parce que je ne vis pas dans le souvenir. Les photos chez moi sont enfouies. Je ne les regarde pas car elles me sont insupportables. Le passé m’est insupportable.
Le passé douloureux ?
Tous les passés. Heureux ou malheureux. D’abord, et par définition, parce qu’on n’a pas de prise dessus. Et quand il s’agit de souvenirs heureux, je ne veux pas céder à la nostalgie que Victor Hugo décrit si bien comme « le bonheur d’être triste ». Revoir les visages qui ne sont plus là… Non. Il y a des tiroirs et des dossiers que je ne souhaite pas ouvrir. Je suis un homme du présent.
Qui n’a eu de cesse que de se libérer de son histoire ?
Il ne s’agit pas d’oublier ! Mes parents sont présents dans ma tête. Comme mon enfance. Mais s’il y a des gens qui aiment ressasser voire célébrer leurs blessures, moi, je veux m’en extraire. Il y a suffisamment de douleur comme ça dans l’existence. L’absence n’est jamais comblée, mais je sais gré à mes parents de m’avoir transmis la force de me battre et une forme d’amour de la vie. Tous ceux qui ont connu mon père me disent que c’était un compagnon fantastique qui avait mille idées à la minute, un goût prononcé pour l’aventure, l’évasion, l’émotion. Je n’ai découvert sa vraie personnalité qu’après sa mort, mais force est de reconnaître un certain atavisme dans mon goût des voyages et de la nature. Je me souviens l’avoir observé passer des heures à faire des boutures et des greffes de rose, et je me revois humer trois fois par jour les roses qu’il faisait naître. Ma mère aussi d’ailleurs ne rêvait que de campagne et de vivre entourée d’arbres. Tout cela m’a forcément conditionné.
Mais pourquoi ce sentiment d’urgence perpétuelle ?
Parce que j’ai eu conscience, très jeune, que le sablier de notre vie était tout petit. Et qu’il faut essayer de donner du sens et de la beauté à chaque instant. Je culpabilise toujours d’un moment inutile. Et je ne sais pas m’accommoder des gens qui m’emmerdent et des conversations dont je ressens le vide. Mon frère avait un grand mal-être et estimait que la vie ne valait pas la peine d’être vécue. Moi, j’ai pris le contre-pied de cette idée en embrassant l’existence avec le maximum d’intensité possible. Je n’aurai pas assez d’une vie pour combler toutes mes envies et mes passions. Et je crains, c’est vrai, la dernière échéance.
Jamais de place pour la légèreté ?
Si bien sûr ! Je suis léger et déconneur… entre les gouttes. Je me suis senti mature de façon très précoce mais, paradoxalement, je me sens toujours l’âme d’un adolescent. Il y a deux parts en moi. Et ma sensibilité à fleur de peau me rend perméable à tout. Le joyeux et donc le grave.
Quel était le grand rêve de vos 18 ans ?
Il n’y avait aucun dessein ni aucune stratégie. Juste le désir de saisir les opportunités les plus enthousiasmantes. Et de le faire sur l’instant. Quitte à interrompre au bout de trois mois mes études de médecine pour partir faire du reportage photo en Afrique du Sud auprès de Tabarly. J’étais gamin, je me suis pris au jeu, et la rencontre de Göksin Sipahioglu, le patron de l’agence de presse Sipa, fut déterminante parce qu’il m’a propulsé comme photographe sur les routes du monde, m’exposant aux guerres, aux tragédies, aux situations les plus inouïes, testant mes affinités et mes limites, et m’obligeant à changer l’échelle de mes rêves et de mes aspirations. Explosés les codes et standards familiaux. Pulvérisés le sectarisme de l’entre-soi et ce challenge étriqué : passe ton bac, choisis un métier honorable, fais trois enfants, continue d’aller à la messe le dimanche et roule ma poule !
Mais voyons, cela n’avait jamais été votre objectif !
Non. Mais c’était la référence de mon milieu. Et pour un peu, je serais peut-être passé à côté de ma vraie nature. Comme disait Eminescu, « la vie est un bien perdu pour celui qui ne l’a pas vécue comme il aurait voulu ». Grâce à Sipa, j’ai pu me découvrir moi-même. J’ai baroudé dans toute l’Afrique, ouvert les yeux sur l’apartheid, couvert moult conflits. Ce fut une école de vie en accéléré. Mon père était à l’aise partout, sauf chez les cons. Eh bien moi aussi. J’aime les gens pour ce qu’ils sont et je me fous totalement de leur métier ou de leur milieu social. J’ai de l’intuition, c’est le seul don que je me reconnaisse. Au premier regard, je sais ce que sont les gens. A 99 %.
Après avoir goûté au journalisme, vous n’avez plus posé vos valises et avez multiplié les défis sportifs ou aventuriers sous toutes les latitudes. Que cherchiez-vous alors ? L’exploit ? L’adrénaline ?
Un peu les deux. Mais si j’avais mesuré 1,85 m pour 80 kg, je n’aurais sans doute pas ressenti le besoin de me prouver tant de choses. Ne se construit-on pas souvent sur des complexes d’infériorité ?
Vous en aviez ?
Forcément puisque mes copains me répétaient : « Tu es épais comme une tringle à rideaux » ! En fait, j’ai surtout compris que voler au-dessus de la terre et en découvrir le spectacle me comblaient au-delà de tout. Je me suis dopé à la beauté de la nature et ne pouvais plus m’en passer. Je n’ai plus songé qu’à vivre des moments forts, voyager pour apprendre, voyager pour sentir, voyager pour rencontrer. Victor Hugo disait : « J’ai l’esprit casanier et l’instinct voyageur. » Il n’y a rien qui me caractérise davantage. Et l’émission « Ushuaïa » m’a offert l’un des plus beaux métiers du monde. Un privilège insensé parce que c’était un moment très particulier de l’histoire de la planète, et que ce que nous avons vu et montré, pendant vingt-cinq ans, et au cours de 600 tournages, ne se reverra plus jamais.
Par exemple ?
Des écosystèmes qui ont été saccagés : 15 % des espèces sauvages ont disparu au cours de ces vingt dernières années. Des peuples dont les modes de vie n’avaient pas changé depuis la nuit des temps ont été absorbés dans un laminoir d’homogénéisation culturelle. L’audience de nos émissions nous permettait de disposer de moyens équivalant à ceux de longs-métrages, et très peu de frontières nous étaient fermées. Nous pouvions sillonner sans danger l’Afrique, l’Afghanistan, le Pakistan… C’était une chance folle. Mais si nous nous étions contentés d’utiliser la planète comme un terrain de jeu et d’exploits, nous aurions tenu cinq ans, certainement pas vingt-cinq. L’émission s’est transformée au fur et à mesure que ma sensibilité, mes convictions, mon engagement prenaient corps.
Y a-t-il eu un point de bascule ?
Non, justement ! Cette complicité avec la nature, cette prise de conscience de la vulnérabilité de la planète et de la rapidité de sa destruction se sont forgées doucement. Avec une approche charnelle, pas seulement livresque. C’est pour ça que mon engagement est ancré au plus profond de moi-même. La planète n’est pas pour moi une abstraction. Plonger sous la banquise, cheminer à dos d’éléphant, voler avec un condor dans les Andes puis enlacer une femelle orang-outang… Il n’est pas donné à beaucoup de vivre une telle diversité d’émotions. Sans compter ces nuits passées avec des tribus d’Indiens de l’Amazonie ou les derniers tailleurs de pierre de l’humanité. J’ai du mal avec la notion de frontière et d’entité géographique parce que je nous vois comme une seule et même famille. Avec une universalité des problèmes et des enjeux.
Comment a évolué l’émission ? Le militant a-t-il peu à peu pris le dessus ?
Bien sûr. L’exploit s’est effacé au profit d’une forme de pédagogie. Des scientifiques de renom ont dépassé leur réserve vis-à-vis de la télévision et m’ont fait confiance. Ils m’ont instruit, formé, nourri, comprenant que je pouvais leur servir de médium. Dès lors, ce fut un rapport de force permanent avec TF1, effaré que j’introduise des mots compliqués ou que j’interviewe des savants. Des émissaires de la direction débarquaient en salle de montage en exigeant que je retire telle ou telle séquence ! Je refusais. Je n’ai jamais cédé sur la ligne éditoriale. Le côté aventure subsistait pour que les spectateurs s’identifient à mes propres émotions, mais le discours visait clairement à éveiller les consciences. Et j’avais une complicité merveilleuse, à vie, avec mon équipe, qui est d’ailleurs ma deuxième famille.
Alors, et la politique ?
Eh bien, au fur et à mesure que j’envisageais la complexité des sujets et l’irréversibilité de certains mouvements, j’ai compris que la cause de tout ça était notre modèle économique et notre civilisation. Travailler avec les environnementalistes était insuffisant. Il y avait urgence. Il était évident que ma fondation devait investir tous les champs : agriculture, économie, transports… et politique. Car jusqu’à preuve du contraire, c’est là qu’est le pouvoir. J’ai alors poussé toutes les portes, convaincu que lorsqu’elles s’ouvrent parfois par flagornerie et opportunisme, elles peuvent rester ouvertes par conviction. Et le premier qui, spontanément, m’a ouvert son bureau, c’est Jacques Chirac. Tout simplement parce qu’il adorait l’émission et qu’il m’appelait systématiquement un lendemain de diffusion. Un dialogue est né, et même une sorte de complicité qui, au fil du temps, m’a permis de faire passer des messages et de contribuer à la Charte de l’environnement avec le fameux principe de précaution.
Vos conversations se révélaient efficaces…
Oui, Chirac s’est pris au jeu et je pense que j’en suis responsable. Il a saisi beaucoup de tribunes internationales, créé le premier ministère de l’écologie et du développement durable. Ce n’était pas révolutionnaire, mais ça ouvrait des brèches dans son propre camp, même si l’espace s’est refermé depuis lors. A partir de ce moment, j’ai développé un dialogue dans l’ombre avec énormément d’hommes et de femmes politiques de tous bords. Et créé de vrais liens tout en gardant mon indépendance. J’étais parfois la bête curieuse, mais j’allais partout où les portes s’entrouvraient, dès lors que je ne me sentais pas instrumentalisé. Jusqu’au Pacte écologique de 2006 où j’ai profité – abusé – de ma notoriété pour les mettre tous au pied du mur en leur demandant d’afficher leur engagement. Ils étaient coincés ! Le fait est que ça a débouché sur le Grenelle de l’environnement, puis le paquet climat-énergie de l’Union européenne et toute une série de réactions en chaîne…
Il fallait une sacrée assurance pour menacer de vous présenter aux présidentielles si l’écologie n’était pas prise en compte.
Je l’avais annoncé au JDD sans y croire vraiment. Une sorte de plaisanterie. Un geste de défiance. Mais les candidats ont pris peur, les médias se sont emballés. Je ne me rends pas toujours compte de ce que je provoque. D’où mon étonnement, à nouveau, il y a quelques mois, devant toutes ces pressions pour une éventuelle candidature. Je suis intuitif, pas calculateur ni stratège. Et je vis très à l’écart de l’ébullition.
Vous êtes-vous senti dépassé ?
Oui. Mais je me débrouille pour faire face et m’organiser. Je ne suis pas seul. L’équipe de ma fondation me soutient et m’inspire. Et puis ce complexe d’infériorité sur lequel je me suis construit m’a donné des ailes. Être le petit mouton noir d’une ribambelle de cousins beaucoup plus riches et souvent très cruels m’a boosté pour chercher au fond de moi d’autres ressources. Traîner l’étiquette de TF1 et de pilote d’hélicoptère m’a obligé à prouver avec dix fois plus de force ma sensibilité écologiste. Être autodidacte – bac plus 3 mois – m’a poussé à combler mes lacunes et lire, étudier, me former cent fois plus que quiconque pour me sentir à l’aise avec les énarques et autres Sciences Po croisés à l’Elysée pendant trois ans. Et je ne serais pas arrivé là si des scientifiques merveilleux n’avaient pris le temps de me transmettre leurs connaissances avec une patience infinie. Le parcours a souvent été rude, j’ai essuyé des critiques qui me semblaient très injustes. Et si je n’avais pas l’habitude de prendre de la distance, au propre comme au figuré, j’aurais vite trébuché et me serais noyé depuis longtemps !
Cela vous arrive-t-il de penser : « J’ai assez donné, je passe le relais » ?
Ah oui, très sincèrement. Parce que si vous voulez rassembler et convaincre, il faut travailler en permanence, sortir ses tripes et donner tout son jus. Et il m’arrive de me sentir vidé. Mais j’ai aussi envie que mes enfants soient fiers de moi plus tard. Et rien n’est pire que de renoncer. Et puis il y a tous ces gens merveilleux, croisés sur le chemin, qui vous réconcilient avec l’humanité.
Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
Le lever du soleil que je ne veux pas louper sur la mer. La vision de mes enfants partant à l’école. La quarantaine de personnes qui œuvrent chaque jour à ma fondation. L’encouragement que je me dois de prodiguer à des centaines d’acteurs et militants sur le terrain, en France comme à l’étranger. Mon travail d’intercesseur discret sur un tas de dossiers, grâce au lien de confiance créé avec des hommes et des femmes politiques, ainsi qu’avec des autorités religieuses et spirituelles. Et puis l’obligation de réinventer des modalités d’action dans le champ écologiste et politique. Car j’ai bien l’intention de peser. Ne serait-ce que parce que je suis le brise-glace d’une multitude de gens qui attendent que je leur ouvre l’espace.
Propos recueillis par Annick Cojean
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici