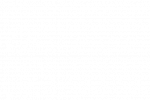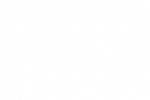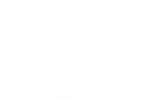François Bégaudeau : « Je ne crois pas à votre modèle de vie »

François Bégaudeau : « Je ne crois pas à votre modèle de vie »
Propos recueillis par Sandrine Blanchard
Ecrivain, François Bégaudeau vient de publier un nouveau roman, « Molécules », et une bande dessinée, « Wonder ». Cet ancien enseignant, auteur d’« Entre les murs », dont l’adaptation cinématographique remporta la Palme d’or à Cannes en 2008, revient sur son parcours marqué par la littérature et la politique.
Je ne serais pas arrivé là si…
… Si je n’avais pas contracté une passion pour l’écrit à l’adolescence. J’ai commencé à beaucoup lire et cela a déterminé mon envie, un jour, de goûter à ces plaisirs-là. Cette passion est venue lorsque j’ai découvert, vers l’âge de 15 ans, que la littérature pouvait explorer des questions qui me touchaient. Banalement, j’ai lu Camus, Sartre, Giono, Racine, Bernanos. Je puisais allégrement. Il y a eu, dans un segment très court de ma vie, beaucoup de lectures éblouissantes.
Ces lectures étaient-elles disponibles chez vous ?
Par forcément. En tant qu’instituteurs devenus profs, mes parents valorisaient bien sûr la lecture, mais ils ne lisaient pas plus que cela ; il n’y avait pas de conditionnement à la littérature. C’est plutôt parce que ces textes brassaient des questions politiques et métaphysiques que je m’étais toujours posées qu’ils m’ont été immédiatement familiers. Malgré mon éducation laïcarde, les extraits de Pascal, par exemple, m’ont tout de suite parlé.
De quel ordre étaient ces questions politiques et métaphysiques ?
Métaphysique, c’est simple : cela s’ordonnait autour d’une perplexité devant la condition humaine. Qu’est-ce qu’on fait là ? Comment peut-on mettre du sens alors qu’on est voué à la poussière ? Des questions de base, mais il ne faut pas avoir peur d’être primitif. Enfant, j’étais déjà très angoissé. Quant à la question politique, elle était très largement conditionnée par mon milieu. Mon père et ma mère étaient au Parti communiste. J’ai baigné dans la politique très tôt et notamment dans le paradigme de la gauche radicale.
Quels souvenirs gardez-vous des discussions politiques familiales ?
Quand des amis de mon père, souvent des copains profs de gauche, venaient à la maison, il y avait toujours un moment du repas où ils se mettaient à parler politique. Je retardais le moment d’aller jouer parce que j’aimais bien les écouter. Je ne comprenais pas tout mais ce verbe-là me plaisait.
Vous dites avoir été « programmé pour être premier de la classe ». Vous êtes allé jusqu’à l’agrégation de lettres modernes. Vous n’étiez pas rebelle ?
Si. Et c’est bien cela le problème. On vivait dans un milieu où l’on contractait assez vite le pli de mettre en doute l’état de la société. En même temps, nous étions des parfaits petits soldats de cette société. C’est l’ambiguïté de mes parents, que je ne trouve pas du tout répréhensible : trouver à la fois que cette société est très inique et à la fois tout faire pour que la progéniture s’y intègre.
C’est peut-être la contradiction de tous les parents de gauche. J’avais une fibre contestataire. Je jouais le jeu scolaire, faisais ce pour quoi j’étais conditionné mais je n’étais pas dupe de ce système. Je savais que l’école était inégalitaire, qu’il n’y avait pas de mérite à y être bon, que c’était très largement préprogrammé. Mais il y avait une incitation à jouer le jeu puisqu’on savait faire. Cette contradiction, chez moi, s’est arrêtée en hypokhâgne.
Que s’est-il passé à ce moment-là ?
Je m’en fous d’aller à Normale-Sup. Je vais y être admissible mais cela ne m’intéresse pas. J’aurais pu aussi entrer à Sciences Po après le bac parce que j’avais eu mention très bien. Mais les grandes écoles, ce n’était pas mon truc. J’ai passé l’agrégation, non pas à titre de gratification individuelle ou pour aller plus loin, mais pour avoir moins d’heures de cours. Ni plus ni moins. A l’époque, je commençais à faire du punk rock. Je savais où était mon camp.
Le goût pour le punk rock s’est construit de quelle manière ?
Le goût du rock a débuté grâce à mon frère. Il avait sept ans de plus que moi, on était dans la même chambre. A 14 ans, il écoute Téléphone, et là, boum, j’adore ça. J’attrape à 7 ans quelque chose de la rébellion de mon frère. Ensuite, la découverte du punk rock va être fondamentale. Et notamment une émission à la télé où il y avait cette image d’Iggy Pop. C’est quinze secondes que j’ai regardées deux mille fois au magnétoscope parce que j’avais l’impression que dans ce corps-là, il y avait magie.
Qu’est-ce qui vous fascinait ?
Je n’aurais pas su le formuler à l’époque. Mais le corps d’Iggy Pop résume tout ce que j’aime dans le rock : un corps androgyne, contestataire, iconoclaste, féminin, et en même temps très puissant, gracile et brutal. Il y a quelque chose d’animal chez lui. J’en dirais autant des Sex Pistols et de tous les pionniers du punk. Je n’avais pas envie d’être comme cela, mais l’envie que ma vie se passe dans la périphérie de cela.
Avec des amis, vous fondez à Nantes le groupe punk rock Zabriskie Point. Vous êtes le parolier et chanteur. Que racontaient les chansons ?
C’était des paroles plutôt contestataires et politiques. Mais le punk rock a beaucoup à voir aussi avec la potacherie, le côté fondamentalement clownesque et farcesque. Le truc n’était pas de dénoncer la société, c’était plutôt de s’en moquer. Cela change tout. C’est dire : Je ne crois pas à votre modèle de vie, vous êtes pathétique. Le slogan des Sex Pistols ce n’est pas « No future », c’est « No future for you ». Vous, les gens normés, conformistes.
Quand vous embrassez le métier d’enseignant avec cet état d’esprit de ne pas être dupe du système, vous y allez avec quelle envie ?
Dans la bande que je fréquentais dans les années 1990, l’alternative était : on y va ou on n’y va pas. Y aller, cela voulait dire être enseignant, car il n’y avait pas beaucoup d’autres perspectives pour nous, les intellos inutiles absolument décidés à ne pas entrer sur le marché libéral. Ceux qui n’y sont pas allés sont devenus précaires et le sont toujours.
J’ai choisi d’y aller parce que je ne voulais pas que l’argent devienne un problème. J’avais envie d’avoir la tête sereine pour me consacrer à ce qui m’importait : lire, écrire, voir des films, écouter de la musique. En y allant, j’ai d’abord été très triste. Le travail, c’était un peu la fin de la fête. Pendant les dix années où j’ai enseigné, mon obsession était que cela ne bouffe pas tout mon temps. La critique est l’activité qui m’a pris le plus d’heures dans ma vie. J’ai commencé à écrire aux Cahiers du cinéma en 1995 et, encore maintenant, je continue à pondre énormément de critiques dans Transfuge.
Avez-vous quand même pris du plaisir à être enseignant ?
Bien sûr. Comme dans toute activité, même subie, il y a des vertus incidentes. Des moments de plaisir, de joie. Et cela a été important dans ma réflexion.
Quand vous repensez à cette période, qu’est-ce qui vous revient ?
Quand un prof arrive, il n’a qu’une obsession : ne pas être bordélisé, tenir sa classe. Mon événement fondateur sera l’inverse : je me rends compte qu’une classe qui suit docilement ça me panique, me tétanise. Tous ces gens qui enregistrent passivement le cours, cela me désespère. Je vois là l’absurdité de l’école. Une caisse enregistreuse.
Mais vous, en tant qu’élève, vous étiez pourtant comme cela ?
Oui, j’étais un très bon fonctionnaire du métier d’élève. Quand ça fonctionne, on n’a pas de recul critique, sauf si on a lu Bourdieu, mais on ne le vit pas dans son corps. Par contre, le prof, lui, est au cœur des dysfonctionnements. Enseigner dans les quartiers populaires n’a fait que radicaliser ma position sur l’école.
J’avais repéré, dès 18-20 ans, qu’il y avait un moment exceptionnel de la pensée française qui croisait mes problématiques : Foucault, Deleuze, Rancière, Derrida. Je suis entré dans une boulimie de lectures. C’est dans Rancière, qui déteste les positions d’autorité, que je me reconnais le mieux. Ayant lu tout cela trois ans avant de devenir prof, je savais à quoi m’en tenir. J’avais peu d’espoir de transformer d’un seul coup cette machine inégalitaire en machine égalitaire. Tout le monde devrait lire Bourdieu à l’école.
En 2003, vous publiez votre premier livre « Jouer juste »…
J’ai toujours eu l’idée très banale, très conditionnée chez les petits Français de la petite bourgeoisie intellectuelle, de me mettre un jour à un roman. J’avais parmi mes collègues à Dreux un dénommé Philippe Adam, qui a publié en 2002 un premier roman aux éditions Verticales. Je lui ai fait lire mon livre, et il l’a fait lire à son éditeur. Est-ce que j’en serais arrivé là sans lui ? On ne saura jamais. Je considère que j’ai eu de la chance.
« Entre les murs », votre livre inspiré de votre expérience d’enseignant, va être primé, puis adapté au cinéma et obtenir, en 2008, la Palme d’or à Cannes. Quel est le moment le plus important de cette période ?
Je suis un mec très concret. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui arrive à mon corps : d’abord écrire le livre, ça, ce n’est pas rien. Pour le film, ce qui m’arrive est d’être acteur pendant sept semaines. Pour moi, tout se termine en août 2007, à la fin du tournage. Ce qui va suivre n’est plus mon affaire. Entre les murs n’a pas changé ma vie, cela a changé le regard sur moi. Mais c’est tout. Qu’est-ce que je faisais avant ? Je lisais, j’écrivais. Qu’est-ce que je fais depuis : je lis, j’écris.
Le film a suscité beaucoup de débats sur l’école. Vous vous y attendiez ?
Dans la vieille et longue histoire de l’hystérie scolaire française, c’était prévisible. Mais il ne faut pas confondre la visibilité de quelque chose et la proportion d’intérêt de la part de l’auteur. Le contenu des débats sur l’école m’intéresse peu, parce qu’ils sont toujours dans le même paradigme éducatif. Je suis plutôt du côté d’Ivan Illich, une société sans école. Mais ceux qui parlent de l’école ne lisent pas Illich. C’est dommage, ce serait un vrai beau débat.
Beaucoup d’autres questions, notamment sociales, m’intéressent. Le grand sujet est comment le champ social s’imprime sur nos corps. Par exemple, la scène du film La Loi du marché dans laquelle une caissière est prise la main dans le sac et emmenée par un vigile me bouleverse, m’a fait tomber en larmes. La caissière ne se défend pas.
Quand vous êtes-vous détaché du métier d’enseignant ?
En 2005. Je n’ai travaillé que parce qu’il fallait que je mange. A partir du moment où j’ai pu manger sans travail salarié, j’ai arrêté. Je n’ai aucun état d’âme à ne plus prendre le RER à 6 heures du matin.
Etre libertaire, en 2016, cela signifie quoi ?
Je me considère comme marxiste et libertaire. Je me sens toujours très constitué par ces deux grandes lignées à la fois idéologiques, philosophiques, esthétiques. L’analyse économique marxiste est encore pertinente aujourd’hui, moyennant son renouvellement par des gens comme Frédéric Lordon, par exemple, que je suis assidûment.
En ce moment, Geoffroy de Lagasnerie renouvelle magnifiquement la pensée libertaire dans le champ public. Je me sens très proche de lui. Il fait bien le lien entre Bourdieu et Foucault. Toutes mes fascinations, mes intérêts politiques et philosophiques sont dans cette constellation, y compris les propositions de mode de vie portées par les anarchistes. Tout cela m’intéresse profondément.
Ce mélange marxiste libertaire s’est-il construit à partir des discussions que vous pouviez entendre chez vous ?
Mon axe paternel était plutôt PCF. J’ai grandi là-dedans, mais cela a très vite été entaché par une fibre plus anarchisante, plus potache aussi. Très méfiante vis-à-vis de l’Etat. Mais le grand fait de ma vie, c’est d’avoir rencontré des amis formidables en hypokhâgne. Cela fait trente ans qu’on pense ensemble. Ce groupe, c’est ma vie, il y a une tendresse immense, ce sont des gens qui m’ont beaucoup profité.
Pourquoi sont-ils si importants pour vous ?
Ils me font du bien. Je crois beaucoup à l’autoéducation des ego. Dans un groupe d’amis, on s’entre-éduque, on s’entre-émancipe. Je sais ce que je leur dois. Ils contribuent à ma radicalité politique. Ils viennent tous de la petite bourgeoisie, sont fils ou filles de profs et sont devenus soit profs, soit précaires. Dès lors que vous n’êtes pas dans l’allégeance au monde du travail tel qu’il s’est « managérisé » depuis quarante ans, eh bien il ne reste que la fonction publique ou la culture. Mais dans ce dernier milieu, il y a un système d’héritage et de reproduction très fort.
Pourquoi vous intéressez-vous depuis longtemps au sport ?
Le sport, c’est un conditionnement de petit garçon dès l’âge de 5 ans, c’est l’école des petits garçons virils. Alors que mon goût pour le rock, c’est la contestation. Je prends de plus en plus le sport comme un symptôme social et politique. Il donne une parfaite entrée sur le fonctionnement du libéralisme. En analysant l’économie du sport, on comprend le capitalisme.
Ensuite, le sport est souvent traversé de débats qui sont le symptôme de l’état de la société, des mentalités. Quant à l’adrénaline sportive, elle a plus à voir avec la sauvagerie concurrentielle qu’avec des pseudos « valeurs » ; je ne supporte pas ce mot. Il me fait le même effet que quelqu’un qui débarquerait sur un champ de bataille et qui dirait : « ouais ce qui est bien c’est qu’on fait du vivre ensemble ».
Allez-vous voter à la présidentielle de 2017 ?
Non.
Vous n’avez jamais voté ?
Si, entre 2001 et 2007. Je venais de la pensée révolutionnaire : « Elections, piège à cons », reproduction de l’élite bourgeoise. Et je continue à le penser. Mais en 2001, lors des élections municipales, j’espérais vraiment que Tiberi s’en aille de Paris. Je me suis dit, par honnêteté intellectuelle : « Puisque ton corps désire cela, va au bout, ne fais pas ton malin. » Pour la première fois, j’ai voté. Puis en 2002, j’ai voté Besancenot, plutôt par adhésion. Après cette parenthèse, j’ai arrêté.
Vous ne pensez pas qu’en 2017 l’abstention peut être dangereuse ?
Non. Avec la classe politique républicaine autoritaire libérale qu’on a depuis trente ans, on n’a pas besoin de Marine Le Pen. Ça ne changera rien, ils ont déjà fait tout le boulot. Ceux qui ont peur de Marine Le Pen ont une pensée politique très faible. Ils devraient lire Marx.
Hitler n’a pu arriver au pouvoir que parce que la grande bourgeoisie, notamment financière, était de son côté. Marine Le Pen n’arrivera au pouvoir que le jour où elle aura dit qu’elle ne veut pas sortir de l’euro. Lorsqu’on demande actuellement aux gens de droite ce qui les sépare de Marine Le Pen, ils disent « Economiquement, son programme est absurde ». Rien d’autre. C’est mal connaître une société que de croire que le grand capital laissera Marine Le Pen prendre le pouvoir. On la voit actuellement mettre de l’eau dans son vin, dire « On fera un référendum. » Donc, il n’y a rien à craindre. Pour moi, c’est une ultrarépublicaine.
Propos recueillis par Sandrine Blanchard
« Molécules », éditions Verticales
« Wonder », dessins d’Elodie Durand, Delcourt, collection « Mirages »
François Bégaudeau tient une chronique mensuelle dans le supplément Sports du « Monde »
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici