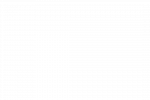Quand l’ONU donne une leçon d’efficacité à l’Union africaine

Quand l’ONU donne une leçon d’efficacité à l’Union africaine
Par Seidik Abba (chroniqueur Le Monde Afrique)
Face à la nomination aisée d’Antonio Guterres au Secrétariat général de l’ONU, l’Union africaine affiche son impuissance quant à la désignation du successeur de Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission.
On connaît la solide réputation des lourdeurs bureaucratiques de l’ONU, ses impuissances face aux crises aiguës, notamment en Syrie, au Darfour, au Soudan du Sud, au Yémen, en République démocratique du Congo (RDC). Contre toute attente, c’est cette même ONU qui vient de réussir un sursaut en désignant de façon consensuelle et aisée, le 5 octobre, Antonio Guterres, 67 ans, au poste de secrétaire général.
Là où on redoutait, à juste titre, un blocage du fait de la position initiale de Moscou d’exiger un secrétaire général venant d’Europe de l’Est, le Conseil de sécurité a trouvé l’intelligence de contourner les tensions entre les Etats-Unis et la Russie sur la Syrie pour porter son choix sur Antonio Guterres, ancien premier ministre portugais (1995-2002).
« Une scène historique »
« C’est remarquable qu’il n’y a eu ni contentieux, ni controverse, s’est réjouie Samantha Power, ambassadrice américaine à l’ONU. Tous les jours, nous nous rendons au Conseil de sécurité où nous aspirons à l’unité. »
Pour sa part, son homologue russe, Vitali Tchourkine, ne croyait pas si bien dire lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en ces termes : « Vous êtes les témoins, je pense, d’une scène historique. »
Même avec un peu moins de triomphalisme, on ne peut ne pas reconnaître qu’obtenir, dans la conjoncture internationale actuelle, un accord sans douleur entre les quinze membres du Conseil de sécurité sur la candidature d’une personnalité, dont le pays est de surcroît membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), est un succès.
C’est cette dynamique consensuelle positive que l’Union africaine (UA) a échoué à construire en juillet dernier à Kigali, lors de la tentative de désignation du successeur de Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission. Prisonniers des logiques régionales et de leurs agendas cachés, les chefs d’Etat du continent, réunis dans la capitale rwandaise pour leur 27e sommet, n’ont pu départager trois prétendants seulement à la fonction : le ministre des affaires étrangères du Botswana Pelonomi Venson-Moitoi, son homologue équato-guinéen Agapito Mba Mokuy et l’ancienne vice-présidente ougandaise Specioza Wandira-Kazibwe.
Une vraie fuite en avant
Signe indiscutable de son incapacité à faire autant que les Nations unies lors de la désignation de Guterres, l’Union africaine a renvoyé le choix du futur président de sa Commission à janvier 2017, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Une décision qui s’apparente à une vraie fuite en avant. Car on a aujourd’hui de bonnes raisons de penser que l’organisation continentale africaine se dirige à nouveau vers une impasse, lors des discussions sur le choix du prochain président de sa Commission.
En effet, aux personnalités recalées à Kigali, se sont ajoutées les candidatures du professeur Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique centrale, ancien ministre sénégalais, celle du ministre des affaires étrangères du Tchad Moussa Faki Mahamat ainsi que la candidature de son homologue kényane Amina Mohamed.
A en juger par les soutiens que pourraient mobiliser les différents candidats, il ne serait pas surprenant que l’élection du successeur de Nkosazana Dlamini-Zuma soit paralysée, lors du sommet de janvier 2017, par un duel sans merci entre les partisans des deux grands favoris du scrutin : le Sénégalais Abdoulaye Bathily et le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Il s’y ajoute, pour rendre l’équation encore plus complexe, la ferme volonté des Etats d’Afrique australe de voir plutôt une personnalité de leur région reprendre le témoin à la Sud-Africaine Dlamini-Zuma.
Rouleau compresseur
Aux Nations unies, l’élection du secrétaire général s’est passée d’autant plus facilement qu’Antonio Guterres avait incontestablement le profil pour l’emploi : ancien premier ministre portugais pendant sept ans, mais surtout ancien haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (2005-2015) et fin connaisseur du puissant lobby des organisations non gouvernementales.
Le problème à l’Union africaine, c’est que le président de la Commission n’est pas forcément choisi en fonction de sa compétence avérée pour le poste. Comme l’atteste la désignation de Nkosazana Dlamini-Zuma en 2012, ici, le plus déterminant reste le rapport de forces que le pays d’origine et le bloc régional qui soutiennent une candidature réussissent à construire.
Face au Gabonais Jean Ping, l’Afrique du Sud a utilisé, il y a quatre ans, la technique du rouleau compresseur pour imposer à la présidence de la Commission son ancienne ministre des affaires étrangères. Les pays membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont ainsi été sommés de faire bloc derrière la candidature de l’ex-épouse du président Jacob Zuma, sous peine de s’attirer les foudres du « grand frère sud-africain ».
Un bilan calamiteux
Pour parvenir à ses fins, le pays de Nelson Mandela a usé avec d’autres Etats du continent de la diplomatie du chéquier, promettant tantôt des financements mirobolants pour des projets, assurant tantôt des espèces sonnantes et trébuchantes à des dirigeants. Résultat, on en est arrivé à la situation d’aujourd’hui, où Nkosazana Dlamini-Zuma quitte ses fonctions sur une double déception.
Elle s’en va d’abord en suscitant la colère, elle qui s’est tant battue pour le poste, de renoncer à « sa mission » continentale par purs calculs personnels. Il n’est un secret pour personne que l’ancienne ministre de la santé a pour seul agenda de rentrer à Pretoria pour prendre en 2017 la présidence de l’African National Congress (ANC, au pouvoir) puis de s’en servir comme marchepied pour la succession de Jacob Zuma en 2019.
La présidente de la Commission part surtout en laissant en héritage un bilan calamiteux. Au bout de ses quatre années de fonction, elle n’aura jamais tenu sa promesse de campagne de rétablir le leadership de l’UA dans la résolution des crises africaines : Sahel, RDC, Libye, Centrafrique, Somalie.
Impostures
A lui seul, l’exemple du Burundi, où l’UA a été incapable de déployer des troupes, témoigne à merveille de son échec. Nkosazana Dlamini-Zuma n’aura pas non plus réussi à garantir une meilleure efficacité au fonctionnement interne de la Commission, en la délestant de ses lourdeurs bureaucratiques. Elle aura, en revanche, réussi la prouesse de taire la voix de l’Afrique sur les élections présidentielles controversées au Niger, à Djibouti, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Gabon.
Pourtant, bien plus qu’à la présidente sortante de sa Commission, l’UA doit s’en prendre à elle-même. Car, en choisissant de privilégier, à la différence de l’ONU et de l’Union européenne, des critères autres que la compétence lors de la désignation du président de sa Commission, elle ouvre la voie à toutes sortes d’impostures. Celle de Nkosazana Dlamini-Zuma en 2012 en fut une.
Seidik Abba, journaliste et écrivain, auteur de Niger : la junte militaire et ses dix affaires secrètes, (2010-2011), L’Harmattan, 2013.