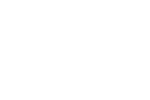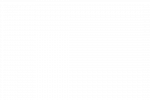Dans le bois de Vincennes, les sans-abris que cache la forêt

Dans le bois de Vincennes, les sans-abris que cache la forêt
Par Frédéric Cazenave
A l’orée de la capitale, près de 200 SDF vivent dans le bois de Vincennes. Malgré la dureté de la vie, ils s’approprient l’espace et tentent de se reconstruire un chez-eux, sous l’œil attentif de la ville de Paris
Aout 2016 - Karim, installé au bois de Vincennes depuis près d’un an : « Pourtant, il ne faudrait pas grand-chose pour améliorer notre vie, . Un petit espace pour être au chaud et au sec, des toilettes plutôt qu’aller derrière un arbre, des douches au lieu de se rendre à Paris, une expédition en hiver. » | Karim El Hadj pour Le Monde
Bien qu’il soit interdit d’y camper, plusieurs centaines de SDF vivent à l’année dans le bois de Vincennes et les 1 000 hectares de verdure qu’offre ce magnifique parc de l’Est parisien. A chaque saison, leur nombre varie. Ils seraient aux alentours de 200 aujourd’hui. En 2015, Emmaüs solidarité, qui coordonne l’action des associations présentes en partenariat avec la mairie de Paris, a rencontré 366 personnes différentes. Des hommes à 81 %.
Ici, pas d’habitats modulaires prévus – au contraire du centre d’hébergement de 200 places, construit en bordure du bois de Boulogne (16e arrondissement de Paris), qui devrait ouvrir à la mi-novembre. « Pourtant, il ne faudrait pas grand-chose pour améliorer notre vie, avance Karim (les prénoms ont été changés), qui a planté sa tente dans le bois en 2015. Un petit espace pour être au chaud et au sec, des toilettes plutôt qu’aller derrière un arbre, des douches au lieu de se rendre à Paris – une expédition en hiver. »
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web
Institutionnaliser ce vaste camping sauvage ? La mairie n’y songe pas. « Nous ne cherchons pas à chasser les SDF du bois, mais nous régulons leur implantation. Les riverains nous interpellent régulièrement à ce sujet », souligne Dominique Bordin, chargé de mission SDF à la mairie de Paris. La Ville a donc édicté des règles : les cabanes sont interdites, les meubles proscrits, ce qui n’est pas sans créer de tensions. « Les agents sont plus regardants qu’avant, déplore Luc, la cinquantaine, qui vit ici six mois par an depuis 2008. Une simple table devant la tente, et c’est la prise de tête. Ils nous réveillent tôt le matin pour vérifier si nous sommes là, nous fichent. »
Les sites doivent être tenus, les alentours propres. « Régulièrement, nous rangeons, nous brûlons les déchets, et on ne s’est pas installés trop près des allées… C’est le prix à payer pour être tranquilles », explique Céline, 42 ans, dont déjà deux dans le bois. Assis à côté d’elle, Antony alimente le feu. Une épaisse fumée enveloppe les couettes et couvertures suspendues à un fil tendu entre deux arbres. Le long d’un tronc, un râteau et un balai sont posés ; au-dessus, un miroir est accroché.
« Avant, il y avait des canapés, des buffets… Certains avaient même reproduit une salle à manger. Il faut bien comprendre qu’ici les habitants se reconstituent un chez-eux, s’approprient l’espace », explique Pierre Dereux, bénévole du Secours catholique, qui effectue une maraude hebdomadaire depuis 2013.
Au fil du temps, ils aménagent leurs tentes igloos. Etagères pour les ustensiles de cuisine, les aliments et poser la radio ; table et chaises pliantes, batteries pour recharger le téléphone portable et avoir un peu d’électricité ; gazinière ou simple réchaud afin de manger chaud et réchauffer la tente… « Mais attention, ce n’est pas le camping, prévient Stéphane, 40 ans, en terminant la cuisson de ses œufs au plat. Tu ne te fais pas à manger si t’es bourré, sinon… boum », dit-il en riant. Yvon, 55 ans passés, dont plus de cinq au bois, peut en témoigner. Son réchaud a explosé lorsqu’il changeait la recharge, lui brûlant gravement les jambes. Après plusieurs mois à l’hôpital, Yvon est retourné au bois. Lorsque nous l’avons recroisé en juillet, il installait sa nouvelle tente.
Malgré la dureté de la vie ici – le froid de l’hiver, la pluie obligeant à rester enfermé dans la tente, l’humidité qui imbibe vêtements et duvets –, les habitants relativisent au regard de la vie dans la rue. « C’est mieux qu’à la street, explique Lucas qui, à 24 ans, a déjà de longues années de galère derrière lui. A Paris, on se fait chasser tous les matins à l’aube. C’est crevant. Ils mettent même des produits désinfectants pour nous empêcher de revenir. »
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web
Ils comparent aussi avec les autres hébergements précaires qu’ils ont connus. Les foyers sont honnis, ce qui explique pourquoi beaucoup « préfèrent » rester au bois l’hiver. « J’ai vécu quatre ans en foyer, mais je devenais fou, témoigne Ali, 60 ans, assis à l’entrée de sa tente. C’est rempli de gens bourrés, qui ne respectent rien. Une nuit, mon voisin a pissé dans la chambre. Comme je suis vieux, il m’a pris de haut. Je lui ai mis un coup de tête. Le lendemain, j’arrivais au bois. » C’était en novembre 2015.
« Contrairement aux foyers, des liens se créent. Il y a une vie sociale, une certaine solidarité », explique Maryvonne Lozachmeur, bénévole du Secours catholique. Quand Yvon a été blessé, ses amis ont gardé son chien ; lorsque Karim, malade, était cloué au lit, des voisins lui ont fait des courses ; le diable de l’un est utilisé pour transporter les bidons d’eau des autres. Ils surveillent mutuellement leurs tentes pour éviter les vols, se dépannent… En ayant un habitat, ils peuvent aussi recevoir. Ils s’invitent, partagent des barbecues.
Beaucoup restent flous sur leur passé et préfèrent parler du présent. Peu acceptent les photos, et tous souhaitent que leur anonymat soit garanti. De peur de se faire reconnaître par leur famille, avec qui ils ont coupé les ponts, par leurs connaissances en ville, ou tout simplement par principe : « Et toi, tu voudrais qu’un jour on prenne en photo ta déchéance ? » interpelle Jean, la cinquantaine, dont six ans au bois.
« C’est chacun chez soi »
S’ils partagent des moments ensemble, loin d’eux l’idée de vivre en communauté. D’ailleurs, même si plusieurs tentes peuvent être regroupées, elles sont souvent, au sein d’un même périmètre, espacées de plusieurs dizaines de mètres. « Il ne te viendrait pas à l’idée de t’incruster chez ton voisin tous les jours. Eh bien, ici, c’est pareil, c’est chacun chez soi », expose Jean. Plusieurs racontent aussi ne pas participer aux soirées des autres campements. « C’est sympa au début, mais, entre l’alcool et la drogue, cela peut rapidement dégénérer en embrouilles », résume Jean.
Car la violence n’est jamais bien loin. « C’est de nouveau plus calme, mais il y a quelques mois c’était chaud, assure Céline. Une nuit, on s’est réveillés avec le feu dans notre tente. Quelqu’un avait bourré notre glacière de papier et allumé le tout. » Prince, un rasta de 53 ans, établi depuis 2014 à Vincennes, et qui à la ville est guitariste et leader du groupe de reggae Jah Prince & the Prophets, confirme : « Le plus dur au bois, c’est d’être sur le qui-vive constamment. La nuit, tu es en alerte. La peur de te faire attaquer, qu’on te vole le peu que tu as. » C’est notamment ce qu’a subi Ali : « Je venais de m’endormir lorsque quelqu’un a ouvert la tente et s’est emparé d’un de mes sacs. Je l’ai pourchassé, mais comme il faisait nuit noire, impossible de l’attraper. »
Le risque que les habitants se fassent justice eux-mêmes et entrent dans un cycle de représailles est pris au sérieux à la mairie. « Depuis un an, nous constatons une recrudescence des agressions et des règlements de comptes, des tentes incendiées… Nous ne pouvons tolérer que le bois devienne une zone de non-droit », explique Dominique Bordin. C’est pourquoi, en plus des nombreuses associations et du SAMU social qui quadrillent le terrain, les institutions sont particulièrement présentes : unité d’assistance aux personnes sans abri, parcourant le bois de 7 heures à 2 heures du matin, garde républicaine à cheval…
Cette violence est exacerbée par les difficultés du quotidien. « Des jours ça va, mais d’autres, tu crèves la dalle. La première semaine du mois, tu vis sur ton RSA ; la deuxième, c’est dur ; la troisième t’es cuit. Le bois, c’est une semaine de fête et trois semaines de merde », lâche Stéphane.
Travail au noir
Pour survivre, certains font la manche, d’autres de la récup, chinent, aident sur les marchés, comme Ali. « Avant, je bossais dans le bâtiment, mais les patrons sont devenus des esclavagistes. Comme il y a de plus en plus de gens prêts à tout pour quelques euros, ils te font trimer toute la journée pour 20 euros ! » On rencontre aussi des personnes travaillant au noir épisodiquement, voire régulièrement. « Quelques habitants sont des quasi-salariés », confirme Pierre Dereux, du Secours catholique. Sur les 62 personnes orientées par Emmaüs solidarité vers un hébergement en 2015, 63 % étaient sans ressources, 26 % percevaient le RSA, 6 % une retraite.
Pour la mairie de Paris et les associations, le travail est colossal, car leur logique – sortir les habitants du bois pour entamer un parcours d’insertion – n’est pas forcément celle des principaux intéressés. Certains semblent revendiquer leur marginalité – comme Alain, 45 ans. Vivant au bois depuis sept ans, il travaille presque tous les jours au noir dans un restaurant. « Cette société exclut ceux qui ne se plient pas au système. Mais ici, je suis chez moi. Je ne demande rien à personne, seulement qu’on me laisse vivre, tranquille », dit-il. Comme bon nombre d’« anciens du bois », il dit ne pas attendre grand-chose des associations. « Pour obtenir quoi ? Un foyer ? »
« Le fait qu’ils ne soient pas dans une dynamique de sortie du bois est problématique. Même si, souvent, les plus âgés ont tendance à reconsidérer leur choix », souligne Dominique Bordin, à la mairie de Paris. « Il peut aussi s’agir d’un mécanisme de défense. A nous de leur montrer qu’accepter une place en hébergement collectif est une première étape vers un logement de transition », explique Houda Ben Laiba, chef de service à Emmaüs solidarité.
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web
D’autres habitants sont demandeurs d’aide, mais leur dépendance à la drogue ou à l’alcool freine tout projet de réinsertion. Enfin, il y a les plus jeunes, les moins de 25 ans, plus nombreux depuis 2015. « Ils sont souvent polyconsommateurs et en groupe, cela ne facilite pas le travail des associations », note Dominique Bordin. « D’un autre côté, la dynamique de groupe peut aussi entraîner un effet positif. Lorsqu’une personne s’en sort, elle sert d’exemple », tempère Houda Ben Laiba.
En 2015, l’association a réussi à orienter 62 personnes, dont une vingtaine dans des structures dites « de stabilisation » et sept dans des logements « adaptés », dernière étape avant un logement ordinaire (« de droit commun »). Une gageure vu le manque de solutions pérennes. En 2015, l’association a sollicité 571 fois les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), la plate-forme qui régule les demandes d’hébergement d’urgence, et n’a obtenu que 23 propositions. « A force d’attendre, les personnes accompagnées peuvent se démobiliser, avec le risque de rompre le lien de confiance que nous avons tissé », prévient Houda Ben Laiba.
En cause, la rareté des places pour des besoins sans cesse croissants, exacerbés par l’arrivée des réfugiés. « Malgré nos efforts, nous sommes contraints d’utiliser temporairement des places du 115 [le Samu social], ou d’autres dévolues aux SDF, pour les migrants », reconnaît Dominique Bordin. Cette concurrence de la misère n’a pas échappé à certains habitants du bois. « Et nous, alors ? Comme je suis française, les gens estiment que, si je suis dans la merde, c’est ma faute », lâchait cet été Céline, avant de soupirer : « Moi aussi, j’aimerais avoir un hébergement. » Depuis, elle a obtenu une place temporaire dans un hôtel.