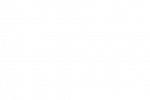Ivan Jablonka récompensé par le prix Médicis du roman français

Ivan Jablonka récompensé par le prix Médicis du roman français
Par Eric Loret
Après le prix littéraire du « Monde », l’écrivain a été à nouveau distingué, le 2 novembre, pour « Laëtitia ou la fin des hommes » (Seuil), une « non-fiction » incandescente.
Ivan Jablonka, déjà récompensé par le prix littéraire du « Monde » le 7 septembre, reçoit le prix Médicis du roman français pour « Laëtitia ou la fin des hommes » (Seuil). | JOEL SAGET/AFP
Ivan Jablonka, déjà récompensé par le prix littéraire du Monde le 7 septembre, reçoit le prix Médicis du roman français pour Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil). Face à lui, un ensemble de concurrents qui ne déméritaient pas, que ce soit Nathacha Appanah, pour Tropique de la violence (Gallimard), Denis Michelis, avec Le Bon Fils (Notabilia) ou Céline Minard pour Le Grand Jeu (Rivages), entre autres.
Le choix de Laëtitia vient récompenser, parmi toutes ces fictions, un texte de « non-fiction » incandescent, de la lecture duquel il est malaisé de se déprendre et qu’on oublie tout aussi difficilement. C’est, en outre, un livre sur la crête, à la fois parce que l’enquête sociologique qu’il mène se présente sous une forme hautement littéraire, usant de tous les charmes du récit classique et moderne, brouillant subjectivité et objectivité, mais aussi parce que le narrateur, Ivan Jablonka, trempe sa chemise psychanalytique et intime dans l’âme d’une victime d’un fait divers et dans celle de son bourreau.
Avec ce deuxième prix littéraire, l’essai de sciences sociales qu’est a priori Laëtitia (il est publié dans la célèbre collection « La librairie du XXIe siècle », dirigée par Maurice Olender), fondé sur des « fictions de méthode » et explorant les limites de l’humanité, continue donc à faire bouger les lignes de « genre » dans le champ de l’écriture contemporaine.
« Une profondeur humaine et un certain état de la société »
Contemporain, le livre d’Ivan Jablonka l’est aussi en ce sens qu’il « reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps », selon la formule d’Agamben. L’auteur, historien de formation, a beaucoup écrit, entre autres dans L’histoire est une littérature contemporaine (Seuil, 2014), sur cette impureté qu’il appelle les « fictions de méthode » et qu’il définit ici comme « des hypothèses capables, par leur caractère imaginaire, de pénétrer le secret d’une âme et d’établir la vérité des faits ». Le fait divers sera pour lui l’occasion de toucher « une profondeur humaine et un certain état de la société » : « Un fait divers émerge, naît à la conscience publique parce qu’il se trouve à l’intersection d’une histoire, d’un terrain médiatique, d’une sensibilité et d’un contexte politique. » Le programme de Laëtitia ou la fin des hommes est de raconter la France de ce début de siècle.
Tandis que la police, tout au long du texte, recherche le corps manquant de Laëtitia, l’auteur cherche le cœur absent de l’homme, dans un projet quasi messianique : « Je voudrais […] délivrer les femmes et les hommes de leur mort, les arracher au crime qui leur a fait perdre la vie et jusqu’à leur humanité. Non pas les honorer en tant que “victimes”, car c’est encore les renvoyer à leur fin ; simplement les rétablir dans leur existence. Témoigner pour eux. »
Pour cela, Jablonka interroge tous les témoins de la tragédie, et en particulier Jessica, la sœur jumelle de Laëtitia. Il retrace toute l’enquête, fait le portrait sociologique des victimes et des bourreaux, tente d’établir la généalogie d’un mal qui vient toujours de plus loin : du père biologique de Laëtitia, Franck Perrais, qui « a été successivement apprenti menuisier, apprenti pâtissier, apprenti mécanicien, apprenti en apprentissages », et du père adoptif des deux filles, « M. Patron », plein d’un « sentiment de toute-puissance et de supériorité sociale qui vise à souligner, tout à la fois, la défaillance des parents et l’incompétence des éducatrices ». On apprendra plus tard que Patron a violé Jessica et fait quatre autres victimes. Il sera condamné à huit ans de prison en 2014.
Assez vite, sans doute, Jablonka se rend compte que Laëtitia est inconnaissable. Recensant les goûts musicaux de la jeune fille (Rihanna, Sexion d’Assaut, la B. O. d’Avatar…), il en déduit d’abord que « Laëtitia est l’incarnation du grand public, le contraire de l’indisciplinée ».
Mais, faisant aussitôt volte-face, il replonge dans ses propres souvenirs de « junk culture » et se rappelle entre autres le dessin animé Candy, « qui [lui] fait aujourd’hui venir les larmes aux yeux » : aussi grotesque que la notation puisse paraître, elle signifie l’effectivité du transfert, en quelque sorte, qui permettra à Jablonka de titrer son avant-dernier chapitre « Laëtitia, c’est moi » : « Cette culture de masse fait battre mon cœur. Mon enfance formatée me manque, parce que c’est mon enfance et qu’elle a accouché de l’adulte que je suis, individu au sein d’une génération. » Et de conclure : « Je me trompe au sujet de Laëtitia […]. Elle gardait de la distance par rapport à ce qu’elle regardait. »
Le mauvais père et le mauvais président
L’enfant manque donc. C’est par ce défaut que se fait le lien entre l’auteur et son sujet. Une victime dont l’enfance a été massacrée, d’un côté, un historien reconnu, adulte, de l’autre, qui a écrit une Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (Seuil, 2012).
Orphelinage généralisé : « J’aimerais […] retrouver le flou, le vague, la propension à l’oubli, le sentiment d’impuissance et d’incompréhension qu’il y a dans l’esprit d’un enfant, Laëtitia, Jessica ou le tout-petit que nous fûmes. »
Par cette émotion de la perte, de l’archéologie impossible de soi, Ivan Jablonka en vient alors à ce qui semble son vrai sujet, à la suite de Foucault : le rapport du pouvoir et du peuple. Il établit petit à petit un parallèle entre le mauvais père que fut M. Patron et la figure de mauvais président que fut, selon lui, Nicolas Sarkozy.
La réalité lui facilite la tâche : l’ancien président de la République s’était emparé des objurgations de Patron pour mettre en cause les juges, qu’il accusa de laxisme, et auxquels il promit des sanctions : « M. Patron entretient un rapport ambigu avec les médias. Or le vocabulaire de la douleur n’est pas neutre. “Faire justice”, “faire payer”, lutter contre la “récidive”, enfermer à vie les délinquants sexuels : Nicolas Sarkozy reçoit, de la part des Patron, un soutien appréciable. » Mais Patron se révélera être un criminel : « On comprendra alors que le président de la République a combattu les délinquants sexuels aux côtés d’un pédophile. »
Un crime contre le peuple
Moyennant une intéressante rhétorique des larmes, le récit du crime contre une jeune fille du « peuple » devient, sous la plume de Jablonka, l’analyse d’un crime contre le peuple tout entier. Où l’on voit un juré pleurer au détail des méfaits de Tony Meilhon et, quelques pages plus loin, un juge pleurer en écoutant Nicolas Sarkozy à la télévision, qui déclare que « les magistrats sont responsables » : « Le criminopopulisme des années Laëtitia, écrit l’historien, trahit la recherche de la division, l’instillation de la méfiance et de la haine dans le corps social – un président de la République blessant la République. »
Par-delà la figure de Laëtitia et d’une féminité victime des « masculinités dévoyées au XXIe siècle », c’est bien à la question du pouvoir que le livre in fine achoppe : comment bien gouverner, c’est-à-dire comment être un père sans patriarcat. Mais cette question de la loi s’étend aussi à celui qui prend la parole et témoigne : face à la « fin des hommes », de quoi s’« autorise » l’auteur de ce genre de récit ?