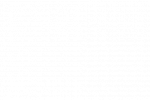Grand-Lahou, le village ivoirien qui s’efface, mangé par l’océan

Grand-Lahou, le village ivoirien qui s’efface, mangé par l’océan
Par Rémi Carlier (Grand-Lahou, envoyé spécial)
Chaque année, l’Atlantique avance de plusieurs mètres sur la presqu’île habitée par près de 7 000 pêcheurs et planteurs, coincés entre mer et lagune.
Regard rivé sur l’océan, Dieudonné Tabah semble épuisé. Les bras chargés de bambous, le pêcheur marque une pause et fixe les vagues, qui viennent s’écraser à quelques mètres de ses pieds. Le bout de structure qui tient encore debout, à ses côtés, constitue ce qu’il reste de sa maison : il la démonte pour la reconstruire plus loin, hors de portée des éléments. En moins de dix ans, « c’est la quatrième fois que je déménage, déplore-t-il, résigné. L’Atlantique se rapproche sans cesse. »
Des maisons comme celle de Dieudonné, Lahou-Kpanda en compte des centaines. A 150 km d’Abidjan, le village de près de 7 000 habitants, érigé sur une langue de sable coincée entre océan et lagune, constitue ce qu’il reste de la ville coloniale de Grand-Lahou. L’ensemble des administrations de cette dernière et une grande partie de la population ont été réimplantés en 1973 à 18 km de là, loin de la côte. Aujourd’hui, ils sont près de 12 000 à vivre dans la « nouvelle ville » de Grand-Lahou.
« En voie de disparition »
Car la zone disparaît. Lentement mais sûrement. Depuis quarante ans, le rivage est avalé vers le nord par l’océan, à raison de 1 à 2 m par an. « Dans mon enfance, on pouvait marcher 3 km depuis la lagune avant d’atteindre la mer. Aujourd’hui, il y a 500 m au plus », évalue Eugène Koffi, né dans la commune en 1943. Le phare, l’école, l’hôpital qui l’a vu naître, les ruines des maisons coloniales qui attiraient les touristes, tout a disparu. Face à la tombe de sa mère, enterrée sous les cocotiers, il montre les murs du cimetière, branlants, attaqués à chaque forte marée. « Beaucoup d’habitants ont fait transférer les cercueils et les pierres tombales loin d’ici, vers la nouvelle ville », précise-t-il.
Le cimetière de Grand-Lahou est régulièrement attaqué par les vagues. Il y a quarante ans, l’océan était à 2 km du mur d’enceinte. | Rémi Carlier
La montée des eaux grignote aussi le village par l’ouest. Grand-Lahou a été construit en bordure de l’embouchure du fleuve Bandama, l’un des plus importants cours d’eau du pays, qui migre d’est en ouest à une vitesse hallucinante, contribuant à la disparition des bâtiments. « L’embouchure se déplace d’environ 40 m par an, et se trouve aujourd’hui à 1 km de son lieu d’origine », décrit Eric Valère Djagoua, coordinateur du programme national de gestion de l’environnement côtier. De fait, le village fait aujourd’hui 2,5 km de large, contre près de 6 km à l’époque coloniale. « C’est une zone en voie de disparition », ajoute le professeur.
Non contents de reculer vers la lagune, les pêcheurs s’amassent maintenant vers l’ouest, le long du grand cimetière qu’ils ne veulent pas toucher. « Il n’y a plus de place. On ne sait plus où aller », se lamente un groupe de pêcheurs béninois, qualifiés d’« allogènes » dans le village. Comme beaucoup, ces « étrangers » refusent de rejoindre la ville nouvelle, trop chère et trop loin de la mer pour pouvoir vivre de la pêche.
Rejoindre sa case en pirogue
Au-delà du cimetière, il y a bien de la place, mais les terrains sont déjà tous occupés par les « autochtones », les habitants historiques de l’ethnie Avikam qui, comme Eugène Koffi, ont toujours vécu à Lahou et possèdent encore des maisons en dur. « Il m’est arrivé de devoir rejoindre ma case en pirogue. Dès qu’il pleut, on a les pieds dans l’eau », explique-t-il.
Face à une telle catastrophe, pourquoi rester ? Les villageois sont partagés. De nombreux Avikam ne veulent pas abandonner la terre de leurs ancêtres. D’autres restent pour la pêche. Pourtant, la lagune et l’embouchure, autrefois très poissonneuses, sont de plus en plus ensablées. La navigation y est difficile et les filets ne ressortent plus pleins à craquer. Mais la plupart des villageois s’accordent à dire qu’ils n’ont tout simplement pas d’autre endroit où aller.
Eugène Koffi se recueille sur la tombe de sa mère. Né à Grand-Lahou à l’époque coloniale, il a vu son village disparaître petit à petit. | Rémi Carlier
« Si on ne fait rien, c’est une population entière qui va disparaître », alerte le professeur Djagoua. Lahou-Kpanda est l’un des visages les plus flagrants de l’érosion côtière qui touche l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. A ce titre, il a été choisi en mai comme site pilote pour le programme de gestion du littoral ouest-africain de la Banque mondiale, le WACA, lancé en 2015 pendant la COP21 à la demande de plusieurs pays de la région. Le programme vise à identifier les facteurs d’érosion et d’inondation côtière, et à réfléchir aux aménagements nécessaires pour endiguer le problème.
Un plan multisectoriel d’investissement à Grand-Lahou devrait démarrer en 2017, afin d’évaluer l’ampleur du phénomène. « Une carte des risques doit être établie, pour montrer les endroits dangereux et leur évolution. On doit aussi voir combien ça coûtera. S’il est possible de faire des aménagements, on le fera. Mais si ça coûte trop cher, on devra envisager de déplacer la population », avoue Eric Djagoua, tout en reconnaissant que « les choses ne vont pas changer dans l’immédiat ». De fait, rien n’a été fait pour endiguer la montée des eaux à Lahou et aucun terrain n’a été proposé pour le moment, malgré l’appel « d’urgence » lancé en 2015 par la municipalité.
« Les gens de la Banque mondiale, les députés sont venus, le ministre de l’environnement aussi, et à chaque fois on a repris espoir. Mais, au final, rien ne change, et Lahou va disparaître », se désole William Attawa, chef provisoire de Lahou-Kpanda, les larmes aux yeux. Du bout du doigt, il pointe l’étendue sablonneuse de sa cour, face à l’océan, où il a l’habitude d’étendre sa natte pour se reposer. Un rituel qu’il a toujours connu, et qui, il le craint, ne sera bientôt plus qu’un souvenir.