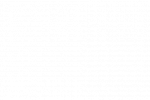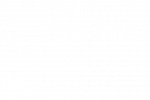« L’école algérienne entre incompétence et obscurantisme »

« L’école algérienne entre incompétence et obscurantisme »
Un collectif d’intellectuels dénoncent l’appauvrissement et la « néo-salafisation » de la langue arabe dans la société.
Dans aucun pays du Maghreb et du Machrek, la langue arabe – langue de l’enseignement public – ne suscite et déchaîne autant de passions qu’en Algérie. Elle est constamment sujette à des tensions politiques et à des disputes idéologiques extrêmes. Car ceux qui la défendent bruyamment ne la conçoivent que comme une langue rituelle et patrimoniale. Et même lorsqu’ils ne récusent pas le fait qu’elle soit une langue de culture, ils ne se soucient ni de la forme ni du contenu de cette culture. La langue leur suffit : elle leur tient de culture.
Alors qu’ils en font une affaire « existentielle », comme ils disent, ni eux ni leurs enfants, et par conséquent les élèves de nos écoles, ne consentent à l’effort de l’apprendre véritablement pour en faire sereinement l’instrument linguistique d’un accomplissement individuel et social heureux. La langue arabe est, chez nous, mal parlée, mal apprise, parce qu’elle est sans contenu, aussi pauvre et sèche qu’un filet d’oued saharien. Tant qu’on n’aura pas compris que le contenu et la richesse d’une langue, ce que l’on nomme son génie, c’est sa culture, telle qu’elle est cristallisée dans ses monuments littéraires et esthétiques et qu’elle se déploie à travers sa créativité présente et future, elle restera sans contenu.
Décrépitude et déchéance
Alors, plus on affecte de s’indigner pour elle, et plus on s’emploie à œuvrer à sa décrépitude et à sa déchéance. Les peuples ne sont dignes des langues dont ils se réclament que s’ils les fructifient et en partagent le fruit récolté avec le reste du monde. Et quel est l’état de la culture arabe en Algérie ? Médiocre. Sans doute parce que les Algériens sont coupés du patrimoine littéraire classique de cette langue, que quasiment plus personne ne lit parce qu’il est devenu incompréhensible, y compris pour la plupart des membres de l’élite intellectuelle. En soixante ans d’existence, l’école algérienne n’a rien enseigné de tout cela.
Or tous les systèmes d’enseignement dignes de ce nom, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, reposent sur la connaissance et l’apprentissage des classiques, sans quoi il n’y a pas de modernité littéraire. Il en est ainsi depuis que l’école existe : chez les Grecs comme chez les Romains, dans la Chine ancienne comme dans l’Inde védique, chez les Perses sassanides comme chez les Arabes à leur âge classique, et, plus encore, à l’époque moderne depuis la Renaissance italienne.
Ainsi, la culture arabe classique a réussi à faire ce dont la culture arabe moderne est incapable (et pas uniquement chez nous) : à doter les Arabes musulmans de deux cultures, l’une religieuse et l’autre profane. A l’époque classique, on pouvait consacrer sa vie à étudier l’une sans toucher à l’autre, ou à les étudier l’une au côté de l’autre pour les posséder simultanément.
Adeptes de la sottise
Et pourquoi donc ? Parce que l’islam n’est pas qu’une religion, il est aussi une culture. S’il n’était resté qu’une religion, il n’aurait même pas pu ni su développer ses propres sciences religieuses telle que la théologie. Car toutes ces sciences nécessitent la maîtrise d’une pensée spéculative que l’on ne peut acquérir ni développer en l’absence de la logique. Or la logique n’est ni arabe ni islamique, elle est grecque. Les livres mêmes dans lesquels sont exposées ces sciences religieuses ont emprunté leurs techniques de composition, leurs modèles d’écriture et leurs traditions littéraires à la plus prestigieuse de toutes les cultures antiques : la culture hellénistique. Les faux défenseurs de la langue arabe de chez nous, ceux qui sont responsables de son naufrage scolaire, ne savent pas – bien sûr – qu’ils sont tributaires de la culture grecque jusque dans la façon dont ils ont appris à lire et à écrire la langue arabe, et qui est celle que les écoles coraniques ont perpétuée depuis des siècles.
Quant à ceux qui s’imaginent que la langue arabe est une langue sacrée, voire la langue sacrée par excellence, ils ne sont rien moins que des adeptes de la sottise. D’abord parce que la plupart des langues s’imaginent descendre du ciel ; ensuite parce que les prétendus arguments religieux sur lesquels cette allégation est bâtie sont apocryphes. On a bien fait dire au prophète Mahomet que, de toutes les langues, c’est l’arabe qui était sa préférée parce qu’elle est « la langue des gens du paradis ».
Mais ce pseudo-hadith est considéré, y compris parmi les grands maîtres de l’école juridique hanbalite, comme une « forgerie ». Or ce même prétendu hadith est réhabilité par le néosalafisme, qui en a fait l’emblème de sa religiosité tactique. En effet, ce type de hadiths est le pain quotidien des prédicateurs et des sermonnaires dont la plupart des récits par eux colportés relèvent de cette catégorie. Force est de constater que c’est le discours de ces derniers qui tient lieu de religion à l’école algérienne, comme en témoigne la vidéo mise en ligne par une institutrice le jour même de la rentrée scolaire de cette année 2016-2017.
Néosalafisme
Outre son caractère abrutissant, cette rhétorique de la défense de l’école au nom de la religion tend à faire de celle-ci une mécanique tranchante : d’un côté le halal (« autorisé par la religion »), de l’autre le haram (« interdit par la religion »). Or dans le système normatif islamique, tous les actes humains sont soumis, non pas à une, mais à deux échelles de qualification, qui s’appliquent concurremment à ces actes : l’une est religieuse, l’autre légale. C’est l’ensemble de ce système que le néosalafisme a détruit dans notre pays. Il n’y a plus que l’ibadisme – l’une des trois composantes de l’islam avec le sunnisme et le chiisme – qui témoigne aujourd’hui pour la religion de nos pères. Or l’Etat, tout autant que la société, le défend mal des menaces qui pèsent sur lui et qui sont source de divisions, dont un certain aveuglement national ne mesure pas les dangers.
Ces menaces sont les mêmes qui pèsent sur les différentes expressions langagières du berbère. En attendant leur sauvegarde, pour les unes, leur standardisation, pour les autres, l’école doit d’ores et déjà s’atteler à enseigner leur littérature : poésie, geste, contes, mythes. Cette littérature berbère ne doit en aucun cas être limitée aux zones berbérophones. Elle doit aussi bien être enseignée à la partie arabophone du pays, qui doit la redécouvrir et l’assimiler comme une part oubliée de sa propre profondeur historico-culturelle.
Pour revenir à la langue arabe classique, qu’il soit entendu qu’elle n’a rien de sacré et n’a nul besoin d’être sacralisée pour être appréciée et aimée. La langue technique caractéristique du Coran, avant d’être le support de la parole d’Allah, fut celle des poètes rhéteurs, des orateurs, des devins et des prêtres du paganisme arabe. Et d’ailleurs, si la langue arabe était si sacrée que le prétendent les néosalafistes, pourquoi le Coran nous est-il parvenu dans une écriture (graphie) inventée par des communautés arabes chrétiennes vivant entre la Jordanie et la Syrie d’aujourd’hui ?
Tensions idéologiques et politiques
Malheureusement, l’islam est privé de son histoire et réduit à n’être qu’un ensemble de techniques rituelles. Or nous voulons que la religion n’envahisse pas tout l’espace scolaire, au risque de sa stérilisation totale. Ceci n’est pas une revendication de laïcs athées, comme le prétendent les détracteurs de l’école moderne. C’est une revendication qui est pensée et mesurée à l’aune de l’Histoire : l’islam classique n’a pu devenir la grande civilisation que l’on connaît que parce qu’il a su distinguer les sciences traditionnelles des sciences rationnelles, jusqu’à ressusciter le curriculum d’étude de la philosophie étudiée de façon autonome.
Pourquoi l’école algérienne est-elle constamment tiraillée par des tensions idéologiques et politiques d’une violence extrême ? A la vérité, depuis l’époque du président Ben Bella, les gouvernants successifs sont restés prisonniers – intellectuellement s’entend – des paradigmes pédagogiques des parties qui ont fait de l’école leur terrain de compétition politique et idéologique.
Maintenant, la médiocrité de l’école algérienne est bien là, et nul ne peut la contester. Elle a mutilé des générations d’élèves. Comment, dans ces conditions, exprimer une quelconque pensée si l’on ne maîtrise pas parfaitement la langue dans laquelle on a étudié pendant dix, quinze, voire vingt ans ! Comment aimer son pays et cimenter durablement sa communauté de destin si personne ne connaît son Histoire ? Comment s’ouvrir au monde si l’on reste monolingue ? Comment s’accomplir pleinement dans son humanité et dans sa citoyenneté si l’on ne dispose d’aucun bagage culturel, si l’on n’a ni goût de la lecture ni amour de l’art ?
Libre arbitre
Pourquoi en effet faut-il que notre école adopte quasi officiellement le credo de la prédestination et du déterminisme ? Savoir si l’homme est déterminé ou libre et responsable de ses actes est pourtant une question que le Coran n’a pas tranchée. Il l’a laissée en débat entre les croyants, « afin qu’ils raisonnent », en donnant des arguments aux uns et aux autres.
Or, après avoir mis en crise toutes les expressions de la religiosité sunnite et s’être substitué à elles, partout où il a conquis des espaces sociaux et institutionnels, le néosalafisme a répandu le fatalisme au point de nier à l’homme son existence en tant qu’être de volonté. Pis, il a fait du libre arbitre l’« essence de l’incroyance », alors même que, dans le Coran, il y a autant de versets pour que contre le libre arbitre : au total, seize de part et d’autre. Le Libre arbitre est le seul credo philosophique qui convienne au monde complexe dans lequel nous vivons. Il faut que l’école puisse donner aux enfants qui lui sont confiés par millions les clés de leur « être-au-monde », afin que notre Algérie soit digne de son rang dans le concert des nations et qu’elle œuvre au bonheur et à la prospérité de tous comme une part de son humanité.
Ahmed Djebbar, mathématicien et historien des sciences, professeur émérite à l’université des sciences et des technologies de Lille, ancien ministre de l’éducation nationale algérienne ; Abderrezak Dourari, linguiste, professeur à l’université d’Alger ; Mohammed Harbi, historien et ancien dirigeant du FLN ; Wassiny Laredj, écrivain et professeur de littérature moderne aux universités d’Alger et de Paris-III-Sorbonne-Nouvelle ; Khaoula Taleb-Ibrahimi, linguiste, professeure à l’université d’Alger ; Houari Touati, historien, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris.