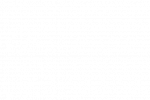« Chemise arrachée » : les salariés d’Air France attendent le délibéré

Procès de la « chemise arrachée » : les salariés d’Air France attendent le délibéré
Le Monde.fr avec AFP
Le procureur avait requis de la prison avec sursis et des amendes contre les quinze prévenus, poursuivis pour « dégradations » et « violences en réunion ».
Le cliché de la « chemise arrachée » fit le tour du monde. Le 5 octobre 2015, les deux directeurs des ressources humaines de la compagnie Air France avaient dû, torse nu, escalader une grille pour échapper à une foule de salariés en colère.
Jugés pour leur implication supposée dans cet épisode de violence, quinze salariés de la compagnie aérienne connaîtront leur sort mercredi 30 novembre. A la fin de septembre, le procureur de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny avait requis de deux à quatre mois de prison avec sursis contre cinq salariés et une amende de 1 000 euros contre les dix autres.
Lors de l’audience, le président avait tenté de reconstituer cette journée du 5 octobre 2015. Ce jour-là, des centaines de manifestants s’étaient réunis au siège de la compagnie, à Roissy (Val-d’Oise), à l’appel des organisations syndicales pour protester contre un plan de restructuration qui visait à supprimer 2 900 emplois. Une centaine de salariés avaient alors fait irruption dans la salle où se tenait un comité central de l’entreprise.
Lors d’un mouvement de foule, le directeur des ressources humaines, Xavier Broseta, et celui de l’activité long-courrier, Pierre Plissonnier, avaient été malmenés, de même que certains des vigiles assurant leur protection. Les deux directeurs avaient dû fuir sous les huées et les cris de « à poil, à poil ! » et « démission ! », torse nu pour le premier, la chemise en lambeaux pour le second.
La légitimité du recours à la violence
« Inacceptable », « scandaleux », « irresponsable » : les images de la chemise arrachée avaient donné lieu à un concert d’indignations politiques. Surtout, elles avaient conforté la mauvaise réputation de la France en matière de dialogue social aux yeux d’observateurs étrangers. En retour, la déclaration du premier ministre, Manuel Valls, qualifiant de « voyous » les militants CGT, avait choqué une partie du monde salarié et ouvert un débat sur le recours à la violence physique face à la « violence » d’un plan social.
D’abord prévu en mai, le procès de quinze militants syndicaux pour « dégradations » et « violences en réunion » s’est tenu le mardi 27 septembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Qui a arraché la chemise du DRH ? Est-ce un ou plusieurs salariés, ou un vigile qui tentait de l’aider à échapper à la foule ? Ces questions avaient nourri les débats.
« J’ai touché le col, c’est tout, pour qu’il se retourne et pour lui parler », avait assuré l’un des prévenus, mis en cause par le témoignage d’un agent de sécurité. Un autre, confronté à une capture d’image, avait seulement admis que sa main « [était] partie dans cette direction », pour protéger, pas pour frapper.
« Une opération de casseurs »
Certains prévenus avaient également fait part de leur sentiment d’injustice. Car, comme l’avait lui-même reconnu le parquet, tous les auteurs des violences n’avaient pu être identifiés sur les vidéos.
Avocate de douze prévenus, Me Lilia Mhissen avait, elle, dénoncé tout au long du procès « un dossier bâclé » où domine la volonté de trouver à tout prix des « boucs émissaires ». « Ça n’est pas une opération syndicale, avait pour sa part déclaré le procureur, Philippe Bourion, lors de son réquisitoire. C’est une opération de casseurs, de voyous. »
« Les gens qui ont arraché la chemise ne sont pas présents aujourd’hui », avait, pour sa part, affirmé Vincent Martinez, délégué du personnel CGT au moment des faits, le seul des quinze à avoir été licencié. Avant le délibéré, il s’est dit « serein », souhaitant « passer à autre chose ».