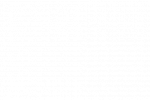A Tunis, une exposition réveille l’histoire précoloniale du pays

A Tunis, une exposition réveille l’histoire précoloniale du pays
Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)
« L’éveil d’une nation » rappelle le vent réformateur qu’ont fait souffler les beys sur la Tunisie au cours du XIXe siècle, avant les Français, avant Bourghiba.
L’exposition « L’éveil d’une nation, l’art à l’aube d’une Tunisie moderne (1837-1881) », organisée par la fondation Rambourg au palais Ksar es-Saïd, à Tunis, est une première à plus d’un titre. Première fois que l’Etat tunisien confie une collection et un bâtiment publics à un organisme privé pour en assurer la restauration et l’exposition ; première fois qu’une opération culturelle est montée avec un budget aussi conséquent (800 000 euros, abondé à 95 % par la fondation Rambourg) ; première fois que le palais, laissé à l’abandon depuis 1956, est ouvert à une audience qui avait oublié jusqu’à son existence ; première fois enfin que tout un pan de l’histoire précoloniale tunisienne, occulté depuis l’indépendance, est exploré.
Le régime de Habib Bourguiba s’était en effet appliqué à effacer tous les signes de la dynastie beylicale, responsable d’avoir pavé la voie au protectorat français. L’autoritarisme et la mauvaise gestion du monarque Sadok Bey ont certes fragilisé le pays et précipité sa mise sous tutelle. Mais ce que dévoile cette exposition, ouverte depuis le 27 novembre, c’est surtout le vent réformateur qu’ont fait souffler les beys sur la Tunisie. Une relecture de l’histoire cruciale dans un pays en pleine psychanalyse.
Une Tunisie « déboussolée »
« La Tunisie postrévolutionnaire est déboussolée, avec beaucoup de non-dits, de frustrations, de schizophrénie aussi. C’est un pays qui a besoin d’ancrages, de repères », souligne Olfa Rambourg, qui a créé la fondation éponyme en 2011, aux lendemains de la révolution du « printemps arabe ». Et d’ajouter : « J’aimerais que les Tunisiens se regardent dans un miroir. L’Orient ne se regarde jamais dans le miroir, car c’est toujours de la faute de l’autre, ou c’est Dieu qui a le mot de la fin. Rien n’est jamais de notre faute, rien n’est jamais grâce à nous. »
Un fatalisme qui confine à la léthargie. Il a fallu une volonté de fer pour convaincre l’Institut national du patrimoine de s’associer au projet et de prêter une quarantaine d’œuvres de sa collection, stockée au palais Ksar es-Saïd. Olfa Rambourg se souvient de sa première visite dans ce palais, ancien siège de la souveraineté avant le protectorat. Le jardin planté d’eucalyptus était envahi de carcasses de voitures, d’amas de graviers et même d’un Zodiac. Ces encombrants n’ont été retirés par l’administration que quelques semaines avant le vernissage.
Tunisie : cinq ans après la révolution, le désenchantement
Durée : 06:46
Images :
AP, AFP, Reuters
A la lenteur administrative s’ajoutent les craintes d’ordre politique. Car raconter l’histoire, c’est fatalement adopter un point de vue, traiter de la fabrique de l’image et de la propagande. « L’Institut national du patrimoine était inquiet du symbole politique de cette exposition, admet un proche du dossier. Manier l’histoire, à un moment où tous les gouvernants sont sur des sièges éjectables, c’est compliqué. » Ce malaise explique-t-il le refus, au dernier moment, de la présidence de prêter trois grands tableaux ?
Un accrochage précis et didactique
Cette dérobade ne nuit pas à un accrochage aussi précis que didactique. Malgré la présence de quelques très beaux objets, notamment une salle de céramiques du Sud tunisien, l’idée, ici, est moins d’offrir une leçon d’art que d’histoire. Le récit débute avec Ahmed Bey, monogame, premier réformateur qui abolit l’esclavage en 1846 et ne dédaigne pas les voyages à Paris. Influencé par son oncle et ministre des affaires étrangères, Giuseppe Raffo, il s’affranchit de la tutelle ottomane pour se rapprocher des Européens. En 1857, la liberté de culte, préalablement donnée aux chrétiens, est étendue aux israélites. Le pacte fondamental garantit la liberté de culte et favorise le libre-échange.
Deux ans plus tard, la monarchie constitutionnelle est instaurée. Ces progrès sociaux déstabilisent la structure socio-économique traditionnelle, et déclenchent le soulèvement des chefs de tribus de 1864 à 1867, insurrection sévèrement punie par le pouvoir central. Et c’est là tout le paradoxe. « Les révoltés voulaient revenir à l’ancien régime, à la souveraineté absolue du bey, comme aujourd’hui certains voudraient qu’on retourne à l’ère de Ben Ali, résume Ridha Moumni, commissaire de l’exposition. Et, paradoxalement, le mouvement universaliste des beys aboutit à une violence inouïe. »
Une aporie qu’il est bon de souligner quand la « réconciliation » entre le parti musulman d’Ennahda et celui moderniste et sécularisé de Nidaa Tounès semble bien acrobatique. « Depuis la révolution, on est dans des débats manichéens. On dit aux Tunisiens que le choix qui leur est proposé c’est la modernité ou la tradition, regrette Ridha Moumni. Ce qu’on montre dans l’exposition, c’est qu’il y a cent soixante-dix ans, le même choix avait été proposé. Et celui qu’avait fait la Tunisie, c’était celui de la modernité, de l’universalisme. C’est un choix qu’on fera tout le temps. »
« L’éveil d’une nation, l’art à l’aube d’une Tunisie moderne (1837-1881) », jusqu’au 27 février 2017, palais Ksar es-Saïd, Tunis.