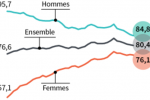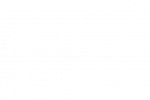Sur les traces de Nicolas Granger, mort à 40 ans

Sur les traces de Nicolas Granger, mort à 40 ans
Par Clarisse Fabre
La disparition brutale de l’acteur, qui ajoué sous la direction d’Arthur Harari, Jean-Christophe Meurisse et Pascal Rambert, raconte aussi la fragilité du cinéma d’auteur.
Nicolas Granger avec Emilie Brisavoine dans « Peine perdue » (2013), d'Arthur Harari. | Bathysphère productions
Le « mur » se remplit de souvenirs, mots tendres, chansons postées, extraits de films, réponses tardives d’amis perdus de vue et qui découvrent, sonnés, que Nicolas Granger s’en est allé. La page Facebook raconte par fragments la vie de ce comédien intense, connu dans le théâtre contemporain mais qui commençait seulement à « percer » dans le cinéma. On l’avait découvert en 2014, dans deux beaux films sélectionnés aux onzièmes Rencontres du moyen-métrage de Brive : Il est des nôtres (2013), de Jean-Christophe Meurisse, et Peine perdue (2013), d’Arthur Harari.
L’acteur avait dû quitter prématurément le festival, parce qu’il ne s’était pas bien tenu... Un grand classique chez lui. Il avait « un truc d’enfant » et un rapport compliqué aux limites, confirment ses amis. Mais il semblait évident que le grand brun au regard oblique – suivez la mèche –, à la maigreur christique, à l’élocution soignée et au timbre grave allait devenir un nouveau visage du cinéma d’auteur. La disparition brutale du comédien, vendredi 2 décembre, à Paris, à l’âge de quarante ans, a pris tout le monde de court. Bien sûr, ses proches le savaient fragile, et autodestructeur, mais sans doute pensaient-ils que son énergie créatrice était plus forte que tout.
« Un vrai être poétique »
En plus de jouer, Nicolas Granger écrivait des poèmes, des chansons, songeait à la mise en scène. « Il était obsédé par l’écriture », insiste Arthur Harari, qui avait commencé à lire à sa demande Les Souterrains (1958) de Jack Kerouac, en vue d’une adaptation. « Nicolas, c’était un mélange d’opacité presque perverse, et d’une énorme fragilité, d’une mélancolie désespérée », ajoute le réalisateur de Diamant noir, son premier « long » sorti cette année en salles.
Formé à l’école régionale d’acteurs de Cannes, l’Erac, il y rencontra Jean-Christophe Meurisse, qui deviendra son ami et fondera la compagnie des Chiens de Navarre. Nicolas Granger a joué au théâtre avec Pascal Rambert au début des années 2000 – lequel lui a donné son premier rôle au cinéma dans son « court », Quand nous étions punk (2005) – ainsi qu’avec George Lavaudant. « C’était un poète. Difficile. Comme tous les poètes. Mais oui un vrai être poétique », salue Pascal Rambert, qui se souvient tout particulièrement de Nicolas Granger dans sa pièce Paradis (un temps à déplier), créée en 2004.
« Eustachien, dadaïste »
Jean-Christophe Meurisse pleure son « clochard céleste » : « C’était un écorché vif, hyperactif, ingérable et en même temps plein de bonté. Il n’avait pas vraiment d’habitation, vivait chez les uns et les autres », raconte-t-il. Quand il était trop en galère, Nicolas Granger quittait Paris et retournait séjourner dans sa famille, à Périgueux. Tour à tour prenant puis absent. Sur les plateaux, il impressionnait par ses talents d’improvisateur. Son monologue dans Il est des nôtres, un huis clos filmé dans une caravane, comme pour mieux prendre ses distances avec la vie, est mémorable (et toujours visible sur Internet). « Il était quatre heures du matin, on discutait, on avait bu. J’ai demandé si quelqu’un avait quelque chose de personnel à raconter. Et Nicolas s’est lancé... », poursuit le réalisateur.
Très concentré, au milieu de cette folie douce, l’acteur parle de son impossibilité à vivre en couple, sauf une fois dit-il, où il s’est vu avancer tranquillement vers la mort avec une femme. « Il était eustachien, dadaïste. Il est notre Pierre Clémenti des temps modernes », ajoute Jean-Christophe Meurisse, évoquant cet acteur au charme ténébreux, connu pour ses fulgurances scéniques, né en 1942, mort en 1999 d’un cancer du foie, dandy destroy qui eut tout de même le temps de tourner avec Luchino Visconti, Philippe Garrel, Luis Bunuel, Pier Paolo Pasolini... « Je pensais que Nicolas était le genre de comédien qui allait émerger dans la deuxième partie de sa vie », se désole Jean-Christophe Meurisse, autre quadra qui lui aussi vient de signer son premier « long », Apnée.
« Il prenait le temps »
« Il aimait vivre un peu dangereusement, mais il nous disait pour nous rassurer : “Je m’occupe de ma santé, je m’occupe de ma santé !” », raconte Arthur Harari. « Dans Peine perdue, il était au centre du film et se sentait bien devant la caméra. Il avait obtenu le prix d’interprétation au festival de Vendôme. Par la suite, on l’a appelé pour des rôles. Ça bouillonnait, Nicolas allait dans des castings, mais il était frustré de voir que les choses ne décollaient pas comme il l’aurait souhaité », ajoute le réalisateur. Sa partenaire de jeu dans Peine perdue, Emilie Brisavoine, réalisatrice de Pauline s’arrache (2015), se souvient de son implication dans l’écriture des dialogues. « Il apportait beaucoup de choses à Arthur, et il avait toujours une anecdote profonde à raconter. Surtout, dans cette époque où tout le monde est pressé, lui prenait le temps. »
Arthur Harari lui avait donné un rôle dans Diamant noir, qu’il a dû couper au montage. « J’ai regretté cette coupe, mais comme cela arrive parfois au cinéma, une belle scène peut ne pas fonctionner dans un film. J’ai tenu toutefois à l’intégrer dans le bonus du DVD, car Nicolas y très fort : il joue un clochard dans la rue, qui éructe une logorrhée en boucle. C’est une transe qu’il parvient à faire », s’étonne encore le cinéaste.
« Nicolas avait un grand besoin de reconnaissance », résume Nicolas Anthomé, le producteur de Bathysphère, des films d’Arthur Harari, d’Emilie Brisavoine, soit l’un des représentants du nouveau cinéma français fauché – et salué par la critique. « Il prenait beaucoup de place. On ne se contentait pas de le croiser un peu avant le tournage. Il avait besoin que les gens fassent attention à lui », indique-t-il. « Nicolas était un comédien d’une grande intelligence, capable de charger un sourire de la fantaisie de l’enfance, de maudire brutalement d’un regard ou de caresser d’une inflexion de la voix », a témoigné Nicolas Anthomé dans un court texte hommage. Dans le Dieu bigorne, moyen-métrage de Benjamin Papin encore produit par Bathysphère, Nicolas Granger joue le rôle titre, nu et masqué, du monstre doux et vulnérable sorti des bois.
« Tu deviens gaga ? »
Depuis un an, il prenait beaucoup de notes. A sa manière. « La dernière fois que je l’ai vu, chez moi, il parlait tout seul. Je lui ai dit : “Tu deviens gaga ?” En fait, il composait des textes et s’enregistrait : c’est à l’oral que j’écris le mieux, me disait-il avec humour », raconte la chanteuse Jeanne La Fonta (nom de scène Lafonta), avec laquelle Nicolas Granger écrivait des chansons pop. Il n’écoutait donc pas que du rock minimaliste.
« Il aimait aussi la chanson populaire et il avait, caché sous sa mèche d’Albator, un côté girly qu’il assumait avec douceur. On avait le projet d’enregistrer quelques-uns de nos textes en décembre, au studio la Fugitive, à Ménilmontant », ajoute la jeune femme qui avait rencontré « Nicolas » lors d’un concert performance de son groupe P.O.U.F. – il fallait le faire – comme « Petite organisation ultra féminine ». Avec d’autres proches, Jeanne La Fonta est en train de rassembler les carnets de notes et les enregistreurs de Nicolas Granger, qui traînaient à droite et à gauche ces derniers temps.
« On est lâchés par les exploitants »
Le puzzle s’assemble, jour après jour, passée la sidération de l’annonce de la mort. Pour la directrice de casting Johanna Grudzinska, par ailleurs réalisatrice de documentaires, la disparition de Nicolas Granger raconte aussi la mauvaise pente du cinéma d’auteur, dans sa fragilité croissante. « Certes, les films de cette nouvelle génération sont soutenus par la presse, et primés dans les festivals. Mais ce cinéma est de moins en moins aidé, et on est lâchés par les exploitants. C’est comme le film d’Arthur Harari, c’est “Peine perdue de cinéma”. Nos aînés, Mathieu Amalric, Noémie Lvovsky, nous font travailler dès qu’ils peuvent. Sinon on tiendrait pas. En cela, Nicolas était un acteur invisible, dans un cinéma invisible. Et pourtant, quelle présence, à la fois fantômatique et insistante. », dit-elle.
La jeune femme avait retenu le comédien pour une apparition dans le dernier film d’Emmanuel Finkiel, La Douleur, adapté du roman du même nom de Marguerite Duras (P.O.L., 1985). « Je cherchais des gens très maigres, et on me l’a recommandé. Quand je l’ai vu traverser la cour de l’immeuble, en oblique, depuis le troisième étage, j’ai su que c’était lui. » Elle l’a à peine connu, mais son expérience lui disait qu’il allait ramer, du moins dans le cinéma « grand public ». « Nicolas, c’est le genre de physique que la plupart des producteurs et distributeurs ne veulent pas voir. Parce qu’il est hors norme, avec sa tête qui raconte que ce n’est pas toujours la fête, et son jeu bressonien ».
Finalement, dit-elle, on n’a jamais autant parlé de lui. Avec un sentiment de vertige, Johanna Grudzinska constate que « Nicolas n’a jamais été aussi présent que depuis qu’il est mort ». « C’est la naissance d’un personnage. Tous ces signes qu’il a laissés, dans différents champs artistiques, sont en train de prendre forme. C’est comme si l’on reliait des points entre tous ces auteurs qui essaient d’exister. Dans le cinéma, il devient représentatif du sacerdoce que représente un film à très petit budget. » Elle résume : « On le fait entre 20 et 40 ans, parce qu’on y croit très fort, et qu’on ne sait faire que ça. Et arrivés à 40 ans, on se demande si on va pouvoir continuer jusqu’à 50. Nicolas est mort à 40 ans ».