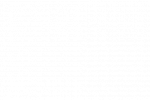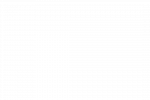Au Mozambique, des milliers de déplacés de guerre et des pourparlers de paix au point mort

Au Mozambique, des milliers de déplacés de guerre et des pourparlers de paix au point mort
Par Adrien Barbier (contributeur Le Monde Afrique, Vanduzi (Mozambique), envoyé spécial)
Au cours des derniers mois, 15 000 civils ont fui les combats entre l’armée et les guérilleros de la Renamo, le parti d’opposition.
Un soldat de l’armée mozambicaine dans le marché du village de Vanduzi, près du parc de Gorongosa, en mai 2016. | JOHN WESSELS / AFP
« Là-bas, c’est la guerre. Les bandits armés ne font que tirer, ils ont brûlé nos maisons, nous n’avions nulle part où aller. » Comme la plupart de ses congénères du camp de Vanduzi, dans le centre du Mozambique, Henriqueta reste évasive sur les circonstances qui l’ont poussé à s’y réfugier avec son fils de 4 ans. Cette veuve d’une trentaine d’années fait partie des 15 000 déplacés qui ont fui ces derniers mois les combats entre les troupes gouvernementales et la Renamo, le principal parti d’opposition, qui a repris les armes en 2013.
A Vanduzi, 130 familles se partagent une quarantaine de tentes bien alignées. Des latrines récemment renversées par le vent et le réservoir d’eau vide sont les seuls bémols à ce camp par ailleurs propre et bien organisé. Si le Mozambique est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, il sait traiter ses déplacés de guerre, semblent vouloir montrer les autorités.
« 3 100 personnes sont hébergées sur cinq sites dans la province du Manica », la plus touchée par le conflit, déclare Teixeira Almeida, le représentant de l’Institut national de gestion des catastrophes naturelles (INGC), qui gère les camps. La situation est en réalité bien plus critique : 11 500 personnes ont aussi trouvé refuge dans des familles d’accueil – des parents ou connaissances –, tandis que 8 600 autres ont préféré traverser les frontières pour s’entasser dans des camps au Zimbabwe et au Malawi.
Crise économique sans précédent
Cette explosion du nombre de déplacés et de réfugiés est un signe que le conflit larvé entre les deux protagonistes de la guerre civile mozambicaine, qui a fait un million de morts entre 1976 et 1992, pourrait à nouveau prendre de l’ampleur. Oubliée, la success-story de réconciliation nationale, qui a fait du Mozambique un exemple pour les organisations-non-gouvernementales dans les années 1990 et 2000 et un paradis pour les investisseurs depuis la découverte d’immenses champs gaziers en 2010. Ces derniers boudent désormais la nation d’Afrique australe, où les scandales de corruption ont provoqué une crise économique sans précédent. Mi-décembre, des pourparlers de paix sous médiation internationale ont tourné à l’aigre, mettant à bas tout espoir de retour rapide à la stabilité.
Pour la Renamo, c’est parce qu’ils sont réservés aux partisans du Frelimo, le parti au pouvoir, que les camps du Manica ne sont pas surchargés. « Lorsque dans un camp, on découvre que vous êtes membre de l’opposition, vous ne survivez pas », affirme Caetano Augusto, un représentant local du parti d’opposition. Qu’ils soient embrigadés ou terrorisés, les déplacés préfèrent donc en dire le moins possible sur les exactions qu’ils subissent.
Dans les campagnes mozambicaines, l’opposant décrit un climat de terreur : « La situation est dramatique. Nos membres sont persécutés, ils meurent quotidiennement, dit-il. Sans vergogne, en plein jour, nous pouvons nous faire enlever, qu’importe où nous nous trouvons ». A mots couverts, il évoque les « escadrons de la mort », qui éliminent les membres de son parti en toute impunité.
En représailles, depuis février, des guérilleros attaquent les véhicules circulant sur les principales routes nationales et s’en prennent aux figures locales du Frelimo. Bilan : des dizaines de morts et de blessés, et sûrement plus. La police ne dévoile pas de statistiques pour un conflit qui se déroule en grande partie dans le silence.
Quelques tentes plus loin, Pedro, lui, ose se confier plus longuement. A 40 ans, il a l’âge du Mozambique indépendant. Au temps de la première guerre civile (1976-1992), il avait fui au Malawi. Cette fois, il n’a pas eu le courage de repasser la frontière. « La Renamo provoque l’armée, et la population, au milieu, reçoit les balles. Certains meurent, certains sont amputés », résume t-il, précisant que sept de ses proches sont morts avant qu’il ne fuie pour Vanduzi.
« Mais je ne peux pas mentir, continue t-il. Avant, quand les rebelles de la Renamo étaient là, ils venaient nous acheter des choses, sans jamais faire de bazar. Mais depuis que l’armée est arrivée, lorsqu’ils n’attrapent personne de la Renamo, ils battent la population ». Il insiste : « C’est le gouvernement qui nous a dit de partir ».
Stratégie de déplacement de la population
A mesure que le conflit s’installe, les troupes gouvernementales semblent renouer avec les modes opératoires qui ont fait les heures sombres du premier conflit. A l’époque, les déplacements forcés de populations visaient à soustraire des villages entiers à l’emprise des rebelles. Ainsi, les villages qui entourent la montagne de Gorongosa, où se cache le leader de l’opposition, Afonso Dhlakama, ont été ces derniers mois complètement vidés de leurs habitants.
Le vieux rebelle qui, en décembre 2015, promettait de gouverner six provinces sur onze, a dû se résoudre à passer un deuxième noël loin des siens. Celui-ci a surpris en annonçant, le 27 décembre, une trêve surprise d’une semaine, comme « geste de bonne volonté ».
Sur le terrain, la guérilla semble en effet perdre l’avantage : « Militairement, la Renamo est dans une position très faible. Ils ne contrôlent plus que le haut de la montagne, et tout autour, c’est bourré de militaires, de forces spéciales. Ça sent le sapin pour Dhlakama », confie, sous couvert de l’anonymat, un diplomate occidental de retour d’une visite dans la région.
A Maputo, la capitale, les pourparlers de paix sont dans l’impasse, depuis que le gouvernement a fait capoter fin novembre un projet d’accord sur le dossier épineux de la décentralisation. Mi-décembre, les médiateurs internationaux qui encadrent les négociations depuis six mois ont quitté le pays sur un constat d’échec, sans calendrier de retour et à un moment où l’aile dure du Frelimo semblait déterminée à se débarrasser du leader de l’opposition. « S’ils tuent Dhlakama, ce sera une grosse erreur tactique, estime un autre diplomate qui suit de près les pourparlers. Sur le long terme, ça nuira au Frelimo, déjà responsable de la crise économique et des scandales de corruption ». Sans son chef historique, qui dirige la rébellion d’une main de fer depuis 1979, la Renamo risque, elle, d’éclater en plusieurs groupes armés incontrôlables. Le scénario du pire.