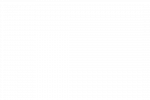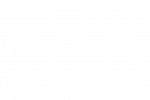Rohingya : la nouvelle épreuve d’Aung San Suu Kyi

Rohingya : la nouvelle épreuve d’Aung San Suu Kyi
Editorial. Le silence de la Prix Nobel de la paix, première ministre de facto de la Birmanie, face à la terrible répression menée par l’armée contre la minorité musulmane dans l’ouest du pays menace d’anéantir son crédit.
Editorial du « Monde ». De l’Afrique du Sud à l’Europe centrale, plus d’un combattant de la démocratie en a fait l’expérience : il est plus facile d’être vertueux dans l’opposition au totalitarisme que dans l’exercice du pouvoir, une fois le dictateur chassé. C’est au tour d’Aung San Suu Kyi, l’icône de la résistance birmane, d’affronter cette épreuve. La terrible répression menée par l’armée de son pays contre la minorité musulmane rohingya a atteint de telles proportions qu’elle menace d’anéantir le crédit de celle que les Birmans appellent encore respectueusement « The Lady ».
Les témoignages recueillis par notre envoyé spécial, qui corroborent les accusations formulées ces derniers mois par les organisations humanitaires, sont accablants. Viols, meurtres, persécutions : rien n’est épargné à cette minorité originaire du Bengale, poussée vers la Birmanie au XIXe siècle par l’Empire britannique. Les relations entre Rohingya et l’ethnie majoritaire en Birmanie, les Bamars, pour la plupart de confession bouddhiste, ont souvent été difficiles. Des dizaines de milliers de Rohingya sont parqués depuis des années dans des camps de réfugiés au Bangladesh voisin et dans des camps de déplacés en Birmanie. En 2012, de graves émeutes entre Rohingya et bouddhistes dans l’Etat d’Arakan, dans l’ouest de la Birmanie, où vit la minorité, ont relancé l’exode. L’attaque d’un poste-frontière birman, le 9 octobre, par des centaines de combattants d’un groupe armé rohingya jusque-là inconnu a fourni le prétexte d’une nouvelle vague d’exactions des forces armées birmanes, dont un épisode a même été filmé par un militaire lui-même et posté sur les réseaux sociaux.
Otage du compromis
Fille du général Aung San, héros de l’indépendance birmane assassiné, Aung San Suu Kyi, aujourd’hui âgée de 71 ans, a forcé l’admiration du monde entier par sa résistance courageuse et stoïque à la dictature militaire, pour laquelle elle a reçu le prix Nobel de la paix. Enfermée pendant quinze ans en résidence surveillée dans sa grande maison décrépie, elle a fini par sortir victorieuse de ce combat, en se faisant élire députée en 2012, en négociant la transition avec ses geôliers, puis en menant son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, à la victoire il y a un an. Empêchée par une disposition introduite dans la Constitution par les militaires de se présenter à la présidence, elle a les titres officiels de ministre des affaires étrangères et de conseillère d’Etat, mais a de facto le pouvoir d’un premier ministre.
L’armée birmane, toutefois, reste très puissante et a conservé de multiples leviers du pouvoir. Otage du compromis, Aung San Suu Kyi est prisonnière d’une autre manière. Souvent critiquée, à l’étranger, sur les violations des droits de l’homme, elle déteste qu’on l’accuse de trahir son image d’icône. « Je ne suis pas une icône, a-t-elle souvent rétorqué, je suis une femme politique qui veut la réconciliation nationale », impliquant que la complexité de la réalité et le pragmatisme la contraignent, parfois, à se salir les mains. Comme son père, elle est confrontée au problème d’un Etat multiethnique dominé par une majorité inflexible. Elle aurait tort de renoncer à ce dernier combat : plus que de son image personnelle, il en va du respect des droits de l’homme les plus fondamentaux, de l’avenir de son pays et des relations de la Birmanie avec les Etats voisins, dont plusieurs abritent d’importantes populations musulmanes.