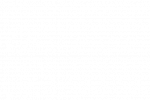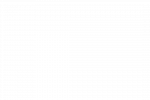Dans la banlieue d’Alger, « on sait que la violence arrange l’Etat »

A Aïn Benian, dans la banlieue d’Alger, « on sait que la violence arrange l’Etat »
Par Zahra Chenaoui (contributrice Le Monde Afrique, Alger)
La commune en banlieue d’Alger a été le théâtre, début janvier, d’échauffourées. Pour les habitants, un symptôme de la rancœur contre le pouvoir.
« Mes neveux m’ont appelée pour me dire de déplacer ma voiture parce que ça allait dégénérer. » Fatiha, la quarantaine, habite dans une rue résidentielle sur les hauteurs d’Aïn Benian. Dans la soirée du 2 au 3 janvier, des habitants de cette commune de la périphérie ouest d’Alger ont dressé une barricade sur la route. « Aucune voiture ne pouvait passer, on voyait la fumée monter dans le ciel. Ça a recommencé le soir suivant. La police et la gendarmerie se sont postées à chaque carrefour de la ville et, depuis, c’est calme », résume cette riveraine aux cheveux bruns. Devant le cimetière, fouetté par les bourrasques de vent venant de la Méditerranée, deux véhicules de gendarmerie sont désormais postés là en permanence.
Ces premiers jours de janvier, Aïn Benian n’a pas été le seul endroit touché par les violences. A 200 km de la capitale, les commerçants de la ville de Béjaïa avaient eux aussi fermé leurs boutiques, ce 2 janvier, en réponse à un appel anonyme à la grève contre les mesures d’austérité contenues dans la loi de finances 2017. Des affrontements ont eu lieu entre des protestataires et les forces de l’ordre. La grève des commerçants ne s’est pas étendue, mais des échauffourées ont eu lieu dans d’autres localités, comme à Tiaret, et dans plusieurs quartiers d’Alger, dont Aïn Benian.
Dans le centre de la ville, près de la mairie, Mourad, 30 ans, cadre dans une entreprise publique, énumère les quartiers touchés : « Baïnem, Bains-Romains, Miramar, La Pointe. C’est là qu’il y a eu de la casse : des poubelles brûlées et des abribus cassés. Ce n’était pas des manifestants, mais des ados perdus. On savait que ça finirait pas arriver. » « Je ne me suis pas inquiétée, explique pour sa part Fatiha. La route est coupée régulièrement ici : à chaque fois que l’Etat annonce des mesures pour le relogement, les bidonvilles ou les logements sociaux, il y a une manifestation. »
« On est fatigués »
Ici, la thèse de l’exaspération liée à l’augmentation des prix, personne n’y croit vraiment. Une source sécuritaire qui demande à rester anonyme affirme que les violences dans la ville étaient le fait de « voyous ». Bien sûr, les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement pour faire face à la chute des prix du pétrole, la principale ressource de l’Algérie, inquiètent, mais le désarroi est bien plus ancien et profond.
Plus haut sur la colline, dans le quartier de la cité Belle-Vue, trois petites camionnettes sont garées face à une barre d’immeuble. Des caisses remplies d’oranges et de pommes de terre se devinent sous les bâches posées à l’arrière des véhicules. Karim tient un petit magasin de tabac, confiseries et cosmétiques. « La vie est chère, on n’a pas de travail, pas de logement. C’est normal que les gens aient manifesté », affirme-t-il. Père d’une petite fille, il a sollicité un emploi dans l’administration, qui lui a été refusé. « J’ai dû menacer un responsable pour obtenir la location de ce local. Ici, soit tu as du piston, soit tu utilises la violence. On est fatigués de ça. »
La rancœur contre « l’Etat » est omniprésente. « A chaque fois qu’il pleut, les coulées de boue inondent le quartier, on ne peut pas circuler. Alors qu’à Ben Aknoun [un quartier résidentiel d’Alger], il ne leur a fallu que deux jours pour réparer l’autoroute. La différence ? Les ministres passent par Ben Aknoun, pas par ici », explique un client de la boutique, amer.
Derrière le magasin de Karim, des gravats sont entassés. Au mois de septembre 2016, les autorités ont détruit des constructions jugées « illicites ». Malgré une opération de relogement, plusieurs familles se sont retrouvées sans abri. Mohamed, un habitant du quartier, donne un coup de main pour décharger les cartons de barres chocolatées : « Casser n’est pas une solution, mais les jeunes sont sous tension. C’est pour ça que ça peut recommencer », prévient-il.
A l’abri de la pluie, sur le pas de la porte, Ahmed, 26 ans, allume une cigarette. « Le problème, dit-il, c’est que personne ne nous écoute. Sans tapage, rien ne change. Mais on sait aussi que la violence arrange l’Etat, car ça fait peur à tout le monde. La seule solution, c’est une grève générale. Plus personne ne part travailler, plus de bus, plus rien. On l’a déjà fait à l’époque de la France, pour notre indépendance. »