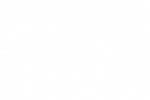En Tunisie, la difficile traque des biens du clan Ben Ali

En Tunisie, la difficile traque des biens du clan Ben Ali
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Six ans après la révolution, seule une petite partie des avoirs spoliés a été restituée.
C’est un passif lourd et amer, un héritage vicié de l’ancien régime de Zine El-Abidine Ben Ali. C’est une blessure psychologique, tout autant qu’une plaie financière, que l’accès à la démocratie n’a toujours pas cicatrisée au flanc de la conscience tunisienne. Alors que la Tunisie s’apprête à célébrer le sixième anniversaire de sa révolution, rendue victorieuse par le départ forcé de l’ex-autocrate Ben Ali le 14 janvier 2011, le dossier des biens mal acquis sous la dictature est loin d’être refermé. Il continue de nourrir des batailles juridiques sur fond de coopération internationale – fort contrastée selon les pays – au fil de procédures laborieuses, sources de frustrations aiguës. « Les bonnes intentions ne manquent pas, soupire Jamal Shaba, magistrat au pôle financier de Tunis. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. » La Tunisie n’a en effet récupéré qu’une infime partie de ses avoirs spoliés vingt-trois années durant par le clan Ben Ali, au sein duquel la parentèle de son épouse, Leïla Trabelsi, avait manifesté une voracité sans limites. Une mise en coupe réglée de l’économie nationale orchestrée autour du pillage des marchés publics auquel nombre d’entreprises étrangères – notamment françaises – ont prêté leur concours actif.
Au lendemain de la révolution, c’est l’un des dossiers les plus brûlants qui atterrit sur le bureau des autorités de transition. Comment réparer cette prédation systématique qui a aspiré dans les poches de l’oligarchie familiale les ressources du pays, privant la population de précieux atouts pour son développement ? Deux processus distincts vont dès lors se juxtaposer, obéissant à des logiques juridiques différentes : la réappropriation des biens du « clan » localisés en Tunisie même ; et les efforts de récupération par l’Etat tunisien de la partie de ces avoirs placés à l’étranger. Autant le premier est assez simple, même s’il demeure inabouti. Autant le second relève d’une complexité parfois kafkaïenne, formant la principale source du malaise.
Deux mois après le départ en exil de Ben Ali, les autorités provisoires à Tunis procèdent par un décret-loi à la confiscation des biens de 114 membres du « clan ». Quatre cents entreprises, 550 propriétés immobilières ou foncières, 48 bateaux et yachts, 40 portefeuilles d’actions, 367 comptes bancaires, etc., sont ainsi saisis par une « commission de confiscation ». A l’époque, une estimation de la valeur globale de ces actifs est avancée : 13 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros), soit un quart du PIB tunisien de 2011, mais les analystes se montrent prudents à l’égard de cette évaluation, qui ne pouvait alors se fonder sur une expertise solide.
En général, l’expertise est sollicitée au moment de la vente d’un bien particulier. Or seulement 2 milliards de dinars tunisiens (soit entre 800 000 et 900 000 euros) ont été récupérés en six ans, selon Riadh Boujeh, un ancien président de la commission de confiscation. Si l’on en défalque les dettes dues à l’Etat comme à des entités privées, le produit net de ces ventes est en fait de 1 milliard de dinars (entre 400 000 et 450 000 euros). Le reste de ce patrimoine confisqué attend de trouver preneurs. Et, plus le temps passe, plus le risque de dépréciation des actifs s’élève.
« Beaucoup de faillites »
L’Etat a nommé des administrateurs pour en assurer la gestion provisoire dans des conditions souvent controversées. « On ne s’est vraiment intéressés à la valorisation de ces biens qu’à partir de 2014 », regrette Mabrouk Kourchid, le ministre des domaines de l’Etat. « Il y a beaucoup de faillites, l’Etat n’a pas de stratégie de développement de ces sociétés confisquées », dénonce Anis Boughattas, l’avocat d’Imed Trabelsi, neveu de Leïla Trabelsi emprisonné à Tunis, un des rares membres du clan à ne pas être en fuite.
A l’étranger, l’affaire est d’une tout autre nature. Tunis doit solliciter une entraide judiciaire internationale marquée par une inégale collaboration des Etats. Si les pays du golfe Arabo-Persique ignorent en général les demandes de la Tunisie, l’Union européenne (UE), la Suisse et le Canada font preuve d’une meilleure volonté. Dès le lendemain de la révolution, le Conseil européen et la Suisse avaient gelé les avoirs de 48 membres du clan Ben Ali. Là encore, aucun chiffre global n’est disponible. On sait que la Suisse en a saisi pour 46,5 millions d’euros – principalement des comptes bancaires – et la France pour « plusieurs dizaines de millions d’euros », selon une source judiciaire, correspondant pour l’essentiel à des biens immeubles. Mais, entre ces gels d’avoirs à l’étranger et leur rapatriement en Tunisie, le parcours est semé d’embûches. Les fonds récupérés à ce jour par la Tunisie sont fort modestes : 28 millions de dollars (26 millions d’euros) en provenance du Liban, 206 000 euros restitués par la Suisse ainsi que deux yachts (valeur cumulée d’environ 8,5 millions d’euros) par l’Espagne et l’Italie. « Il existe en Tunisie d’énormes attentes, mais le puzzle à reconstituer est très compliqué. Il s’agit d’un travail de longue haleine », explique Rita Adam, ambassadrice suisse à Tunis.
« Une question de dignité »
La grande difficulté à laquelle se heurte la Tunisie est que les Etats étrangers n’acceptent de restituer ces biens que sur la base de jugements définitifs de confiscation prononcés en Tunisie même. Or les tribunaux tunisiens n’en ont jusqu’à présent rendu aucun, dans l’attente d’informations requises dans la centaine de commissions rogatoires internationales adressées à une cinquantaine de pays. Si l’impasse dure trop longtemps, « il y aura un moment où les biens gelés feront l’objet d’une demande de mainlevée », s’inquiète une source judiciaire. Les effets politiques en seraient désastreux. La balle est-elle dans le camp de la Tunisie ? Ou plutôt à l’étranger ? La déception sourd ici et là. La détermination de la Tunisie n’en reste pas moins farouche. « Cet argent, c’est pour nous une question de dignité, déclare Brahim Oueslati, avocat général aux affaires pénales du ministère de la justice. Il ne faut pas que le crime reste impuni. »