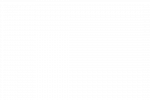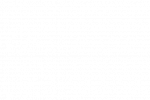Le Conseil d’Etat face au casse-tête du « droit à l’oubli »

Le Conseil d’Etat face au casse-tête du « droit à l’oubli »
Par Martin Untersinger
La rapporteure publique a proposé de demander à la justice européenne le « mode d’emploi » du droit au déréférencement.
Depuis le 13 mai 2014 et une décision retentissante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), juristes et experts du numérique s’arrachent les cheveux au sujet du droit au déréférencement. C’est au tour du Conseil d’Etat de se prononcer sur ce sujet complexe : saisi par quatre internautes ayant échoué à se voir appliquer ce droit, il a entendu, jeudi 2 février, les conclusions de la rapporteure générale.
Le principe de ce nouveau droit, parfois abusivement qualifié de « droit à l’oubli », semble pourtant simple : en vertu des lois européennes sur les données personnelles, tout internaute peut demander à un moteur de recherche que cessent d’apparaître, lorsque sont saisis son nom et prénom, certaines pages dans les résultats ; et ce lorsque ces dernières contiennent des informations « inexactes, incomplètes, inadéquates, non pertinentes ou excessives ».
Grande créativité
De l’avis des juristes, la CJUE a fait preuve d’une grande créativité pour appliquer le droit européen, forgé à une époque où balbutiaient à peine les moteurs de recherche. Ce « tour de force », selon les mots de la rapporteure Aurélie Bretonneau, a en tout cas été très favorablement accueilli par les internautes européens. Plus de 680 000 demandes de déréférencement ont été adressées aux moteurs de recherche, dont près de 390 000 demandes en France.
Cette décision de la cour de Luxembourg touche en effet à une situation à laquelle sont confrontés des millions d’internautes dans leur vie quotidienne, issue du rôle des moteurs de recherche comme porte d’entrée principale à l’information, publique comme privée. Ainsi que l’a rappelé Mme Bretonneau dans ses conclusions, « l’hypermnésie collective a changé d’échelle (…) : la puissance des moteurs de recherche a interdit que dans cet océan de données en ligne les informations se dispersent ou se fassent oublier [permettant] qu’à l’identité d’une personne restent attachées, de façon perpétuellement visible par tous, les traces indélébiles de l’ensemble des comportements ou caractéristiques qui, à tort ou à raison, lui ont été un jour prêtés ».
Dans son arrêt, la CJUE a esquissé des critères censés guider la décision des moteurs de recherche de faire droit, ou non, aux demandes de déréférencement. Insuffisant, selon de nombreux experts, qui se verront confortés dans cette analyse par la rapporteure publique, qui a demandé à ce que soit transmise à la Cour européenne une question préjudicielle, afin d’éclaircir, selon ses termes, « la face cachée de l’arrêt [de la CJUE] ».
Quatre cas
La plus haute juridiction administrative française – et première juridiction suprême européenne à se prononcer sur le droit au déréférencement – a été saisie par quatre internautes.
Le premier, ancien candidat à une élection cantonale, souhaite voir retirer le lien vers un photomontage calomnieux ; le deuxième, ancien responsable de l’église française de scientologie, que soit déréférencé un article de Libération évoquant une note des renseignements le concernant ; le troisième, que disparaissent des moteurs de recherche des mentions de sa mise en examen – soldée par un non-lieu – lorsqu’il œuvrait dans un cabinet ministériel ; et le dernier, condamné pour des faits de pédophilie, que disparaissent les liens vers des articles mentionnant, outre sa condamnation, plusieurs détails physiques intimes.
La plupart de ces informations revêtent un intérêt public. C’est ce qu’a estimé le moteur de recherche, puis la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), en refusant de déréférencer les liens correspondants.
Mais ces informations (relatives notamment à la vie sexuelle, aux opinions politiques, aux infractions ou à l’origine ethnique) ne peuvent, et sauf exceptions précises, faire l’objet d’une collecte et d’une exploitation, en vertu des textes européens.
Faut-il en conclure que les moteurs de recherche, comme Google, doivent cesser de proposer à leurs utilisateurs des liens pointant vers des pages contenant ces informations, pourtant présentes en très grand nombre sur Internet ? Et si oui, dans quelles modalités ? C’est, en substance, la question qu’a suggérée la rapporteure, estimant que la CJUE devait « éditer le mode d’emploi qui ne figure pas dans [son] arrêt ».