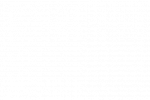La CDFT risque et gagne

La CDFT risque et gagne
Editorial. Pour la première fois, la CFDT devient le premier syndicat de France, devant la CGT. La récompense de la stratégie réformiste que mène la centrale
Editorial du « Monde ». A trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, les candidats devraient regarder avec attention la nouvelle mesure de la représentativité syndicale, présentée vendredi 31 mars par le Haut Conseil du dialogue social. Ils découvriront que le syndicalisme, qu’ils prennent souvent pour quantité négligeable, est une force dotée d’une vraie légitimité.
La représentativité des syndicats dans le secteur privé est indexée, depuis la réforme de 2008, sur leur audience électorale. Entre 2013 et 2017, sur un collège électoral de plus de 13 millions de salariés, la participation n’a été que de 42,76 % en raison d’une abstention vertigineuse dans les très petites entreprises (92,75 %). Mais, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, 62,63 % des électeurs ont voté. Un score supérieur à celui de bien des scrutins politiques.
L’autre leçon est historique : pour la première fois, la CFDT a ravi, avec 26,37 % des voix, la première place sur l’échiquier syndical à la CGT (24,85 %), soit un écart de 1,52 point entre les deux rivales. Victoire posthume pour François Chérèque, secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012, mort le 2 janvier, cette montée en haut du podium de la centrale aujourd’hui menée par Laurent Berger est la récompense des efforts menés depuis plus d’une décennie pour développer son implantation dans le secteur privé.
« La CGT ne peut se satisfaire de ce résultat »
Mais c’est aussi le couronnement d’une stratégie résolument réformiste. Durant le quinquennat de François Hollande, la CFDT a pris des risques en soutenant la quasi-totalité des réformes – depuis l’accord de 2013 sur la flexisécurité de l’emploi jusqu’à la loi El Khomri en passant par le pacte de responsabilité –, alors que le président et le gouvernement s’enfonçaient dans l’impopularité. Elle s’est engagée et elle a gagné.
Les autres syndicats réformistes ont consolidé leur position, comme la CFTC (9,49 %), ou progressé, comme l’UNSA (5,35 %). C’est la CFE-CGC, désormais non alignée entre les réformistes et les contestataires, qui réalise, avec 10,67 %, le plus fort gain (+ 1,24 point). A contrario, ce résultat est un échec cuisant pour la CGT, qui, avec 24,85 %, recule de 1,92 point par rapport à 2013. Il sera difficile pour Philippe Martinez, son secrétaire général, d’y voir la validation d’une ligne contestataire qui est allée en s’accentuant durant le quinquennat.
« La CGT ne peut se satisfaire de ce résultat », note pudiquement la centrale dans un communiqué, en mettant ce revers sur le compte d’un « déficit de présence » auprès du salariat. En agrégeant la fonction publique et le secteur privé, elle revendique toujours la première place, nonobstant le fait qu’elle compte 686 093 adhérents quand la CFDT affiche un chiffre de 860 243. Pour le plus vieux syndicat français, né en 1895, le séisme va être de grande ampleur.
Le prochain président de la République ne pourra pas agir en ignorant le syndicalisme, sauf à renvoyer la démocratie sociale dans les oubliettes de l’histoire. Mais la frontière entre les deux syndicalismes reste fragile. Le camp des réformistes (CFDT, CFTC, UNSA) représente 41,21 % et celui des syndicats plus contestataires (CGT et FO) 40,44 %. A l’heure où la règle de l’accord majoritaire, supposant qu’il soit ratifié par des syndicats ayant obtenu plus de 50 % des suffrages, a vocation à s’étendre dans les entreprises, le chemin des réformes du marché du travail ne ressemblera pas à un long fleuve tranquille. La recomposition syndicale a franchi une nouvelle étape mais elle est bien loin d’être achevée.