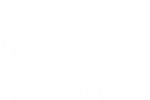Au Maroc, les islamistes perdent du terrain

Au Maroc, les islamistes perdent du terrain
Par Charlotte Bozonnet
Le nouveau gouvernement désigné mercredi par le roi confirme la marginalisation du PJD.
Le nouveau gouvernement, autour du roi Mohammed VI, le 5 avril à Rabat. | PALAIS ROYAL MAROCAIN / AFP
Cinq mois de blocage, un chef de file islamiste mis sur la touche et un nouveau gouvernement de trente-neuf membres dans lequel les équilibres politiques ont été un peu revus. Tel est le bilan de la crise politique qui s’est prolongée ces derniers mois au Maroc et s’est achevée, mercredi 5 avril, par l’annonce de la désignation par le roi de la nouvelle équipe gouvernementale.
Si cette composition ne change pas radicalement de l’exécutif précédent, elle confirme une tendance qui se dessinait depuis plusieurs mois : la perte de terrain du Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste), parti vainqueur des législatives de 2011 et 2016, et à l’inverse, la montée en puissance du Rassemblement national des indépendants (RNI, libéraux) dirigé par Aziz Akhannouch, homme d’affaires proche du palais, reconduit au poste de ministre de l’agriculture et de la pêche maritime.
On le savait depuis la semaine dernière : la nouvelle majorité comprend six partis. Outre le PJD, arrivé en tête des élections législatives du 7 octobre 2016, et son allié du Parti du progrès et du socialisme (PPS, communiste), elle réunit le RNI, le Mouvement populaire (MP), l’Union constitutionnelle (UC) et l’Union socialiste des forces populaires (USFP).
On sait désormais comment se répartissent les portefeuilles parmi les 39 ministres et secrétaires d’Etat nommés. Le PJD a notamment obtenu les portefeuilles du transport, de l’énergie et des mines, de l’emploi et de la famille. Le RNI, lui, se voit chargé des ministères liés à la sphère économique : économie et finances, industrie et commerce, agriculture et pêche. Quant aux ministères dits « de souveraineté », tels que les affaires religieuses, l’intérieur, la défense ou les affaires islamiques – domaines sur lesquels le palais garde la haute main –, ils restent dirigés par des technocrates ou des indépendants.
« Ligne rouge »
Depuis les élections législatives du 7 octobre, le chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, populaire et remuant dirigeant du PJD, ne parvenait pas à former une coalition suffisamment large pour lui permettre d’atteindre la majorité au Parlement (198 sièges sur 395). Le RNI avait réussi à constituer autour de lui un pôle de partis alliés et à tenir tête à M. Benkirane dans les négociations. Le chef de gouvernement a fini par être remercié par Mohammed VI, le 15 mars, qui a nommé à sa place le numéro deux du PJD, Saad-Eddine Al-Othmani.
Le nouveau premier ministre, plus consensuel que son prédécesseur, est très vite parvenu à former une coalition. Alors que le PJD venait de redire son intention de rester sur les mêmes bases de négociation que M. Benkirane, M. Al-Othmani a accepté d’intégrer l’USFP dans la future coalition – une « ligne rouge » pour son prédécesseur. Cette décision, annoncée le 25 mars, a sonné comme une concession majeure faite par le PJD. Le parti perd, avec le départ d’Abdelilah Benkirane, celui qui fut un atout-clé dans sa popularité et ses victoires électorales, mais aussi, dans la nouvelle équipe gouvernementale, l’important portefeuille de la justice.
Le RNI, qui a émergé en quelques mois comme la principale force d’opposition aux islamistes du PJD, sort renforcé. Non seulement M. Akhannouch s’était imposé comme l’interlocuteur-clé des négociations pour le futur gouvernement, mais il détient désormais les portefeuilles stratégiques de l’économie et de la justice alors qu’il n’est arrivé que quatrième du scrutin (37 sièges sur 395 contre 125 pour le PJD).
Comment les électeurs marocains peuvent-ils appréhender cette situation ? Il est vrai que l’absence de gouvernement ne s’est pas fait ressentir sur la vie quotidienne. Il est vrai aussi que la politique partisane est éloignée de la majorité de la population, mais le PJD, arrivé au pouvoir en 2011, avait réussi à mobiliser une partie de l’électorat. Les apparences sont sauves : sur le papier, la Constitution de 2011, selon laquelle le roi nomme le chef de gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections, est respectée. Mais cet épisode de rééquilibrage politique aura laissé à certains un goût un peu amer.
Un éditorial de l’hebdomadaire libéral TelQuel, intitulé « Le “ninisme” chérifien », soulignait, le 1er avril : « Ce que nous vivons aujourd’hui est une situation intermédiaire, non assumée : pas d’autocratie affichée, mais pas de démocratie réelle non plus. » « Un entre-deux que certains justifient par la nécessité de maintenir des équilibres fragiles, mais qui nous condamne au statu quo », poursuivait le journal.