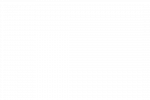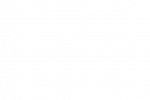Visite de Rex Tillerson à Moscou : un rapprochement compliqué

Visite de Rex Tillerson à Moscou : un rapprochement compliqué
Par Isabelle Mandraud (Moscou, correspondante), Gilles Paris (Washington, correspondant)
Le secrétaire d’Etat américain devrait rencontrer mercredi son homologue russe, Sergueï Lavrov, mais peut-être aussi Vladimir Poutine. Une série de dossiers opposent les deux pays.
Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président américain, Donald Trump, a certes réitéré à plusieurs reprises son espoir de « s’entendre avec la Russie », témoignant d’un désir d’engagement déjà exprimé par ses prédécesseurs, mais les compliments adressés à Vladimir Poutine ont disparu. Tout comme la vague d’enthousiasme pour le candidat républicain lors de la campagne présidentielle américaine a reflué en Russie.
Pour la première fois, mercredi 12 avril, Rex Tillerson devrait poser le pied à Moscou dans ses habits de secrétaire d’Etat. Il doit y rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov, et pourrait aussi s’entretenir avec Vladimir Poutine.
L’homme d’affaires qu’il était, à la tête du géant pétrolier Exxon Mobile, décoré par M. Poutine, connaissait le terrain ; le diplomate s’avance en terre inconnue. Dimanche, il s’était interrogé sur les réelles intentions en Syrie de la Russie, qui, selon lui, s’est montrée « incompétente » pour surveiller l’élimination de l’arsenal chimique du président Bachar Al-Assad.
Mise en route laborieuse des relations bilatérales
Vladimir Poutine et Donald Trump ne se sont encore jamais rencontrés. La première entrevue entre les deux hommes ne devrait pas intervenir avant le sommet du G20, à Hambourg, en Allemagne, en juillet. Et, jusqu’ici, le chef du Kremlin ne s’est pas exprimé autrement que par l’entremise de son porte-parole à propos des frappes américaines lancées le 6 avril contre une base syrienne. M. Poutine n’a fait aucune déclaration filmée à ce sujet, préférant laisser filtrer sa colère à travers ses relais. Le quotidien progouvernemental Rossiskaïa Gazeta a ainsi dressé la liste de sept « signaux d’alarme » : « Les paroles de Trump ne valent rien », « Trump réjouit les faucons, mais trahit ses électeurs » ou bien encore « Trump agit (…) sans stratégie ».
Les interférences prêtées à la Russie au cours de l’élection présidentielle peuvent sans doute expliquer en partie cette mise en route laborieuse des relations bilatérales. L’enquête qui leur a été consacrée a abouti indirectement, le 13 février, par la démission inopinée de celui qui aurait pu jouer un rôle majeur dans ce rapprochement, Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, très proche de Moscou.
Son successeur, le général H.R. McMaster, campe sur une ligne américaine plus traditionnelle, qui considère le Kremlin comme un adversaire, en dépit de convergences ponctuelles. Il a fait venir au Conseil de sécurité nationale pour s’occuper de la Russie et l’Europe une experte du régime de Vladimir Poutine, Fiona Hill, qui lui a consacré une biographie sans concessions (Mr. Putin : Operative in the Kremlin, Brookings, non traduit) écrite avec Clifford G. Gaddy.
Des objectifs différents en Syrie
Toute une série de dossiers, surtout, complique un éventuel rapprochement américano-russe, à commencer par la Syrie. Jusqu’à présent, les forces américaines et russes ont opéré dans ce pays en parallèle, avec des objectifs fondamentalement différents : frapper l’organisation Etat islamique pour Washington, conforter le régime syrien pour Moscou. Depuis les tirs de missile américain en réaction à l’attaque chimique imputée au régime de Bachar Al-Assad contre la petite ville rebelle de Khan Cheikhoun, la donne a changé.
« Si vous regardez ses actions [du régime syrien], si vous voyez la situation, ce sera difficile de voir un gouvernement stable et pacifique avec Assad », a déclaré sur CNN, le 9 avril, Nikki Haley, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU. « Nous pensons qu’un changement de régime est quelque chose qui va arriver », ajoutait-elle. Réplique immédiate du Kremlin : « Le retour aux pseudo-tentatives de résoudre la situation avec des mantras du genre “Assad doit partir” ne peut pas amener à un règlement politique en Syrie », a fustigé son porte-parole, Dmitri Peskov.
Dissensions sur l’Ukraine…
La première intervention de Mme Haley au Conseil de sécurité, le 2 février, avait été l’occasion d’une charge sans ambiguïté contre Moscou dans un tout autre dossier, celui de l’Ukraine. Souhaiter « de meilleures relations avec la Russie », avait-elle alors expliqué, ne dispense pas d’une « condamnation claire et forte des actions russes » dans l’est du pays, de nouveau en proie à des tensions.
La réaffirmation de cette position a renvoyé à plus tard une éventuelle levée des sanctions américaines décrétées après l’annexion de la Crimée par la Russie. Le 15 février, dans l’un de ses messages du matin publiés sur son compte Twitter, M. Trump avait tenu à rappeler que cette annexion s’était produite sous l’administration précédente, avant de s’interroger : « Est-ce qu’Obama était trop doux [« soft »] avec la Russie ? »
… et sur l’Iran
Troisième dossier susceptible de contrarier une coopération entre Washington et Moscou : l’Iran. La nouvelle administration américaine a renoncé pour l’instant à la promesse de campagne de remettre en cause l’accord conclu avec Téhéran, mais aussi avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité et l’Allemagne, sur son programme nucléaire controversé. Washington, qui espérait initialement que Moscou prenne ses distances en Syrie avec Téhéran, un autre allié historique du régime, ne semble plus avoir l’espoir d’y parvenir.
Lors d’un échange par téléphone le 9 avril, les présidents russe et iranien ont condamné sur le même ton « l’agression inacceptable » américaine contre la Syrie et souligné « l’importance de poursuivre une coopération étroite » sur le terrain, où les deux pays, alliés de Damas, interviennent militairement.
Un quatrième dossier fournissait jusqu’à présent un terrain éventuellement propice à un rapprochement : le sort de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, raillée pendant la campagne électorale par M. Trump, au grand plaisir de Moscou. Mais le président américain s’est engagé à « soutenir fermement » l’alliance devant les deux chambres du Congrès, le 28 février. Au grand dépit de Moscou.