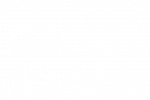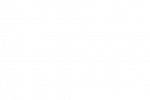La loi scélérate et la pipe d’André Breton – Me François Sureau récidive

La loi scélérate et la pipe d’André Breton - Me François Sureau récidive
Par Franck Johannès
Le Conseil constitutionnel a, le 7 avril, encadré et censuré en partie le délit d’entreprise individuelle terroriste. Me François Sureau, pour la Ligue des droits de l’homme a une nouvelle fois marqué les esprits et aussi quelques points. Le dossier complet
François Sureau, poète, écrivain, conseiller d’Etat, avocat au Conseil et fumeur de pipe a récidivé. Après avoir déchiré à belles dents le délit de consultation des sites terroristes devant le Conseil constitutionnel le 31 janvier, il a plaidé le 28 mars pour la Ligue des droits de l’homme contre la nouvelle infraction d’entreprise individuelle terroriste. Avec une sorte de rage froide, nourrie d’une culture savante et d’un humour d’acier.
C’est un homme de l’écrit, il se lit autant qu’il s’écoute. On trouvera ici cette tranchante leçon d’histoire. Deux mots du contexte : le Conseil constitutionnel avait été saisi le 30 janvier d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par Amadou S. « C’est une personne qui a été expulsée de son logement et, dans ses meubles, trois bouteilles d’eau scotchées ensemble et des mots griffonnés qui peuvent faire penser à des explosifs ont été trouvés, a indiqué son avocat, Me Michaël Bendavid. Cela a déclenché une enquête. »
Les policiers avaient jugé suspectes quelques recherches sur internet, notamment, sur l’Assemblée nationale, et il avait été placé en détention provisoire. « Ce qui est inquiétant, c’est que le texte sur l’entreprise individuelle terroriste a permis de l’incarcérer pendant sept mois, alors qu’il n’y avait aucun projet d’attentat et qu’on a expliqué qu’il souffre de troubles psychiatriques. »
La haute juridiction a dû ainsi se pencher sur deux articles de la loi antiterroriste du 13 novembre 2014, qui a inventé, après l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un nouveau délit d’entreprise individuelle terroriste assez flou ; une association d’un seul membre, en somme. Est en cause le complexe article 421-2-6 du code pénal, et incidemment le 4e alinéa de l’article 421-5 qui en découle.
L’intention ne fait pas le larron
Grossièrement résumé, le suspect, selon la loi, doit d’une part préparer un acte terroriste, dont la longue liste est énumérée dans l’alinéa 8 de la décision du Conseil. Et cette préparation doit d’autre part être caractérisée par deux faits matériels (alinéa 9), ceux-là infiniment vastes : il faut « détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » et, entre mille autres louches activités, s’entraîner « à la conduite d’un navire » : les marins-pêcheurs qui étripent le poisson peuvent trembler, ils remplissent deux des « faits matériels ».
Le Conseil a heureusement le 7 avril encadré cette suspicion de terrorisme, et formulé une sérieuse réserve d’interprétation : les seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires ne peuvent suffire à caractériser l’intention terroriste, ce serait « méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines » (alinéa 16), ils doivent seulement « corroborer » l’intention terroriste. La juridiction censure par ailleurs le mot « rechercher » des objets, la recherche ne suffit guère à prouver l’intention terroriste (alinéa 17 et 18).
La décision du Conseil, loin d’être acquise, est finalement assez courageuse dans un climat inflammable, surtout après la précédente censure du délit de consultation de sites terroristes. Il aurait été sans doute plus satisfaisant de supprimer simplement l’infraction - l’arsenal juridique est déjà très complet, mais au moins le gros des dérives parlementaires vers une justice totalement préventive est un peu limés.
Pour la bonne bouche, on trouvera ici la brillante plaidoirie de François Sureau. Mais aussi :
- L’audience intégrale du Conseil constitutionnel du 27 mars 2017 (49 mn)
- La décision et la censure partielle du Conseil le 7 avril
- Le commentaire de sa propre décision par le Conseil constitutionnel (à venir)
- Le compte-rendu du Monde, par Julia Pascual
- La pipe du « trotskiste » André Breton, dans la seconde vidéo
- Le portrait et l’étonnante amitié de Me Sureau pour François Fillon, dans le Point du 7 avril, par Laureline Dupont
François Sureau
Durée : 17:39
(On nous pardonnera les quelques notes incidentes dans la plaidoirie de Me Sureau ; personne évidemment n’ignore rien du marquis de Chasseloup-Laubat (Prosper, pas François), de Bouchardon, de l’avocat général Servan, du substitut Pinard, du capitaine Hurluret ou de nos amis parlementaires de la IIIe République Floquet, Dubos et Dupuy ; il ne s’agit que d’éclairer tardivement la lanterne un peu sourde des membres du Conseil constitutionnel, qu’une presse moutonnière surnomme les Sages de la rue Montpensier, sans doute parce qu’ils font moins de bruit que les enfants du Palais royal.)
La plaidoirie
« Ces lois d’exception sont des armes terriblement dangereuses. On les bâcle sous prétexte d’atteindre une catégorie d’hommes spécialement en butte à la haine ou la terreur du public (…) Puis on glisse sur une pente presque irrésistible. Il est si commode, d’interprétation en assimilation, par d’insensibles degrés, d’étendre les termes d’une définition élastique à tout ce qui déplaît, à tout ce qui, à un moment donné, pourrait effrayer le public. Or qui peut s’assurer d’échapper à cet accident ? »
Ces mots ont été écrits par Francis de Pressensé, ce diplomate converti au dreyfusisme qui fut le fondateur de la Ligue des droits de l’homme, après le vote des trois lois de 1893 destinées à réprimer les menées anarchistes et qui sont passées à la postérité sous le nom de lois scélérates. Par vanité, ou par amnésie, notre époque ne se fie guère aux précédents. Notre législateur aurait pourtant dû s’y reporter. Il aurait trouvé les mêmes textes, qu’on croirait écrits par les mêmes bureaux, demandés par la même opinion, les mêmes juges et la même police.
Une loi de circonstance pure et parfaite
Encore la loi la plus dure, celle du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs, qui est si je puis dire la mère de celle dont vous êtes saisis, va-t-elle nettement moins loin. Elle aussi veut traiter le cas du loup solitaire anarchiste. Mais elle exige davantage de preuves tangibles d’adhésion effective que n’en requiert le texte actuel. Si bien que vous avez à statuer sur une loi de circonstance pure et parfaite, qui renvoie dans l’archéologie de la répression ces lois de 1893 qui avaient si fort indigné Léon Blum, qui écrivait alors sous pseudonyme, ces mots qu’il est étrange de relire aujourd’hui : « Tout le monde avoue que de telles lois n’auraient jamais dû être nos lois, les lois d’une nation républicaine, d’une nation civilisée, d’une nation probe ».
Vous avez à statuer sur une loi qui, bien loin de se fonder sur aucun principe, les répudie tous ensemble parce qu’elle veut simplement tracer ce pointillé autour du mal terroriste selon lequel la police et la justice pourront ensuite découper la poursuite. Et qu’importe si, après cette opération, il reste au centre du tableau un vide constitutionnel où le pire pourra s’engouffrer, les grands principes ayant disparu dans l’exercice.
Les nouveaux articles 421-2-6 et 421-5, et surtout le 421-2-6, sont tout entiers inspirés par la même démarche casuistique que celle de 1893, une démarche qui consiste à réprimer les auteurs d’actes terroristes, et l’on sait parfaitement lesquels, mais sans les décrire et sans les nommer ; et à paraître organiser ce dispositif sans manquer à nos idéaux. A la fin le législateur, par un système dont la cautèle saute aux yeux, a permis un contrôle social si vague qu’il est pratiquement totalitaire.
Une soumission aux modes de pensée des adversaires
« La loi, écrivait Léon Blum à l’époque, avec sa cruauté intacte, a conservé son caractère d’hypocrisie équivoque qu’y a volontairement introduit le gouvernement. » Il suffit de lire ces articles, et d’abord le 421-2-6, pour voir qu’il est, comme on dit dans les films « inspiré de faits réels ». Le législateur n’a posé aucun principe. Il a pris, ou plutôt l’administration lui a fourni, des cas pratiques d’attentats et le portrait de leurs auteurs. Et sur ce canevas il a brodé ce dispositif. Avant de le décrire pour ce qu’il est, je voudrais tout de même faire remarquer combien il est paradoxal que ce genre de texte passe pour permettre une victoire contre le terrorisme islamiste, alors qu’il en est tout le contraire : une abdication, une soumission totale, plus saisissante encore par son excès même, aux modes de pensée des adversaires de nos mœurs. Il aura donc suffi de quelques attentats pour qu’un parlement français répudie notre tradition et, plutôt que de pousser l’administration à plus d’efficacité, abdique les libertés du citoyen.
La rédaction même dégagerait un fort effet de comique burlesque si les conséquences n’étaient pas si graves. On fait semblant, à l’aide du vocabulaire technique habituel, d’établir des règles alors qu’on passe un calque sur le réel. Le champ répressif est ouvert, mon confrère l’a rappelé, par « le fait de préparer la commission de l’infraction », jointe à la vague « intention » de passer à l’acte. Rien de plus grave ni de plus incertain. Après quoi, il suffit d’énumérer des faits matériels. Détenir un couteau, une fourchette, pratiquer le karaté, et, naturellement, surfer sur internet, si vous n’aviez pas voici quelques semaines mis un coup d’arrêt à ces errements.
Et qui sera réputé « se préparer » et « avoir l’intention » ? On le sait bien et l’examen des 6 000 perquisitions administratives réalisées sous l’empire de l’état d’urgence le montre. Je ne pense pas que vous puissiez détourner le regard de ces faits gênants. Il y a fort à parier que le marquis de Chasseloup-Laubat, s’entraînant à l’escrime dans l’espoir de perfectionner son fameux traité, [oui, la référence est étrange] ne sera pas réputé a priori coupable de vouloir dynamiter Notre-Dame.
Mais il est sûr que Mouloud, s’il coupe sa viande avec autre chose qu’une cuillère en bois, est inscrit à une salle de boxe, et surfe malencontreusement sur internet, aura toutes les peines du monde à se défaire du filet jeté sur lui. Il lui faudra, on le sait bien, apporter la preuve inverse devant la police et les juges, s’humilier, protester qu’il est un Français comme un autre. Je ne pense pas que les concepteurs de ce texte l’aient ignoré, et c’est la raison pour laquelle sa lecture fait naître, je n’hésite pas à le dire, un vif sentiment de honte.
Assignés désormais à la Blédine
Mais au-delà, il fait naître aussi un vif sentiment de stupeur chez tous les Français sans distinction d’origine, qui se verront bientôt, par crainte de la police et du juge, assignés désormais à la Blédine plutôt qu’à la viande, à la cuillère de bois plutôt qu’à l’Opinel, à la pétanque plutôt qu’à la savate. C’est cela, en vérité, qui se cache derrière nos discussions techniques sur le vague des faits déclencheurs, l’imprécision des critères, l’impossibilité des contrôles effectifs. C’est toute une société qui bascule sous la coupe des corps d’Etat qui avaient pour but de lui procurer la sûreté et qui désormais, loin de la servir, se la subordonnent pour mener un combat chimérique.
Ce combat n’est pas chimérique à cause de ses buts, qui sont éminemment respectables. Il l’est à cause des moyens qui s’y trouvent employés. Au-delà même du texte, il me semble relever de votre office de rappeler au législateur que sa mission n’est pas de se faire la chambre d’enregistrement des instruments publics d’une répression nécessaire, mais qui ici se trompe entièrement d’objet.
Et qu’on n’aille pas dire que l’honneur est sauf puisque toute cette activité répressive se trouve placée sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés. Gardien des libertés, le juge judiciaire ne l’est que pour autant que les droits constitutionnels lui sont rappelés de temps à autre, et par vous en premier lieu. C’est notre grand avantage sur nos devanciers de 1893 que de pouvoir plaider devant vous. Le juge même le mieux intentionné ne peut garder aucune liberté qui soit à partir de l’« intention sans preuves » ou de la « préparation à la commission des actes terroristes ». Si vous manquez à le lui rappeler, il sera tout autant gardien des libertés qu’en son temps Anatole Deibler, au pied de sa funeste machine, aurait pu être qualifié de gardien de la vie. De cela, aucun de nos prédécesseurs, et même les plus répressifs, n’a été ignorant.
Ni Bouchardon, le magistrat instructeur des procès de la Grande guerre et accusateur de Laval, déplorant dans ses Mémoires l’insuffisance des garanties dans les procès criminels. Ni l’avocat général Servan, qui ne passerait pas de nos jours pour un humaniste et qui, cité par Hugo vers 1830 sur une question absolument analogue, disait : « nos lois pénales ouvrent toutes les issues à l’accusation et les ferment presque toutes à l’accusé ». Nous apprenons Voltaire à l’école, et les juges moitié singes et moitié tigres dont il parle à propos de l’affaire Calas, et nous voilà, finissant par leur remettre aveuglément, dans le demi-silence de lois analogues à celle dont vous êtes saisis aujourd’hui, toutes nos libertés ! Cela n’est ni possible, ni cohérent, ni raisonnable.
En dehors des lois scélérates, le texte qui vous est soumis ne comporte qu’un autre précédent, bien plus ancien, la célèbre loi des suspects du 17 novembre 1793 [en fait le décret du 17 septembre 1793]. Je prends à tâche aujourd’hui de la réhabiliter devant vous, après avoir lu les horreurs de l’article qui vous est déféré. Elle, du moins, avait le courage de la précision. Les ennemis de la République y étaient nommés. Et certes, on imposait aux suspects, parents d’émigrés par exemple, d’apporter la preuve de leur attachement à la République, ce qui est fâcheux, mais du moins des critères étaient-ils prévus, et pouvaient-ils s’exonérer par la production d’un certificat de civisme. Il n’y a rien de tel aujourd’hui, où des magistrats et des policiers généralement aimables pourtant, défilent devant les commissions parlementaires pour les prier de les soutenir dans ce qu’ils nomment « leur combat », et réclament pour l’essentiel, avec la voix d’Hébert et de son père Duchesne, que des possibilités illimitées leur soient offertes. Le discours du temps tient tout entier dans cette formule que critiquait Hugo, selon laquelle « une société ébranlée a besoin de ces accommodements pour se maintenir ».
Mais c’est une illusion dangereuse, parce que ce que montre la mécanique du texte c’est que les accommodements ne maintiennent rien et, davantage, achèvent, mais sur une large échelle, l’œuvre de destruction commencée par les terroristes et qui n’aurait aucune chance de succès si, par un paradoxe accablant, nous n’étions pas venus à leur prêter nous-mêmes pas la main.
Ce n’est pas à dire qu’il suffise d’une exception pour nous détruire dans notre être politique, et là-dessus, dans la fameuse controverse, c’est certainement Maritain qui a raison et non pas Mauriac. Mais la disposition qui vous est déférée aujourd’hui va très au-delà de l’exception. Elle ne suspend pas ces principes fondateurs que sont la liberté d’opinion ou le principe de légalité des délits et des peines. Elle les fait tout simplement disparaître.
Il ne peut pas y avoir de retour en arrière
On habillera ces constructions de tous les euphémismes techniques, de tout le jargon professionnel qu’on voudra, elles n’en restent pas moins, sous ce rapport, profondément nihilistes. Et on ne sait trop ce qu’il faut blâmer de la naïveté, du cynisme ou de l’inattention des successeurs de ces Floquet, Dubost et Antonin Dupuy [en fait plutôt Antonin Dubost et Charles Dupuy], qui indignaient si fort Léon Blum. Sans doute les mieux inspirés de nos législateurs, lorsqu’ils votent ces textes, se rassurent en pensant que tout cela n’aura qu’un temps. Je crains fort qu’ils ne s’abusent.
Les atteintes sont si profondes qu’il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Elles dureront après que le dernier islamiste aura été arrêté. Elles s’appliqueront, selon les humeurs du temps, à d’autres objets de la vindicte générale, et peut-être cette vindicte sera-t-elle alors moins justifiée qu’aujourd’hui. Les principes ne sont pas comme des barrières qu’un chef de la gare parlementaire pourrait lever ou abaisser à son gré. Et ici d’ailleurs, la métaphore clinique est plus utile que la métaphore ferroviaire. Parce que corrompre les principes, c’est introduire dans notre vie collective un ferment de décomposition dont nous ne connaissons pas l’antidote. Ou plutôt si. Nous le connaissons.
L’antidote, c’est vous. C’est bien parce qu’ils ont voulu que soient tracées des limites infranchissables que les constituants ont écrit ce magnifique préambule de la Déclaration, relatif à l’oubli et au mépris des droits imprescriptibles de l’homme, dont les conséquences sont si graves qu’il fallait bien qu’un texte les rappelât aux gouvernants afin que personne ne pût s’y tromper. Une telle attitude ne procède pas de je ne sais quel idéalisme niais, mais du plus grand réalisme qui soit. On le voit bien aujourd’hui, où nos principes les plus éprouvés sont près de céder alors même que nous ne connaissons ni la guerre ni l’occupation étrangère.
Organiser la société précaire du soupçon
Je voudrais aussi insister sur un second point. La disposition qui vous est déférée n’a pas seulement pour effet de suspendre nos libertés politiques en les subordonnant à ce que la doctrine a pu appeler, pour la stigmatiser d’ailleurs, la « doctrine pénale de l’ennemi ». Elle va beaucoup plus loin et atteint, dans son fondement même, l’idée fondatrice de notre droit pénal, qui a été rappelée par mon confrère, et qui est qu’avant l’acte criminel, il n’y a rien. Bien sûr, lorsque l’acte est commis on recherche l’intention. Mais avant qu’il soit commis au moins dans la forme du commencement d’exécution, il n’existe que des citoyens comme les autres, des citoyens innocents. Rompre avec cette conception, c’est faire de tout citoyen un délinquant, un criminel en puissance, c’est organiser la société précaire du soupçon, de la surveillance, et demain de la rétention généralisée, ou pire encore.
On reste stupéfait par la facilité avec laquelle le législateur a cru pouvoir s’écarter du seul principe qui garantisse de manière absolue notre dignité de personnes. « Pendant quarante ans, dit le coupable de la lettre à mon juge de Simenon, pendant quarante ans comme vous, comme les autres, j’ai été un homme libre. Personne ne se doutait que je deviendrais un jour ce qu’on appelle un criminel. Autrement dit je suis, en quelque sorte, un criminel d’occasion. » Tout notre droit criminel depuis le Moyen-Âge repose sur cette idée du criminel d’occasion, qui seule garantit nos libertés. Et voici qu’on nous propose soudain de l’abandonner encore, comme surpris au coin d’un bois. Ce n’est pas tout de traiter avec mépris, comme on le fait parfois, de « droits de l’hommiste » tous ceux qui n’ont pas renoncé à l’espoir d’une société juste.
Encore faudrait-il avoir lu les bons auteurs et compris qu’ils avaient, en leur temps qui n’était pas moins dangereux que le nôtre, prévu ce qui nous arrive aujourd’hui. Hugo, plaidant, je l’ai cité tout à l’heure, pour la liberté d’opinion, s’élevait déjà contre les esprits forts qui écartent d’un revers de main, je cite, « ces démagogues qui s’appellent Beccaria, Montesquieu, Turgot et Franklin », et que l’on nous permettra, je l’espère peut-être, de continuer à préférer au substitut Pinard et au capitaine Hurluret.
Face à ces atteintes, la défense du gouvernement, dont il est difficile de savoir ce qu’il déplore et ce qu’il approuve et fait souvent de lui le disciple des mystères de Cocteau, paraît d’une insigne faiblesse.
Le mépris dans lequel le gouvernement tient votre office
Le gouvernement relève d’abord la particularité de l’acte terroriste. Mais il n’y a pas de particularité par nature de l’acte criminel. La démocratie, c’est son essence, réprime les actes qu’elle prend à tâche de nommer en fonction de ses seuls principes. Le Parlement, par conséquent, n’est pas une chambre d’enregistrement des désirs professionnels de la police et des juges. En juger autrement, c’est subordonner la République à ses ennemis, et leur conférer une dignité conceptuelle qu’ils ne sauraient avoir. Aussi bien, d’ailleurs n’y arrive-t-on jamais entièrement, du moins tant que les principes n’ont pas disparu. Alors on ruse, on essaye de contourner. Et à la fin, ni les principes ni l’efficacité n’y trouvent leur compte.
Lorsque le parlement a réintroduit, quelques heures après que vous l’ayez annulée, la disposition relative à la consultation des sites terroristes, il n’a pas seulement donné un témoignage éclatant du mépris dans lequel il tient en ce moment votre office. Les débats devant la commission mixte paritaire étaient plus intéressants encore. Ce n’était que travail de bureaucrates, essayant de renommer, de redéfinir, de contourner, afin d’éviter une censure ultérieure sans rien changer au fond, et sans que personne, je dis bien personne, le Journal officiel en fait foi, ne s’interroge jamais sur les principes ni sur le raisonnement qui avaient, en profondeur, motivé votre décision.
Le deuxième argument du gouvernement, qui reconnaît volontiers que sa liste à la Prévert de faits matériels ineptes innocents en eux-mêmes ne suffit pas, c’est qu’il faut que l’intention soit prouvée. Mais comment le serait-elle avec cette certitude ? Là-dessus on n’en saura pas davantage, et il faudra s’en remettre au juge, qui sera on s’en doute fort satisfait d’exercer un arbitraire qu’il a, en pratique, sollicité et obtenu du Parlement.
La disposition qui ruine les trois piliers
Je voudrais pour conclure laisser de côté cette technique qui nous est à tous trop familière, et les figures obligées de la rhétorique constitutionnelle. Tout le monde sait que ce que vous conduisez n’est pas un exercice d’équilibre entre les droits du Parlement et la volonté des constituants, ou plutôt que si c’en est un, vous vous inspirez pour trouver ce point d’équilibre d’une véritable philosophie de nos droits.
Si on la prend d’un peu loin, dans son origine même, cette philosophie comporte trois piliers. Le premier, c’est la souveraineté du peuple constituant dans la définition de ses droits imprescriptibles qui sont les siens. Le second, c’est la liberté d’être, c’est-à-dire de penser, d’opiner ou d’agir, jusqu’à ce que l’on commette le mal - à condition que celui-ci ait été défini d’avance par la loi. Le troisième, c’est que le citoyen ne peut être poursuivi qu’à raison de l’acte qu’il a commis, sans quoi, et ni les grands mots belliqueux de l’état de guerre d’un côté, ni les litotes techniques de l’autre n’y changeront rien, il n’est qu’un esclave de l’Etat, maintenu dans la soumission par le jeu sans contrôle possible de ses institutions répressives.
La disposition qui vous est soumise ruine ensemble et simultanément ces trois piliers. Calquée sur les faits, oublieuse des principes, elle définit la répression non par ce qu’elle doit être, mais par la pratique des ennemis de la démocratie, leur assurant ainsi une formidable victoire sans combat. Dans cette mesure même, elle introduit la collectivité des citoyens libres dans un univers pré-totalitaire où les vies, les opinions, les modes d’être, seront soumis à l’arbitraire des juges de l’intention et de la préparation de l’acte. Enfin, en faisant reculer jusqu’à un point imaginaire la définition de l’acte criminel, elle nous expose tous, en réalité, à la perte de l’innocence civique.
Les libertés et la queue du lézard
De telles dispositions sont à l’évidence inacceptables. Elles le sont d’autant plus qu’elles participent d’un mouvement auquel le terrorisme sert de prétexte et qui a commencé bien avant lui. Elles le sont parce que les dégâts causés à notre philosophie du droit ne sont pas réparables. On croirait parfois que nos législateurs assimilent les libertés à la queue du lézard. Mais les libertés, elles, ne repoussent pas. Elles peuvent revenir lorsqu’on les suspend, mais non lorsqu’on introduit dans le droit des dispositions qui les atteignent dans leur principe même et qui les annulent.
Ces principes, vous les avez rappelés, par votre décision récente sur la consultation des sites terroristes. Il n’a été tenu, c’est peu de le dire, aucun compte de la décision que vous avez rendue. Nous en sommes au même point qu’avant cette décision, exposés au même péril. Et pourtant tout le monde s’attend à ce que vous ne déclariez pas inconstitutionnelle cette disposition comme vous l’avez fait de la précédente, comme si l’on vous pensait disposés à vous satisfaire d’un premier coup d’éclat, aux effets aussitôt annulés. Parce que j’ai lu avec attention votre première décision je n’en crois rien, et avec moi tous les amis des libertés publiques qui attendent de vous ce que dans notre pays, aucune institution sauf la vôtre ne leur donne plus : l’amour de notre tradition nationale, qui n’a pas traversé les guerres et l’occupation étrangère pour échouer devant les menées de quelques centaines de criminels navrants, et l’espoir que le rêve de notre liberté ne s’est pas dissipé, dans le fracas des attentats et le murmure des délibérations parlementaires.
Ainsi, par ma voix qui croyez-le bien, sans que cet aveu ne comporte aucune coquetterie, regrette d’être trop faible pour aborder des questions aussi graves que celles que vous avez à juger aujourd’hui, la Ligue des droits de l’homme vous demande de déclarer les dispositions en cause contraires à la Constitution. »
Les questions
La magistrate Nicole Maestracci, l’une des rares juristes, membre du Conseil constitutionnel depuis le 14 mars 2013, demande combien de personnes ont été poursuivies sur le fondement de cette loi. Réponse : 6 affaires recensées en 2016 (zéro en 2015), une condamnation, un non-lieu, trois procédures en cours, une affaire enregistrée. La seconde interrogation concerne le terme de « détenir », ajouté par le gouvernement, qui pourrait suffire à caractériser l’intention terroriste.
QPC
Durée : 05:02
Breton au ballon
Me Sureau en plaisante : « Je suis frappé du fait qu’on nous présente comme une nécessité absolue la violation de tous les principes pour finir pour conclure qu’il y a en réalité extrêmement peu d’actions engagées sur cette base ». Par ailleurs, l’avocat prend « le cas d’André Breton, qui à l’époque était notoirement trotskiste, et appelait même à la commission d’attentat, vous vous souvenez, “l’acte surréaliste le plus simple consiste à descendre dans la rue revolver au poing”, ce qui caractérise à n’en pas douter une intention, affirmée de la manière la plus claire. Comme moi André Breton fumait la pipe, et il avait donc chez lui comme moi des boîtes d’allumettes, et ces boîtes d’allumettes sont indiscutablement un objet dangereux au sens du premièrement, condition qui s’applique seule. Sur le fondement de ces textes, on aurait pu donc envoyer André Breton au ballon, ce qui aurait été extrêmement regrettable. »