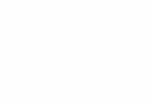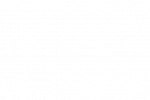Venezuela : une spirale mortifère

Venezuela : une spirale mortifère
Editorial. Le pays a sombré dans une grave crise économique et politique. La communauté internationale réagit enfin à la dérive du pouvoir du président Maduro.
Editorial du « Monde ». Le Venezuela connaît une crise multiforme. D’abord, une récession aggravée par des pénuries et une hyperinflation, qui ont fait chuter les trois quarts des Vénézuéliens dans la pauvreté. Triste destin pour une nation richissime en pétrole. La malédiction de l’or noir n’existe pourtant pas : la période de hausse exceptionnelle du cours du baril de 2000 à 2014 n’a pas été mise à profit pour jeter les bases d’une croissance durable, à cause de la gabegie populiste du régime chaviste et d’une corruption systémique. L’ancien président Hugo Chavez (1999-2013) ne méritait décidément pas l’enthousiasme qu’il suscita dans la gauche radicale comme dans certains milieux d’affaires.
Son successeur, Nicolas Maduro, a dilapidé en peu de temps le capital électoral accumulé par Chavez grâce à ses programmes sociaux gérés de manière clientéliste. Mais il a fait pire : il a voulu compenser l’érosion de sa base sociale par des entorses répétées à l’Etat de droit et aux règles républicaines. En décembre 2015, l’opposition a remporté les élections législatives et acquis une majorité des deux tiers au Parlement. Depuis, la Cour suprême a été utilisée de manière systématique pour contrer le travail des législateurs. Fin mars, les juges ont suspendu l’immunité parlementaire et ont délégué le pouvoir de légiférer à l’exécutif. Cette atteinte trop évidente à la séparation des pouvoirs a suscité un tollé et a été critiquée par la procureure générale de la République. Le régime a été obligé de rectifier le tir, du moins en partie. En quelque sorte, il a fait deux pas en avant et un pas en arrière.
Arrogance et brutalité
La cohabitation conflictuelle entre le gouvernement chaviste et l’opposition n’est pas une fatalité, pas plus que le choc entre les pouvoirs. Le gouvernement pèche par arrogance et brutalité. Les opposants, souvent en concurrence entre eux, ne manquent sans doute pas d’infantilisme ni d’improvisation. M. Maduro, formé à l’école de Fidel Castro, ne parvient pas à faire le deuil de sa culture du caudillo. Caracas fournit du pétrole à La Havane et en retire en échange une sorte de légitimité révolutionnaire. Les Cubains, très présents au Venezuela, ne sont pas forcément de bon conseil.
Pour éviter la mortifère spirale de la contestation des rues et de la répression, le gouvernement chaviste et ses opposants devraient négocier un calendrier électoral pour rendre la parole aux Vénézuéliens. Bien entendu, aucune élection libre ne saurait se satisfaire de candidatures interdites, comme celle d’Henrique Capriles Radonski, deux fois candidat de l’opposition à la présidence et aujourd’hui privé de ses droits politiques. Pas plus que de prisonniers politiques : ils sont plus d’une centaine au Venezuela, dont des élus et des dirigeants de l’opposition, comme Leopoldo Lopez, enfermé depuis plus de trois ans dans une prison militaire.
La communauté internationale, longtemps indifférente à la descente aux enfers du pays, semble s’être ressaisie et plaide désormais pour une solution négociée. La défense de l’Etat de droit, de la Constitution et des droits de l’homme devrait être un socle commun pour les démocrates. La complaisance à l’égard du populisme de la gauche radicale latino-américaine est peu compatible avec la mobilisation contre la montée de l’extrême droite en Europe ou aux Etats-Unis.