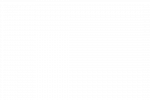Poutine et Erdogan en phase pour la création de « zones de désescalade » en Syrie

Poutine et Erdogan en phase pour la création de « zones de désescalade » en Syrie
Par Marie Jégo (Istanbul, correspondante)
Le président turc apparaît de plus en plus isolé dans le conflit qui perdure à ses frontières.
En visite mercredi 3 mai à Botcharov Routcheï, la résidence estivale de Vladimir Poutine à Sotchi, sur le littoral de la mer Noire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a soutenu l’initiative russe sur la création, pour trois mois renouvelables, de « zones de désescalade » en Syrie. Il s’agit de consolider le cessez-le-feu signé le 30 décembre 2016 et de favoriser le « retour volontaire des réfugiés » dans le pays, en guerre depuis 2011.
Dévoilé la veille de l’arrivée de M. Erdogan à Sotchi, lors d’une conversation téléphonique entre le président russe et son homologue américain Donald Trump, le plan russe envisage la création de quatre « réduits » dans les régions tenues par les rebelles (Idlib, Homs, le quartier de la Ghouta à Damas, et une région située dans le sud du pays).
Séparées du reste du territoire par des postes de contrôle et de surveillance, ces portions de territoire seraient gérées conjointement par l’armée syrienne et par la rébellion. Des « observateurs » venus de Turquie, d’Iran ou de Russie, les trois Etats parrainant l’accord, devraient y être déployés sous le contrôle du régime de Bachar Al-Assad. D’observateurs internationaux, il n’est pas question.
Décrit comme la suite logique de l’accord de cessez-le-feu signé en décembre 2016 entre la rébellion et le régime de Damas, le plan prévoit de faire à terme de ces réduits des zones d’exclusion aérienne sans mettre fin à la lutte contre « les organisations terroristes » qui se poursuivra sur le reste du territoire, a précisé M. Poutine. « Ultérieurement, ce processus devrait mener à la restauration complète de l’intégrité territoriale de la Syrie », a-t-il prédit. « Je suis certain que nos actions conjointes changeront l’avenir de toute la région », a renchéri M. Erdogan.
Tactique de la chaise vide
Selon le quotidien turc Hürriyet, la Russie ne pouvait pas faire moins que d’inviter les Turcs à déployer des observateurs chargés de la surveillance du cessez-le-feu sur le terrain, ce qu’elle a fait elle-même dans la région d’Afrine, frontalière de la Turquie, où des militaires russes et des soldats de l’armée de Bachar Al-Assad patrouillent désormais conjointement sur le pan de frontière turco-syrienne, situé dans cette région peuplée de Kurdes acquis au régime syrien.
Mais la rébellion syrienne rechigne à soutenir le plan russe embrassé par la Turquie, son principal soutien. Présents au nouveau round de pourparlers qui s’est ouvert lundi 3 mai à Astana, la capitale du Kazakhstan, les représentants de la Coalition nationale syrienne (CNS, opposition à Bachar Al-Assad) ont quitté la table dès l’annonce du plan, réclamant la fin des bombardements.
Lâchée par l’allié turc, l’opposition syrienne, coutumière de la tactique de la chaise vide à Astana, pourrait revenir à de meilleurs sentiments dès jeudi, au deuxième jour des pourparlers, espérait-on à Ankara.
Lundi, les rebelles ont pu s’entretenir avec Stuart Jones, le sous-secrétaire d’Etat américain pour les affaires proche-orientales, dépêché à Astana juste après la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. A l’origine, seul l’ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan, George Krol, avait été invité. « Si j’ai bien compris, l’administration américaine soutient cette idée », s’est félicité M. Poutine.
Il s’agit d’avoir la Turquie à l’œil au moment où la tension ne cesse de monter entre l’armée turque et les Unités de protection du peuple (YPG), des milices kurdes syriennes honnies par Ankara mais soutenues par Washington, Moscou et Damas. Vendredi, l’armée turque a annoncé avoir riposté à l’attaque à la roquette d’un de ses postes avancés à Ceylanpinar sur la frontière turco-syrienne par des tirs d’artillerie sur le QG des YPG, tuant onze combattants kurdes.
Les YPG multiplient les attaques contre l’armée turque depuis que celle-ci a mené des raids aériens meurtriers sur leurs positions, mardi 25 avril. Ces frappes n’ont pas été du goût des Américains, dont les forces spéciales étaient déployées à 8 kilomètres de là. Elles visaient à mettre la pression sur Washington avant la rencontre prévue les 16 et 17 mai à Washington entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, assurent les politologues.
En vain, car malgré les appels insistants de M. Erdogan à lâcher la milice kurde, Moscou et Washington continuent de la soutenir, la voyant comme la force la plus efficace dans la lutte contre les djihadistes de l’organisation Etat islamique.
Le président Recep Tayyip Erdogan apparaît de plus en plus isolé sur la scène internationale, ce qui ne l’a pas empêché, lundi, de vanter le « statut spécial » de la relation russo-turque. Les relations commerciales entre les deux voisins de la mer Noire n’ont toujours pas recouvré leur niveau d’avant la brouille de novembre 2015, quand un chasseur turc avait abattu un bombardier russe dans le sud de la Turquie. Moscou a bien levé l’embargo sur les oignons turcs, mais pas sur les tomates, tandis qu’Ankara n’achète plus de blé russe. Quant à l’éventuelle fourniture à la Turquie, membre de l’OTAN, d’un système russe de défense antimissile S-400, elle est comme l’Arlésienne : on en parle beaucoup mais on ne la voit jamais.