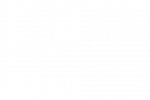Face à la médecine libérale, l’hôpital tunisien se vide de ses forces vives

Face à la médecine libérale, l’hôpital tunisien se vide de ses forces vives
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Tunisie : « Et sinon la santé, ça va ? » (1/4). Etablissements sous-équipés, praticiens tentés par le privé… Tels sont les maux qui rongent le système sanitaire du pays.
En marchant vers l’ambulance, Boulbeba Makhlouf croise un petit groupe de patients. Certains sont penchés sur leurs béquilles, d’autres ont le bras plâtré ou bandé. La procession est laborieuse sur l’allée pentue coiffée de pins. Le Kef est une cité qui dégringole sur le flanc d’une petite montagne, dans le nord-ouest de la Tunisie, alors son hôpital pique du nez vers la plaine verdoyante en contrebas. Boulbeba Makhlouf, médecin généraliste à l’allure bonhomme, joues mangées par une barbe taillée, s’apprête à accompagner un malade atteint d’épilepsie à Tunis, située à 160 km. La distance n’est pas très élevée, mais, à l’échelle de la Tunisie, c’est déjà un autre monde.
Le Nord-Ouest, dont Le Kef est l’une des principales villes, figure parmi ces régions intérieures laissées-pour-compte d’un développement concentré dans le Grand Tunis et le littoral nord-est. Le départ vers la capitale du docteur Makhlouf et de son malade en est une illustration criante : l’hôpital régional du Kef, qui est censé couvrir 250 000 personnes, ne dispose d’aucun neurologue. Parmi les trois chirurgiens, aucun n’est pédiatrique. « On envoie donc à Tunis les enfants devant se faire opérer de l’appendicite », grince M. Makhlouf.
Quelques instants plus tôt, alors que le médecin nous guide dans les couloirs de l’hôpital, des cris courroucés retentissent du fond d’une salle. Un homme vient de se faire éconduire, une fois de plus, devant le bureau de l’unique ophtalmologue. Il hurle son dépit. « Il faut maintenant prendre rendez-vous une année avant pour l’ophtalmologue », soupire M. Makhlouf. Résultat : les hôpitaux de Tunis sont engorgés de patients contraints de faire le déplacement vers la capitale, car les dispensaires locaux et les hôpitaux régionaux ne jouent plus leur rôle.
Un système à deux vitesses
L’hôpital tunisien va mal, c’est un euphémisme. Le constat est largement partagé, autant par ceux qui défendent le service public que par ceux qui veulent libéraliser le secteur. Ce constat est d’autant plus amer que la Tunisie était jusqu’alors un modèle sur le plan sanitaire, avec, par exemple, un taux de vaccination de la population qui a pu grimper jusqu’à 90 %.
Mais une double transition est en train de fragiliser ces acquis. La première est épidémiologique, avec « l’explosion des maladies non transmissibles », souligne Moncef Bel Haj Yahyia, médecin à la retraite et secrétaire général de l’Association tunisienne de défense du droit à la santé (ATDDS). « Le système, ajoute-t-il, n’est pas préparé à l’apparition de ces nouvelles pathologies » telles que les maladies respiratoires ou cardiovasculaires, les cancers…
La seconde transition est d’ordre économique, avec l’émergence du secteur privé et de pratiques libérales au sein de l’hôpital public, qui aboutissent à conforter un système à deux vitesses : performant pour ceux qui en ont les moyens ou sont dûment assurés, discriminatoire pour les plus précaires, souvent non couverts par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Il en découle une aggravation des fractures sociales et territoriales, dont les dysfonctionnements de l’hôpital du Kef ne sont qu’un exemple parmi d’autres.
La carte sanitaire de la Tunisie, document disponible sur le site du ministère de la santé, en offre un tableau saisissant. On y lit par exemple que la densité de médecins est de 41,7 pour 100 000 habitants à Sidi Bouzid, ville défavorisée du centre du pays (et berceau de la révolution tunisienne, en décembre 2010), tandis qu’elle est de 352,7 à Tunis, soit un taux huit fois supérieur. Autres chiffres révélateurs : les médecins spécialistes sont plus nombreux dans le secteur privé (4 720) que dans le secteur public (3 035), alors que ce dernier absorbe les trois quarts de la capacité en lits. Enfin, le déséquilibre en équipements « lourds » devient préoccupant : les appareils IRM (imagerie par résonance magnétique) sont quatre fois plus nombreux dans le secteur privé (39) que dans le secteur public (10).
« Une privatisation de la santé »
L’essor du secteur privé, depuis les années 1990, a mis à rude épreuve un secteur public qui se débattait déjà dans des problèmes de financement. Afin d’éviter le départ des médecins agrégés du public vers le privé (les revenus peuvent y être cinq fois supérieurs), le gouvernement a conçu une formule d’« activités privées complémentaires » (APC), à raison de deux après-midis hebdomadaires. Durant cette parenthèse, les médecins officient à titre privé à l’hôpital (pour des consultations) ou dans des cliniques extérieures (pour des actes). « Mais il n’y a aucun contrôle, ce qui permet abus et exagérations, se désole Mounir Youssef Makni, le président du Conseil national de l’ordre des médecins. Rares sont ceux qui respectent les deux après-midis par semaine. »
« En fait, c’est tout le temps, déplore Zied Bellamine, président de la Société tunisienne de médecine de famille. Car le privé, c’est tout ou rien. S’il y a une urgence, il faut y aller. » Les effets sur l’hôpital sont « catastrophiques », poursuit M. Bellamine, car « certains chefs de service ont laissé tomber les soins, l’encadrement et l’enseignement », absorbés qu’ils sont par leur quête de revenus complémentaires. Sur les 6 800 médecins du secteur public, 400, qui ont au moins le titre de maître de conférences agrégé, ont officiellement droit à ces APC. Et comme ils sont l’élite de la médecine tunisienne, leur désengagement de l’hôpital manque cruellement aux jeunes médecins « résidents » (équivalents des internes en France), aux infirmiers et, in fine, aux usagers du secteur public.
« Les APC, c’est de fait une privatisation de la santé », dénonce M. Makhlouf, le médecin du Kef. Un cercle vicieux s’est enclenché : les problèmes de gouvernance de l’hôpital public causés par son financement défectueux – la CNAM, déficitaire, n’honore pas ses obligations – découragent les compétences et les font fuir vers des activités libérales. Ainsi l’hôpital est-il devenu le théâtre, dénonce M. Makhlouf, d’un « véritable détournement de clientèle », laquelle est souvent orientée par des rabatteurs vers les « APC » d’un médecin hospitalier, voire ses activités dans des cliniques extérieures.
Négligence, irresponsabilité, corruption
Dans ces conditions, il ne faut guère s’étonner que des appareils tombés en panne à l’hôpital ne soient pas réparés. Qui y a réellement intérêt ? A l’hôpital du Kef, la sonde de l’échographie cardiaque est « cassée depuis six mois et personne ne s’en soucie », gronde M. Makhlouf. Le ver est dans le fruit. Négligence, irresponsabilité, appât du gain se généralisent. La corruption, petite et grande, sape inexorablement les normes éthiques. M. Makhlouf le dit sans détour : « Pour les personnels de santé eux-mêmes en difficulté financière, le malade est devenu le seul moyen d’équilibrer leur budget. » En gros, tout se monnaie. Le patient ne cesse d’y aller de sa poche, y compris quand il lui faut acheter la compresse ou le pansement, en rupture de stock à l’hôpital, à la pharmacie du coin. « Il ne fait pas bon tomber malade en Tunisie, soupire Basma, une Tunisoise qui eut à fréquenter l’hôpital. Sauf si on a de l’argent. »