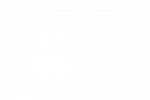Afrique du Sud : Athi-Patra Ruga, le trauma en habit de lumière

Afrique du Sud : Athi-Patra Ruga, le trauma en habit de lumière
Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)
Dans un pays toujours marqué par la ségrégation raciale et une démocratisation décevante, le jeune artiste s’élève contre la violence et tous les stéréotypes.
Athi-Patra Ruga a l’enthousiasme communicatif. Dans son atelier du Cap, encombré de babioles et autres colifichets, le jeune artiste sud-africain parle avec chaleur de ses œuvres. Avec humour aussi, et juste ce qu’il faut de folie queer. Mais derrière les ors et le glamour qui imprègnent ses œuvres, pointe la noirceur d’une génération désenchantée.
Né en 1984, dix ans avant l’avènement de Nelson Mandela à la tête du pays, Athi-Patra Ruga questionne l’idéal d’une société arc-en-ciel, en se référant à une autre utopie, celle d’Azania, Arcadie aux couleurs tropicales peuplée de personnages mutants. « Quand je pense à l’Arcadie, je pense d’emblée à ce qui manque », glisse-t-il, en ajoutant : « On nous a bassiné avec une histoire qu’on nous a livrée toute cuite. Mais ce qu’on voit, c’est que l’exercice de la démocratie n’a pas marché. »
Athi-Patra Ruga, l’artiste aux mille visages à la Fondation Vuitton
Durée : 03:30
Athi-Patra Ruga a 10 ans quand le pays s’ouvre. C’est le boom d’Internet et la promesse de la prospérité. Immigrés venant de la Zambie ou du Zimbabwe affluent en Afrique du Sud. Le bel édifice démocratique se lézarde vite. « Je ne savais pas que quelques années plus tard ça nous conduirait au nationalisme », raconte-t-il. A la xénophobie rampante s’ajoute l’homophobie, les premiers morts du sida. « Un jour vous avez un ami, et puis vous le perdez aussitôt », raconte-t-il. Quant à l’apartheid, le sujet est tabou. Quand, adolescent, il interroge son père au sujet de la ségrégation raciale, la réponse fuse, lapidaire : « C’était très dur. » Point final. « Soit mon père cachait ses sentiments, soit il était fatigué de tout ça », commente Athi-Patra Ruga.
Des avatars chamarrés et transgenres
Pour faire émerger ce refoulé, le jeune homme se livre à des performances, dans la rue, les night-clubs et les musées. Toujours sans autorisation. Pour aborder les questions d’identité, du corps noir, du sacré et du profane, de l’individu et du collectif, du mythe et de la réalité, Ruga opte pour le camouflage. Il invente des avatars chamarrés et transgenres. Le plus récent se nomme Versatile Queen Ivy, créature hybride rutilant d’or, qui a fait sa première apparition en 2016 lors du festival Performa, à New York. « Si j’avais traité ces sujets en restant dans mes habits civils, j’aurais fait une dépression nerveuse », raconte-t-il.
Son choix se porte aussi depuis 2003 sur la tapisserie, un médium jugé féminin et domestique, tout bonnement déviant pour les tenants d’une hiérarchie entre beaux-arts et art populaire. Ruga en connaît un rayon sur les stéréotypes. Adolescent, il a été élevé à la dure, dans une école anglicane où tous les garçons devaient réciter leur prière et incarner le mâle sud-africain : monter à cheval, tirer à la carabine et faire du rugby. « Si j’ai fait de l’art, c’était pour échapper au rugby », ironise-t-il.
« Imini YomJojo : Ingqumbo Yeminyanya », 2017, tapisserie de laine, 250 x 250 cm. | Courtesy de l’artiste et WHATIFTHEWORLD.
Pour déjouer aussi les échelles de valeurs. « Une femme est supposée faire de la tapisserie – ma mère faisait du crochet –, une tapisserie est supposée être correctement accrochée au mur et encadrée, un homme ne s’habille pas en femme… », égrène-t-il. Le crochet, c’est bien plus qu’une madeleine de Proust. C’est un retour au vernaculaire, aux racines profonde de la culture africaine. Tout comme le mythe d’Azania, dont le mot apparaît sous la plume de l’historien Pline l’Ancien en 40 après Jésus-Christ avant de resurgir dans la rhétorique panafricaniste au moment des luttes pour l’indépendance.
Chez Ruga, le trauma s’habille toujours en habit de lumière. L’art flirte avec la mode et démine le bon goût. C’est d’ailleurs avec jubilation qu’il décrit le cycle de tapisseries qu’il présente à la Fondation Louis Vuitton : « C’est une parodie à mi-chemin entre le soap opera et la tele-novela baroque avec les proportions de Rubens. » Le baroque est parfaitement assumé, tout comme la beauté, terme honni par le monde de l’art contemporain. Le modernisme s’est employé à expurger la création de tout ornement, jugé « criminel » par l’architecte viennois Adolf Loos. « La beauté est regardée de haut, mais c’est une histoire de l’art écrite par les Blancs du Nord qui ont refusé toute forme populaire ou féminine », réplique Athi-Patra Ruga.
« Etre là » : l’Afrique du Sud, une scène contemporaine
Pour lui, l’exubérance et l’apparat sont plus efficaces que de longs discours. « La violence, on peut facilement la rejeter, indique-t-il. La beauté, elle, agit comme un sortilège. C’est un cheval de Troie. » L’art et ses avatars ne sont pas qu’un viatique pour faire passer ses idées. C’est aussi un onguent à sa colère, celle qu’il a ressentie en 2008 lorsqu’une jeune femme a été attaquée parce qu’elle portait une mini-jupe. Celle qu’il éprouve aujourd’hui face aux promesses non tenues. « Bien sûr, parfois je veux jeter des pierres, admet-il. Mais le plus souvent, je veux panser les plaies. » Un travail de cicatrisation que la jeune démocratie sud-africaine a peiné à mener.
Ce article est tiré du hors-série du Monde, Art, le printemps africain, 84 pages, 12 euros, en librairie et sur boutique.lemonde.fr.
Exposition Afrique du Sud « Etre là », Fondation Louis-Vuitton, du 26 avril au 28 août 2017.