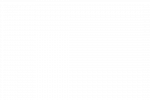En Turquie, deux enseignants en grève de la faim depuis 67 jours pour dénoncer les purges

En Turquie, deux enseignants en grève de la faim depuis 67 jours pour dénoncer les purges
Par Marie Jégo (Istanbul, correspondante)
Victimes des purges après le coup d’Etat manqué en Turquie, l’universitaire Nuriye Gülmen et l’instituteur Semih Özakça jeûnent, dans l’indifférence des autorités turques.
Nuriye Gülmen et Semih Özakça, deux enseignants victimes des purges de l’après coup d’Etat manqué en Turquie, sont entrés dans leur 67e jour de grève de la faim, dimanche 14 mai. Elle a perdu neuf kilos et lui quinze, mais ils continuent à se rendre chaque jour – lui d’un pas lent, elle en chaise roulante – jusqu’à leur « espace de protestation », une petite place de l’avenue Yüksel au centre d’Ankara pour réclamer leur réintégration.
« Rendez-nous notre travail » est leur principal slogan. Brandissant des pancartes, chantant des slogans, les parents des grévistes et les représentants de la société civile – ONG, intellectuels, syndicalistes – se relaient pour les soutenir. Samedi, journée dédiée aux 145 000 fonctionnaires limogés, Nuriye a expliqué : « Nous pouvons nous remettre des douleurs physiques. Mais les atteintes à notre honneur, il faudra vivre avec toute notre vie. » Des députés de l’opposition kémaliste et du parti pro kurde HDP ont fait le déplacement à leur rencontre. Vendredi, l’eurodéputé Gianni Pitella, chef du groupe Socialistes et Démocrates du Parlement européen, est venu en personne saluer leur combat.
Subsistant depuis 67 jours avec de l’eau sucrée ou salée, Nuriye et Semih voient leur état de santé se dégrader de jour en jour. « Ils souffrent de troubles de la perception, de difficultés d’élocutions, de problèmes physiques », a constaté Vedat Bulut, président de la chambre professionnelle des médecins à Ankara. Les grands médias du pays restent muets sur leur lutte, seuls les réseaux sociaux en parlent. Le gouvernement regarde ailleurs. Questionné par des députés de l’opposition sur la grève de la faim des deux enseignants, le vice premier ministre Numan Kurtulmus, dont les bureaux sont situés à quelques centaines de mètres du lieu de la protestation, a déclaré qu’il n’était pas au courant.
« Aucun recours juridique n’est possible »
Une ambulance et deux médecins ont été dépêchés par le ministère de la santé. Pour le reste, la police est en première ligne, intervenant régulièrement pour chasser les manifestants et confisquer leurs pancartes. Devenu emblématique du sort fait aux victimes des purges, « l’espace de protestation » a été investi à trente reprises par les forces de l’ordre en 182 jours d’occupation.
Affaiblis mais déterminés, Nuriye et Semih réclament leur réintégration dans l’Education nationale et « l’annulation de tous les décrets de l’état d’urgence ». Comme eux, 145 000 fonctionnaires ont été limogés d’un trait de plume depuis la tentative de renversement du président Recep Tayyip Erdogan le 15 juillet 2016. Policiers, militaires, magistrats, diplomates, enseignants : aucune catégorie sociale n’a été épargnée.
Semih était instituteur dans un village de la région de Mardin dans le sud-est de la Turquie, lorsque son nom est apparu sur le décret n° 675 du 29 septembre 2016. Nuriye enseignait la littérature à l’université Selçuk de Konya, elle a été limogée par le décret 679 du 6 janvier 2017.
« Ces décrets de l’état d’urgence ne peuvent être contestés, aucun recours juridique n’est possible », rappelle leur avocat Engin Gökoglu, déplorant « le comportement archaïque » des autorités. Aucune explication n’est par ailleurs fournie aux « purgés », désignés collectivement comme une « menace à la sécurité nationale ».
Machine à purges
Au départ, les purges visaient les sympathisants du chef religieux réfugié aux Etats-Unis Fethullah Gülen, décrit par les autorités turques comme l’instigateur du coup. Très vite, elles se sont étendues aux syndicalistes, aux militants de gauche, aux partisans de la cause kurde, à toutes les voix dissidentes.
Le fonctionnement de la machine à purges est simple. Dans un premier temps, des listes de suspects sont dressées par les administrations concernées, fortement incitées par leur hiérarchie à s’auto-nettoyer. Ces listes remontent ensuite au cabinet du premier ministre, où elles sont examinées. Puis vient la publication des décrets – des listes de noms – au Journal officiel.
Voir son nom apparaître sur l’une de ces listes est synonyme de mort sociale. Non content de perdre leur emploi et leurs droits sociaux, les personnes concernées ne peuvent plus sortir du pays. Pas question pour elles de retravailler selon leur spécialité. Il ne leur reste qu’à chercher à se caser comme vendeur ou vendeuse de simit (petits pains au sésame) ou comme laveur-se de vitres. Car aucun employeur ne se risquera à embaucher quelqu’un dont le nom de famille figure en rouge dans le « e-system » du gouvernement. Du jour au lendemain, 145 000 personnes sont ainsi devenues des parias de la société.