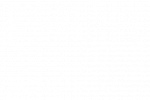« Faire entendre la voix de nos vieux invisibles »

« Faire entendre la voix de nos vieux invisibles »
Par Abdourahman Waberi (chroniqueur Le Monde Afrique)
Pour notre chroniqueur, le sort des « chibanis », travailleurs marocains de la SNCF discriminés, est aussi emblématique du traitement réservé au grand âge dans notre société : cachez cette vieillesse que nous ne saurions voir !
A Paris, le 15 mai 2017, procès en appel de la SNCF contre les « chibanis », ces travailleurs marocains immigrés des années 1970 qui ont fait condamner la compagnie ferroviaire française à leur verser des dommages et intérêts pour discrimination. | SYLVIE HUSSON/AFP
Non, il ne sera pas question de crise économique, de dérèglement climatique, de migrations forcées ou de conflits armés dans cette chronique. Il ne sera pas question non plus de la jeunesse du président Emmanuel Macron ou de la durée du mandat de son premier ministre Edouard Philippe. Il va être question, pour une fois, du grand âge et de la solitude de ceux que l’on appelle pudiquement les « seniors » dans nos sociétés.
Caler le regard sur les vieux, notamment les immigrés dits aussi chibanis (« cheveux blancs » en arabe), c’est répandre un peu de lumière sur les bas-côtés sombres de notre quotidien, faire entendre un brin la voix de ces invisibles. Dans cette chronique, il n’est donc pas interdit de mettre ses sens en éveil, de faire provision de tendresse, de porter une attention particulière aux têtes chenues, percluses de rhumatisme et rangées souvent par la maladie.
Un entre-deux existentiel
Les immigrés africains arrivés en France dans les années 1970, du temps où les usines tournaient encore à plein régime, sont aujourd’hui des petits vieux. Bien sûr, ils ne sont pas tous rentrés au bled la retraite venue. Ils errent souvent dans un entre-deux existentiel quand ils ne sont pas victimes d’un imbroglio juridique comme les chibanis marocains employés par la SNCF et dont la presse s’est fait récemment l’écho.
Qu’ils viennent du Maghreb ou de l’Afrique subsaharienne, qu’ils vivent au sein de leur famille ou isolés dans un foyer de type Sonacotra, ces retraités restent invisibles. On fait mine d’oublier qu’ils ont travaillé toute leur vie, qu’ils ont donné leurs meilleures années au secteur industriel publié ou privé. Dans leur misère morale, ils ne sont forcément plus mal logés que leurs anciens collègues français.
En France, et ailleurs en Occident, le sort fait aux personnes âgées est tout sauf enviable. C’est ce qui choque le plus les Africains débarquant en Occident. Et je fus littéralement saisi d’effroi quand j’ai mis les pieds, pour la première fois en 1985, dans une maison de retraite. Des mois durant, je me suis demandé pourquoi on évitait tant de parler de vieillesse, de dépendance, de maladie et de la mort, tabou suprême.
A Djibouti, j’ai davantage été éduqué par ma grand-mère que par mes parents. C’était elle le chef, le pilier de la famille. Elle avait un avis sur tout et presque toujours le dernier mot. Enfant, la vieillesse ne paraissait pas comme un naufrage ou une anomalie, mais au contraire comme le summum de la sagesse et de la sérénité.
Parler du grand âge
C’est pourquoi je considère que c’est une nécessité que de parler du grand âge ici et maintenant, en Europe et en Afrique. Il faut en parler. Même si cette discussion n’est pas aisée et d’aucuns voudraient l’éviter. Car ce n’est pas raisonnable et pour cause : près d’un Français sur cinq a plus de 65 ans et, en 2050, un habitant sur trois sera âgé de plus de 60 ans. Si l’espérance de vie s’allonge, on meurt mal et de plus en plus seul.
Jadis, dans les montagnes de la Kabylie comme dans les campagnes du Berry, les vieux vivaient et mourraient entourés de leurs proches. Aujourd’hui, la famille n’est plus aussi large et solide qu’avant. Il nous faut réinventer de nouveaux liens entre les générations. En attendant, nos petits vieux des périphéries urbaines se débrouillent comme ils peuvent. Certains vont aller chercher un peu d’animation – et sans doute d’affection – dans les centres commerciaux.
Dans les longs couloirs de ces bunkers dévolus au négoce, ils croisent la génération de leurs petits-enfants déambulant en quête d’une connaissance, d’une anecdote ou d’une clope. Là, ils retrouvent d’autres petits vieux agglutinés autour d’une table pour commenter l’actualité du jour ou leur bilan de santé. En fonction de l’heure, nos petits vieux mélancoliques se traînent du premier café au second et, enfin, jusqu’au dernier qui a pour habitude de fermer tard. Ils conversent en silence comme s’ils complotaient contre plus fort qu’eux.
Je les aime beaucoup nos vieux Pierrots lunaires. Ils ont le keffieh de guingois sur le crâne et le salamalec facile. Leurs mains vous touchent, vous palpent l’épaule dès que vous vous arrêtez à leur hauteur pour les saluer. A l’heure de la fermeture, ils sont les seuls à flâner, à s’égarer sur un chemin qu’ils connaissent par cœur.
Abdourahman A. Waberi est né en 1965 dans l’actuelle République de Djibouti. Il vit entre Paris et les Etats-Unis, où il a enseigné les littératures francophones aux Claremont Colleges (Californie). Il est aujourd’hui professeur à George-Washington University. Auteur, entre autres, d’Aux Etats-Unis d’Afrique (éd. J.-C. Lattès, 2006) et La Divine Chanson (éd. Zulma, 2015). En 2000, Abdourahman Waberi avait écrit un ouvrage à mi-chemin entre fiction et méditation sur le génocide rwandais, Moisson de crânes (ed. Le Serpent à plumes), qui vient d’être traduit en anglais, Harvest of Skulls (Indiana University Press, 2017).