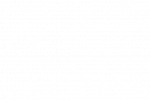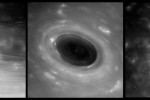L’accès aux réseaux sociaux devient un droit constitutionnel aux Etats-Unis

L’accès aux réseaux sociaux devient un droit constitutionnel aux Etats-Unis
Par Laura Michelotti
Le verdict rendu le 19 juin par la Cour suprême intègre cet accès dans le premier amendement de la Constitution américaine, au titre du droit à l’information et à la liberté d’expression.
Le verdict rendu le 19 juin par la Cour suprême intègre cet accès dans le premier amendement de la Constitution américaine, au titre du droit à l’information et à la liberté d’expression. | Dado Ruvic / REUTERS
Surfer sur Facebook ou communiquer son humeur du moment en 140 caractères sur Twitter fait désormais partie de la routine pour des milliards d’internautes. Aux Etats-Unis, lundi 19 juin, la Cour suprême a fait de leur utilisation une composante essentielle de la liberté d’expression, garantie par la Constitution.
La plus haute instance judiciaire américaine devait trancher deux questions sur la portée du texte suprême dans l’espace numérique, dans le cadre d’une affaire de crimes sexuels, vieille de six ans. Le premier amendement de la Constitution américaine, relatif à la liberté d’expression s’applique-t-il à Internet ? Et si oui, jusqu’à quel niveau le gouvernement peut-il donc en limiter l’accès aux individus ?
L’individu au cœur de l’affaire s’appelle Lester Packingham. En 2002, alors âgé de 21 ans, il plaide coupable pour détournement sur une mineure de 13 ans. Il purge sa peine et demeure, comme le veut la procédure américaine, inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels.
D’après une loi de 2008 applicable en Caroline du Nord, il lui est interdit, pour une durée de trente ans, de se connecter à tous sites qui pourraient être utilisés par des enfants, réseaux sociaux inclus. Mais en 2010, Packingham s’inscrit sur Facebook, en utilisant un faux nom. Il poste alors un commentaire où il se réjouit de l’annulation d’une amende de stationnement. Commentaire qui sera repéré par un policier chargé de traquer en ligne les délinquants sexuels. Malgré l’absence de preuves de son implication dans un nouveau crime, les autorités placent l’homme en garde à vue, puis l’arrêtent pour fraude.
« Tout le monde est sur Twitter »
Packingham décide alors de faire appel et de poursuivre l’Etat, pour violation du premier amendement. Outre la liberté d’expression, le premier amendement protège en effet également l’accès à l’information. Durant les débats de mars dernier, les juges de la Cour suprême étaient tombés d’accord sur le fait que l’accès aux médias sociaux méritait une protection constitutionnelle. « Tout le monde est sur Twitter, déclare alors la juge Elena Sagan, citant en exemple le compte du président américain. Ces sites sont désormais implantés dans notre culture comme des moyens de communiquer et d’exercer nos droits constitutionnels. »
Pour le procureur général adjoint de Caroline du Nord, c’est pour protéger les enfants des prédateurs que son Etat a mis en place cette loi. Arguant, statistiques à l’appui, que les réseaux sociaux étaient utilisés dans 82 % des crimes sexuels contre des enfants commis en ligne pour obtenir des informations sur leurs goûts et leurs habitudes. Mais pour les juges, une telle logique pourrait s’appliquer à n’importe quel secteur criminel : « Un voleur de banque peut aussi utiliser Internet pour localiser une banque, ou faire des recherches sur le personnel. Si un crime est commis avec l’aide d’Internet, la loi ne devrait-elle pas s’appliquer à tous ces criminels de manière identique et pas uniquement aux délinquants sexuels ? »
Lundi 19 juin, la Cour suprême a donc statué que les Etats ne pouvaient légalement limiter l’accès aux réseaux sociaux, le cyberespace étant désormais « un espace majeur pour échanger des opinions ».
Cette affaire, une des premières à devoir définir le lien entre la Constitution et l’Internet moderne, pourrait avoir des répercussions à l’avenir. La Caroline de Nord a condamné plusieurs centaines de délinquants sexuels en se basant sur cette interdiction d’accès à toutes les plates-formes sociales. Si la Louisiane est le seul à disposer d’une loi similaire à la Caroline du Nord, de nombreux Etats américains exigent des délinquants sexuels qu’ils fournissent aux autorités des informations sur leur utilisation d’Internet ou à inclure cette dernière comme condition de la libération conditionnelle. Treize Etats ont d’ailleurs apporté leur appui à la Caroline du Nord lors du procès, affirmant qu’il était nécessaire d’empêcher les « prédateurs sexuels » de rassembler des données sur leurs éventuelles victimes.