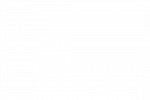« Le bronzage, l’une des révolutions culturelles les plus méconnues »

« Le bronzage, l’une des révolutions culturelles les plus méconnues »
Par Pascal Ory (Historien, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Dans une tribune au « Monde », l’historien Pascal Ory note que la pratique de s’exposer au soleil est née en France durant l’entre-deux-guerres, autour du corps de la femme.
TRIBUNE. Il s’agit de l’une des révolutions culturelles les plus méconnues, l’une des plus triviales aussi, aux yeux des observateurs superficiels : ce violent et rapide changement de repères corporels qu’a représenté pour l’Occident le passage, en moins d’une génération, d’une sensibilité cutanée à une autre, d’une référence pigmentaire à une autre, dénommée « bronzage » – en français puis dans les langues latines, plus esthétiques à cet égard que les anglo-saxonnes, qui nous parlent de « tannage » ou de « brunissement ».
« Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau » avait bien perçu Paul Valéry, qui écrivait cette sentence – très profonde – en 1931, c’est-à-dire, sans le savoir, au cœur même du phénomène.
Chronologiquement, tout s’est déroulé entre la première et la seconde guerre mondiale, comme on le vérifie facilement en se plongeant dans les manuels de soins de beauté, qui passent en trente ans de la phobie du soleil – tâches de rousseur comprises – à son culte exalté. Géographiquement, ça s’est passé en France, pays qui reste encore à l’époque la référence des élites mondiales en matière d’élégance féminine. Et, en effet, symboliquement tout s’est joué autour d’un espace décisif : le corps de la femme.
C’est là que s’est opérée la bascule, perceptible d’abord, dans les années 1920, au travers de la presse féminine des élites (édition française de Vogue), au reste d’abord très prudente, avant de se populariser dans les années 1930 : toute la différence, par exemple, entre les réticences du Petit Écho de la mode, lu par les mamans, et l’enthousiasme de Marie Claire, le nouveau titre de la jeune femme moderne, lue par leurs filles.
Un phénomène radical et rapide
Mais comment expliquer un phénomène si radical et si rapide ? Certainement pas par l’économie : les instituts de beauté, façon Helena Rubinstein ou Elisabeth Arden, sont dépassés par les événements et mettront du temps à se caler sur la nouvelle tendance. Les premiers produits solaires, l’élitiste « Huile de Chaldée » de Jean Patou puis le très répandu « Ambre solaire » d’Eugène Schueller, accompagnent et amplifient un phénomène commencé avant et sans eux.
La clé du mystère n’est pas non plus à chercher du côté d’une avant-garde chic (Coco Chanel) ou, au contraire, d’un vaste mouvement populaire (les « congés payés »). Non, ça se passe là où ça doit se passer : dans les profondeurs de la société, donc de la culture, résultante et cristallisation de trois tendances.
La plus explicite, celle qui prend la parole sur la question, est d’ordre médical. Elle témoigne de l’extension d’une nouvelle conception, « naturiste » de la santé, physique et mentale, de l’être humain, qui chante le sport (Patou est le premier couturier du « sportwear »), les bains de mer (on parlera de « bains de soleil ») et pense découvrir quantité de vertus thérapeutiques – contre la tuberculose, au premier rang – de l’exposition au soleil.
La seconde est proprement sociale : désormais la distinction des élites, soucieuses de prouver leur capacité de loisir (otium) face au commun des mortels, va se faire non plus par rapport au paysan et ses coups de soleil mais par rapport à l’ouvrier et à l’employé, condamnés à la blafardise.
La troisième est, au fond, politique : le bronzage passe par le dévoilement, chaque jour plus étendu, du corps féminin, condamné à la clandestinité par des millénaires de puritanisme. Il est contemporain des cheveux coupés, de la libération du corset et du raccourcissement des jupes.
Aujourd’hui, une juxtaposition de cultures contradictoires
Mais, dira-t-on, où en sommes-nous aujourd’hui, à l’heure de la lutte contre le mélanome, de la remise en cause de l’hégémonie des Blancs – principalement concernés, en apparence, par ce brunissement contrôlé : le Blanc qui se bronze est un « Black » réversible –, à l’heure, aussi, de la querelle du voile et du burkini ? Eh bien, on n’en est pas vraiment sorti, de cette révolution-là.
Il se trouve simplement qu’à partir des années 1970 la totale domination du bronzage a commencé à être contestée par une nouvelle avant-garde punk puis par une nouvelle vulgate sanitaire – qui s’exprimait déjà dans les années 1930 mais que les modernes de l’époque n’écoutaient pas : à chaque époque ses priorités –, redonnant sa place à une tribu des « visages pâles ».
Mais ce n’est plus, en effet, désormais qu’une affaire de tribus. On n’est pas revenu à la situation antérieure à 1914 : là comme ailleurs, la société postmoderne juxtapose des cultures contradictoires, agrégats d’individus eux-mêmes chaque jour plus individualistes.
Et la couverture des magazines, le succès des instituts de bronzage et des plages en ville sont là pour nous rappeler que le hâle a encore de beaux jours devant lui, signe extérieur de santé, donc de beauté, faisant de chacun de ses adeptes une œuvre d’art dorée à la peau comme les objets inertes pouvaient l’être à la feuille.
Pascal Ory est l’auteur de « L’invention du bronzage » (Complexe, 2008).