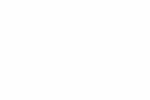Coupe du monde de rugby féminin : les Françaises au stade de la reconnaissance

Coupe du monde de rugby féminin : les Françaises au stade de la reconnaissance
Par Adrien Pécout
Les joueuses du XV de France ouvrent la Coupe du monde 2017 mercredi soir à Dublin, face au Japon. Trois ans après le Mondial à domicile, qui les a fait changer de statut.
Lenaïg Corson lors d’un match du Tournoi des VI Nations face à l’Ecosse, à La Rochelle, 11 février 2017. / XAVIER LEOTY / AFP
Lenaïg Corson s’en étonne encore. « Ah, mais tu joues au rugby, non ? », s’entend-elle parfois demander « dans le train ou à la gare de Rennes, même par une contrôleuse ». La deuxième-ligne du Stade rennais mesure encore aujourd’hui les effets de la Coupe du monde 2014, organisée en France, point de départ de sa nouvelle reconnaissance.
Il y a trois ans, les Bleues finissaient à la troisième place devant leur public. Leur parcours jusqu’en demi-finale, au stade Jean-Bouin (16e arrondissement de Paris), a appris à beaucoup d’amateurs deux choses fondamentales : l’une, que le rugby féminin, ça existe ; l’autre, qu’on peut même prendre du plaisir à en regarder. Des évidences que les joueuses de l’équipe de France entendent bien rappeler lors de l’édition 2017 de la compétition, qu’elles ouvrent mercredi 9 août face aux Japonaises, à Dublin (à 20 h 45).
Cet avant, cet après, toutes celles de 2014 les ont ressentis. Lenaïg Corson a de moins en moins droit aux « réflexions comme “le rugby, c’est pas pour les filles, le rugby, c’est pas pensable qu’une fille puisse y jouer” ». La Bretonne, qui travaille à temps partiel pour le service communication de la GMF, partenaire de la Fédération française de rugby (FFR), est bien placée pour savoir qu’elle et ses coéquipières ont acquis l’image de femmes « sympathiques, naturelles, sans prise de tête, qui apprécient énormément de jouer ensemble ».
Vues à la télé
Didier Retière, directeur technique national chargé du haut niveau à la FFR, évoque aussi un changement dans le « regard des hommes ». « Pour la première fois, les garçons se sont dit : “Ah ouais, c’est intéressant, elles jouent bien au rugby.” Avant, il y avait un regard plus critique : “Elles jouent pas bien, les ballons tombent.” » Les résultats sportifs ont fait le reste : alors que les hommes du XV de France attendent un succès au Tournoi des six nations depuis 2010, les femmes restent sur deux titres en quatre éditions (2014 et 2016). Et sur six demi-finales en sept Coupes du monde, toutes perdues cependant.
Five of the BEST tries from Women's Rugby World Cup
L’évolution de l’image du rugby féminin doit aussi à la fréquence plus élevée des retransmissions, depuis les chiffres d’audience positifs de la Coupe du monde 2014 : au cœur de l’été, la demi-finale perdue de justesse face au Canada avait retenu 2,2 millions de téléspectateurs sur France 4, soit 10,2 % de part d’audience. La bonne affaire pour la chaîne, qui avait payé seulement 100 000 euros pour codiffuser l’événement avec Eurosport.
Les deux mêmes diffuseurs retransmettent la Coupe du monde cet été, et les caméras de télévision se sont aussi posées au bord des terrains du championnat national. En janvier 2015, le stade Aimé-Giral, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), accueillait ainsi un événement inédit : une chaîne de télévision, Eurosport, diffusait une rencontre du Top 8 en direct et en intégralité (Perpignan-Montpellier).
Mixité dans les pôles espoirs
Conséquence logique : le nombre de licenciées est passé de 12 785 en 2014 à un peu plus de 19 100 joueuses en avril 2017, soit 50 % d’augmentation, à contre-courant de la tendance chez les garçons. De nouvelles équipes, voire de nouvelles sections, intégrées ou non à des clubs masculins, ont ainsi pu éclore. « Quand on en croise au stade, à l’entraînement ou sur les réseaux sociaux, il y a des petites qui nous disent : “Je t’ai vue en 2014 !” Maintenant, elles peuvent s’identifier à des filles, ça change tout », estime Safi N’Diaye, joueuse de Montpellier, vainqueur de quatre des cinq derniers championnats de France. La révélation du Mondial 2014 avait commencé le rugby à l’âge de 12 ans, et ses idoles s’appelaient « Serge Betsen, Thierry Dusautoir, Kieran Reid. » Que des hommes.
La troisième-ligne s’y prépare : elle jouera de plus en plus contre des adversaires qui ont « commencé beaucoup plus tôt le rugby ». Lenaïg Corson le confirme : « Dans ma génération, beaucoup ont débuté sur le tard et ont eu la chance de connaître, un ou deux ans après, l’équipe de France. Mais les générations à venir ont un bagage technique énorme, elles ont presque plus joué au rugby que moi alors qu’elles ont 18 ans ! » La Rennaise de 28 ans est en effet venue de l’athlétisme.
Longtemps à la traîne, la FFR a prévu d’accompagner le mouvement. Après avoir attendu 1989 pour reconnaître officiellement la pratique du rugby féminin, et 2001 pour la reconnaissance d’un statut de haut niveau, elle introduira en 2018 la mixité dans tous ses pôles espoirs. Bien que la base de joueuses soit encore « restreinte » (5 % de femmes parmi les licenciés), souligne le DTN Didier Retière.
Les capitaines des douze sélections participant à la Coupe du monde 2017, dont la Française Gaëlle Mignot, posent devant le trophée à Dublin. / PAUL FAITH / AFP
Les pros du rugby à 7
De plus en plus de joueuses bénéficient aussi d’un meilleur aménagement de leurs emplois du temps, à l’image du pilier Lise Arricastre. En 2014, la Béarnaise, peintre dans le bâtiment, avait dû prendre des vacances pour la Coupe du monde. « Quatre-vingt-dix-huit jours de congé sans solde ! », se remémore la joueuse de Lons. Aujourd’hui, elle bénéficie d’une convention d’insertion professionnelle, travaille comme secrétaire pour le comité du Béarn de la FFR et bénéficie d’un maintien de salaire grâce à la fédération. « Ça nous change la vie ! » Le dispositif a été conçu avant l’élection à la présidence de la fédération de Bernard Laporte, peu porté sur le rugby féminin.
Cette saison, la convention permet aussi aux internationales françaises de se libérer pour deux demi-journées d’entraînement supplémentaires par semaine. Le tout avec un préparateur physique détaché, en complément des quatre ou cinq séances hebdomadaires avec leurs clubs. Car la majorité de l’équipe de France travaille ou étudie encore en parallèle du rugby. « Jouer au rugby féminin, faut le vouloir ! », sourit Safi N’Diaye. Educatrice spécialisée à Montpellier, la joueuse apprécie de « penser à autre chose qu’au rugby, de [se] rendre utile ». Mais elle connaît aussi « des filles qui ont dû arrêter prématurément parce qu’elles ne pouvaient plus gérer les deux ».
Depuis 2014, seules les joueuses de l’équipe de France de rugby à sept ont accédé à une vie de sportives professionnelles dans la perspective des Jeux olympiques. Certaines d’entre elles jouent aussi à quinze et participeront donc à ce Mondial irlandais avec des quinzistes au statut toujours amateur. La FFR leur verse un salaire mensuel de 2 000 euros pour s’entraîner en permanence au Centre national du rugby, à Marcoussis (Essonne). Sans commune mesure, cependant, avec le salaire moyen d’un joueur du Top 14 : 18 973 euros brut par mois, selon les estimations de L’Equipe.
D’une équipe de France à l’autre, les primes varient aussi : en 2015, les hommes auraient gagné 180 000 euros par joueur dans l’éventualité — surnaturelle — où ils auraient remporté la Coupe du monde. Cet été, les joueuses se verront verser 16 000 euros si, après avoir surmonté un groupe compliqué (Japon, Australie, Irlande), elles remportent le trophée. Un point commun, toutefois : ni les hommes (depuis 1987) ni les femmes (depuis 1991) n’ont encore remporté le titre mondial et les primes escomptées.