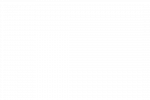Le 9 août 2007, BNP Paribas faisait éclater la crise financière

Le 9 août 2007, BNP Paribas faisait éclater la crise financière
Par Mathilde Damgé
Il y a dix ans, la banque gelait les retraits de ses clients dans trois de ses fonds monétaires et marquait le début de la plus grande crise financière de ce début de XXIe siècle.
Le 9 août 2007, en France, BNP Paribas gèle les retraits de ses clients dans trois de ses fonds d’investissement. / LOIC VENANCE / AFP
C’est un fait qui est souvent ignoré : la plus grande crise financière de ce début de XXIe siècle a commencé le 9 août 2007… en France. Ce jour-là, BNP Paribas gèle les retraits de ses clients dans trois de ses fonds d’investissement. La banque tricolore reconnaît qu’elle ne peut plus valoriser les actifs détenus dans ces fonds, car ils ne sont plus échangeables sur les marchés.
Baudouin Prot, le directeur général de BNP Paribas, avait pourtant assuré, le 1er août, que la liquidité de ses produits (la capacité à être vendus ou achetés) était « totalement assurée ». Mais, une semaine plus tard, les clients (des trésoriers d’entreprise et des grandes fortunes) ne peuvent plus revendre leurs parts et récupérer leur investissement.
Cette décision est rarissime dans le monde de la gestion, car elle envoie un signal désastreux ; confronté à des déboires similaires à la même période, l’assureur Axa avait choisi d’assurer la liquidité de ses fonds en difficulté et de racheter les parts des clients qui souhaitaient vendre. « Nous avons juste été la première banque internationale à dire que le roi était nu », confiait un ancien dirigeant de BNP Paribas au Monde.
Où le grand public découvre les « subprimes »
A l’époque, comme pour Axa, les trois fonds BNP Paribas sont investis en grande partie dans les « subprimes », des produits dérivés de prêts immobiliers à risque américains, dont le grand public ne sait pas encore grand-chose.
Tout commence dans les années 2000 aux Etats-Unis. Des millions de ménages modestes y contractent des emprunts à taux variables (les subprimes), gagés sur la valeur de biens immobiliers, grâce à des sociétés de crédit peu regardantes sur la capacité de ces ménages à rembourser. Lorsque les taux d’intérêt grimpent, ces ménages sont étranglés par les dettes.
Sauf qu’au même moment, les prix de l’immobilier, qui connaissent une véritable bulle, se retournent et les créditeurs ne peuvent plus se rembourser sur la revente des maisons. Et, entre-temps, les subprimes ont été transformés (titrisés) en produits financiers complexes, eux-mêmes rachetés par les banques du monde entier ; le risque se retrouve ainsi disséminé sur l’ensemble de la planète.
Des signes avant-coureurs
En dehors de la décision malheureuse de BNP Paribas de pénaliser ses clients, d’autres signes avant-coureurs peuvent être considérés comme des marqueurs des prémices de cette crise mondiale. En février, la banque HSBC annonce des pertes liées aux subprimes. C’est le premier « profit warning » de son histoire. Les impayés des crédits immobiliers à haut risque amputeraient de 10,5 milliards de dollars ses bénéfices annuels. En avril, son principal concurrent dans le secteur du subprime américain, New Century, se déclare en faillite.
En juin, deux fonds spéculatifs (hedge funds) gérés par la banque Bear Stearns enregistrent de lourdes pertes et doivent fermer. Ces défaillances ont un effet domino, entraînant d’autres plus petits fonds dans leur sillage, faisant craindre des pertes au sein même des établissements les plus solides de Wall Street.
En juillet, deux banques allemandes, IKB et Sachsen LB, frôlent la faillite du fait de leurs investissements aux Etats-Unis. Le gendarme de la Bourse allemande, la BaFin, juge alors que le pays est « menacé de la plus grave crise financière depuis 1931 ». Le 18 août, la banque publique de l’Etat de Saxe fait l’objet d’un plan de sauvetage exceptionnel. Pour éponger ses pertes, une ligne de crédit de 17,3 milliards d’euros lui est accordée – deux fois plus que pour IKB. Sans ces aides, les deux établissements spécialisés dans le financement des petites et moyennes entreprises (PME) auraient mis la clé sous la porte.
Une prise de conscience tardive
En mai 2007, le directeur de la banque centrale américaine, Ben Bernanke, assure que la hausse du taux de défaut sur les remboursements d’emprunts immobiliers ne sera pas préjudiciable à l’économie américaine. Au moment même du premier choc, au début d’août, le président américain George W. Bush estime qu’il y a « assez de liquidités » sur le marché.
Si la prise de conscience a été lente et tardive, les conséquences toutefois ne se font pas fait attendre : un an plus tard, l’un des plus grands établissements de Wall Street fait savoir qu’il est au bord de la faillite. Le 15 septembre 2008, le gouvernement américain laisse la banque Lehman Brothers déposer le bilan, relançant ainsi l’onde de choc des subprimes sur l’économie mondiale. Cette fois, les responsables politiques semblent prendre la mesure de l’événement, Barack Obama évoquant « la crise financière la plus grave depuis la grande dépression [de 1929] ».
Le décrochage des Bourses en 2007 ne se traduit pas immédiatement par une érosion continue des cours, mais en deux ans les places boursières perdent presque la moitié de leur valeur. Elles ne retrouvent leur niveau d’avant-crise qu’à partir de 2012 aux Etats-Unis. Il faudra attendre deux années supplémentaires en France.
La fin de la confiance
Le 9 août, c’est aussi le jour où les banques centrales entrent en scène pour éviter une paralysie générale du marché interbancaire, celui sur lequel les banques se prêtent de l’argent entre elles pour financer leurs opérations au jour le jour, un marché essentiel à l’activité économique. Les banques centrales, qui leur prêtent aussi de l’argent régulièrement sous forme d’enchères sur des montants définis à l’avance, sont cette fois obligées d’ouvrir grand les vannes et de prêter bien plus que d’habitude : en deux jours, environ 290 milliards d’euros de liquidités sont apportés au système bancaire international, un record.
Mais il ne s’agit pas que d’apporter de l’argent, il s’agit de restaurer la confiance, d’abord entre les banques mais aussi avec les investisseurs que sont les entreprises, les fonds de pension ou les nouvelles puissances financières chinoises et russes… Or, la confiance est rompue et ce problème restera entier pendant plusieurs années, personne ne sachant combien les banques ont investi exactement dans les subprimes, et les remèdes des banques centrales (baisses de taux, injections de liquidités, etc.) n’étant que des pansements temporaires.
C’est d’ailleurs ce problème de confiance qui est notamment à l’origine des manipulations frauduleuses du Libor, le taux interbancaire londonien : il s’agissait d’annoncer un taux d’emprunt plus bas que celui des concurrents, car une banque qui reconnaissait qu’elle empruntait (plus) cher (que les autres) risquait d’être immédiatement soupçonnée de fragilité, alors qu’une banque saine devait réussir à emprunter à un taux bon marché.
Cette méfiance quant à la santé du système bancaire se répercutera jusque chez les particuliers, dont certains incitent, en 2010, leurs compatriotes à retirer leur épargne des banques, à l’instar de l’ancien footballeur Eric Cantona. Une initiative qui, si elle avait été suivie, aurait pu provoquer une ruée aux guichets et l’effondrement de plusieurs établissements. C’est ce qui avait conduit au sauvetage de la britannique Northern Rock en septembre 2007 : en pleine crise des subprimes, des rumeurs courent sur son manque de solvabilité. On voit alors les déposants faire la queue pour retirer leurs économies. Le gouvernement est contraint de nationaliser l’établissement pour éviter sa disparition pure et simple.
Les conséquences sur l’économie réelle
En l’espace de quelques mois, la crise dépasse le cadre financier pour toucher l’économie dite « réelle ». La crise des subprimes se mue en crise généralisée du crédit (credit crunch). Tout le système financier commence à se gripper ; les banques ne se prêtent plus entre elles et ne prêtent plus aux entreprises.
Autre conséquence, le repli des investisseurs vers des valeurs considérées moins risquées : les matières premières, dont les cours s’embrasent. En 2008, l’indice FAO (qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de denrées alimentaires) grimpe en un an de 50 %, et même de 87 % pour les céréales, provoquant une vague d’émeutes de la faim.
L’envolée des prix des matières premières affecte directement les industriels et les consommateurs tout en stimulant l’inflation… ou plus exactement la stagflation, combinaison d’inflation et de stagnation de la croissance. Un phénomène apparu dans les années 1970 après le premier choc pétrolier, qui menace à nouveau les économies occidentales.
Des Etats-Unis à la Grèce, l’effet domino
Deux ans après le début de la crise des subprimes, l’onde de choc se propage jusqu’en Europe avec des tensions inédites sur les marchés où se financent les Etats. Certains, comme la Grèce, voient leur prime de risque exploser sur les marchés, la confiance des investisseurs ayant été amoindrie par la révélation des déficits publics du pays.
En 2011, Athènes doit emprunter à 18 %, six fois plus que l’Allemagne. Après de longues tergiversations à Bruxelles et à Francfort, c’est la zone euro qui se porte finalement au secours d’Athènes. Mais le peuple grec paie encore aujourd’hui l’ardoise de la « crise des dettes », plan d’austérité après plan d’austérité.
Au-delà des pays européens qui subissent cette crise du crédit de plein fouet (Grèce mais aussi Portugal, Espagne, Italie, Irlande, etc.), c’est l’ensemble du Vieux Continent qui voit la croissance s’éroder. Quelque 80 % des pays tombent en récession dans l’Union européenne.
Rigueur budgétaire, envolée du chômage de masse, notamment chez les jeunes, alimentent l’euroscepticisme et la déception de nombre d’Européens, qui se tournent dans les années suivantes vers le populisme. Il faudra attendre 2016 pour que la zone euro retrouve durablement son niveau de croissance d’avant la crise.