Henri Seydoux : « Un beau Chéri Samba à 5 000 euros, c’est fini et c’est tant mieux »
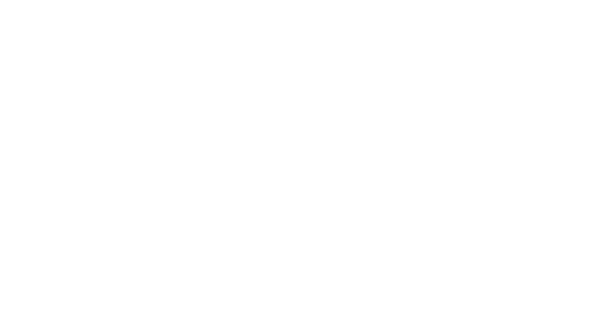
Henri Seydoux : « Un beau Chéri Samba à 5 000 euros, c’est fini et c’est tant mieux »
Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)
Plus connu à travers sa fille – la comédienne Léa Seydoux – et l’entreprise qu’il a fondée – Parrot –, le Français est un grand collectionneur d’art africain.
« J’ai dit oui, mais je suis contre. » Grand gamin de 57 ans au visage poupin et au tutoiement immédiat, Henri Seydoux tient sa tête entre les mains. Avant de lâcher dans un soupir : « Ma femme, Farida, m’a dit qu’il fallait le faire. »
Le PDG du groupe de high-tech Parrot est embarrassé, on est venu percer son intimité. Pas celle qui s’étale dans les journaux people, une généalogie maintes fois rebattue : première femme, Valérie Schlumberger, adepte du commerce équitable ; seconde épouse, Farida Khelfa, égérie du couturier Azzedine Alaïa ; fille comédienne, Léa Seydoux. Les questions personnelles, Henri Seydoux s’en est accommodé.
Il est en revanche un sujet dont il ne parle jamais : sa collection. Peu de gens, si ce n’est ses proches et collaborateurs, le savent : en vingt ans, cet ingénieur à l’air éternellement distrait a acheté une centaine d’œuvres, principalement d’Afrique francophone. La majorité orne les murs du siège social de Parrot, quai de Jemmapes, à Paris : une vingtaine de tableaux de Chéri Samba, des toiles de Moké, de Pierre Bodo et de JP Mika en-veux-tu-en-voilà, des photos de Jean Depara et de J.D. Okhai Ojeikere.
Héritier à la fois d’une lignée d’industriels et banquiers protestants, les Schlumberger, et de nababs du cinéma, les Seydoux, Henri Seydoux s’est taillé un chemin d’entrepreneur à la marge, en concevant des gadgets de luxe pour grands enfants. Sa collection se dérobe tout autant au mainstream.
« Je n’aime pas l’art sophistiqué »
Les raisons de la collectionnite ne sont pas toujours à chercher dans l’atavisme familial ou dans le bagage culturel. Chez Henri Seydoux, il y a un événement fondateur qui le conduit très tôt à se décentrer. Il a 7 ans quand sa tante adopte une enfant haïtienne. « La question de l’autre, du racisme, a été évacuée d’emblée, de la façon la plus facile qui soit », indique-t-il.
Enfant, il était fasciné par les reproductions de nuages dans les tableaux classiques. Mais c’est la culture populaire et la BD qui ont surtout grâce à ses yeux. « Je n’aime pas l’art sophistiqué », confie-t-il. Un temps journaliste au magazine branché Actuel, il découvre Chéri Samba, invité à participer à un numéro spécial sur le regard que portent les Africains noirs sur les Blancs. Sa première femme, qui habitait au Sénégal, l’initie aux stupéfiantes sculptures en terre cuite de Séni Camara.
Vers 1997, par l’entremise du collectionneur Jean Pigozzi, Henri Seydoux rencontre le marchand André Magnin. D’emblée, il lui réclame une toile de Chéri Samba, dont il avait mesuré l’ampleur du travail la même année à l’occasion d’une exposition au Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie (devenu aujourd’hui le Musée national de l’histoire de l’immigration). André Magnin reviendra de Kinshasa avec le portrait d’un cadre africain assis devant son ordinateur, rêvant d’une femme nue.
Henri Seydoux en sourit encore : « Samba ose parler de pollution, de guerre, de politique d’une manière imagée. Il est fort dans la forme et dans le fond, sans être idéologue. » Et d’ajouter : « Les artistes africains ont une facilité pour parler d’eux-mêmes, du monde qui les entoure. L’art africain ne se pose pas la question de l’avant-garde, du devoir d’avant-garde qui taraude l’art contemporain occidental. »
« Collectionner, c’est lutter contre le désespoir »
Depuis ce tout premier achat, Henri Seydoux a recherché « une peinture qui a une présence ». Une peinture optimiste aussi. « Je lutte contre le nihilisme et l’abstraction, les idées noires, les idées toutes faites, dit-il. Collectionner, c’est lutter contre le désespoir. » En cela, il reste dans une vision proche de « Beauté Congo », l’exposition organisée en 2015 par André Magnin à la Fondation Cartier, à Paris.
Il l’admet, il n’a pas bougé son curseur vers les artistes les plus conceptuels du continent. « Je suis sevré de concepts et de courbes toute la journée », balaye-t-il. Sevré, il ne l’est toutefois pas des peintres qui le passionnent. L’évolution de leurs prix n’a d’ailleurs pas freiné son appétit : « Je ne me dis pas : “j’ai acheté des choses à 5 000 euros, je n’achèterai pas à 50 000”. Si j’ai l’argent pour le faire, j’achète. C’est fini un beau Chéri Samba à 5 000 euros, et c’est tant mieux ! »








