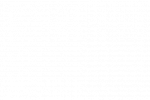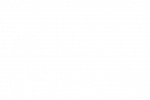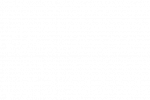A Casablanca, la rue n’a pas dit son dernier mot

A Casablanca, la rue n’a pas dit son dernier mot
Par Ghalia Kadiri
L’Afrique en villes (25). Théâtre, musique, graff… Face à l’urbanisation galopante de la plus grande ville du Maroc, des artistes veulent remettre le citoyen au cœur de l’espace public.
Des créatures affublées d’un nez de clown et vêtues de djellabas poussent des cris d’animaux. Des spectateurs sont invités à les rejoindre. Pas de gradins, pas de scène. Ici, le théâtre se tient hors les murs, à ciel ouvert, en plein centre-ville de Casablanca. Dix comédiens venus du Maroc, du Ghana, du Cameroun et du Nigeria interprètent devant des riverains curieux Le Conte des nez, une pièce de théâtre qui dénonce le racisme contre les migrants subsahariens au Maroc.
Quels que soient les thèmes abordés, la troupe du Théâtre de l’opprimé a toujours le même objectif lorsqu’elle investit la rue : solliciter la contribution des citoyens pour mieux les sensibiliser. « Les Casablancais n’ont plus accès à l’espace urbain, alors on le récupère par les moyens de l’art », résume son créateur, le metteur en scène Hosni Almoukhlis.
Le soir, sur la mythique place des Nations unies enracinée au cœur de la cité, acteurs de rue côtoient circassiens, musiciens et danseurs. Dans une ville où l’espace public est une denrée rare, ils se réunissent ici pour offrir des spectacles participatifs et rendre son éclat à la rue, trop longtemps abandonnée.
En vingt ans, Casablanca, cœur palpitant de l’économie marocaine, s’est développée à grande vitesse. Trop vite peut-être. « Dans le chaos », estiment certains. Avec ses 4 millions d’habitants, c’est aussi la ville la plus peuplée du pays, où se crée un cinquième de la richesse nationale. « Casa la blanche », qui fut durant le protectorat français le terrain d’expérimentation d’une génération d’architectes issus des Beaux-Arts de Paris, ne cesse de changer. On y construit sans scrupule, parfois aux dépens de son héritage architectural et de ses espaces publics.
« Sortir l’art des salons »
Mais la rue n’a pas dit son dernier mot. Depuis quelques années, les initiatives créatives et engagées se multiplient. Des jeunes désireux de réoccuper l’espace urbain tentent de penser la ville comme une œuvre collective et de s’y faire une place. A commencer par le street-art. Partout dans Casablanca, des tâches de couleur embellissent les immeubles. Pour interpeller les passants, les graffeurs font des clins d’œil à la vie casaouie, dessinant avec humour des paraboles ou des vêtements accrochés aux fenêtres de la médina. « Maintenant, les murs racontent notre histoire », sourit un vieillard adossé à une façade taguée.
« En faisant de l’art dans la rue, on dit aux gens : vous n’avez pas accès à l’art, vous n’êtes pas intéressés par l’art ? Alors l’art vient à vous ! », explique Hosni Almoukhlis, qui a fondé le Théâtre de l’opprimé en 2012. Issu du Mouvement du 20 février, un collectif né en 2011 lors des printemps arabes, M. Almoukhlis a choisi le théâtre pour « sortir l’art des salons élitistes » et le rendre à la société civile. « C’est un outil efficace du changement !, insiste-t-il. La culture est très importante pour construire une nouvelle société. Nous avons besoin d’un champ pour défendre les valeurs modernes et la démocratie. Ce champ, c’est la rue. » Six ans après les manifestations du 20 février, l’art se veut un moteur du changement.
Inspiré de la halqa, une forme très ancienne de théâtre qui se joue en plein air au Maroc depuis des siècles, le Théâtre de l’opprimé est basé à l’Uzine, nouveau lieu de culture et de création situé en périphérie de Casablanca. Comme l’Uzine, de nombreux espaces d’expression culturels ont vu le jour, à l’instar de l’Atelier de l’observatoire, qui met gratuitement à disposition des artistes un espace équipé pour la création et la production d’œuvres. Ces lieux illustrent le bouillonnement de la ville et sa jeunesse, avec toujours ce mot d’ordre : « La culture, c’est la solution. »
« Armer le citoyen »
Le plus emblématique d’entre eux est niché dans un endroit surprenant : les anciens abattoirs de Casablanca. Dans le quartier populaire de Hay Mohammadi, zone industrielle mais aussi lieu de pèlerinage pour les amoureux d’architecture, cette friche fermée en 2002 s’est transformée en fabrique culturelle, il y a près de huit ans, sous l’impulsion d’un collectif d’associations et d’opérateurs culturels. A l’intérieur du bâtiment désaffecté, toujours équipé de ses machines d’abattage, l’art est partout, toutes disciplines confondues.
Mais il y a un an, un événement a mis fin à cette effervescence culturelle. Le bâtiment, dont la gestion avait été donnée à l’association Casamémoire, qui lutte pour la préservation du patrimoine architectural de Casablanca, a été repris par la commune urbaine en juillet 2016. Depuis, les activités culturelles ont été interrompues et les artistes contraints de quitter les lieux. Seul le Théâtre nomade, une compagnie itinérante dont la vocation est de déplacer l’art vivant auprès des gens, a pu y laisser son camion.
« Ils veulent transformer ce lieu de culture en projet immobilier, car il est proche de la future gare TGV. C’est un lieu stratégique, indique Aadel Essaadani, cofondateur de l’association Racines. Ils le laissent tomber en ruines pour justifier ensuite sa destruction. » Créée en 2010 par deux acteurs de la scène culturelle casablancaise, Racines veut promouvoir les industries créatives. « Si on ne le fait pas, qui va le faire ? », s’interroge sa cofondatrice, Dounia Benslimane. « Regardez l’état des infrastructures culturelles !, renchérit Aadel Essaadani. L’idée est de libérer l’espace public et d’armer le citoyen. »
« Le PJD n’en veut pas »
Dans un pays qui se veut moderne mais dont le gouvernement, dirigé par un parti islamiste (le Parti de la justice et du développement, PJD), ne met pas l’accent sur la culture, les artistes peinent à exister. A chaque représentation, la loi marocaine impose aux artistes de rue d’obtenir une autorisation auprès de la préfecture. Les délais de réponse sont longs et dépassent parfois la date du spectacle. « Nous avons fait une pétition pour qu’il n’y ait pas de distinguo dans la loi entre les manifestations politiques et artistiques. Au Maroc, on oppose traditionnellement culture et politique. La liberté de création, le PJD n’en veut pas », déplore M. Essaadani.
Depuis 2013, le nouveau plan d’aménagement de Casablanca a doté la ville de sociétés de développement local (SDL) destinées à déléguer les services publics aux entreprises pour plus d’efficacité. Casa Events, la SDL chargée des événements culturels, a lancé plusieurs initiatives, dont le Festival de Casablanca cet été. Mais les associations regrettent des décisions prises sans l’aval de la population. « La gestion déléguée est supposée revenir aux élus, mais comme ils font mal leur travail, ils ont créé ces SDL, désespère M. Essaadani. Nous voyons la ville comme une ville collective : tout le monde doit participer. Il faut que Casablanca ait une vraie politique culturelle, pas seulement ponctuelle. »
Si les Casablancais ont affirmé leur volonté de se réconcilier avec la ville, des blocages persistent du côté des institutions. En mars 2017, la wilaya de Casablanca a décidé d’interdire les musiciens sur la place des Nations unies. Pour récupérer leur matériel confisqué, les artistes ont été forcés de signer une décharge dans laquelle ils s’engageaient à ne plus revenir. C’est pourtant ici que tout a commencé, place des Nations unies, rebaptisée place Maréchal. Longtemps boudée par les habitants, elle s’est métamorphosée avec l’arrivée du tramway en 2012, qui a rendu le quartier aux piétons, et grâce au travail de préservation du patrimoine initié par Casamémoire.
Pour protester contre l’interdiction des musiciens et retrouver leur « droit à la ville », les citoyens ont organisé un sit-in quelques jours après leur départ. Les artistes sont revenus. La rue a gagné sa première bataille.
Le sommaire de notre série « L’Afrique en villes »
Cet été, Le Monde Afrique propose une série de reportages dans seize villes, de Kinshasa jusqu’à Tanger.