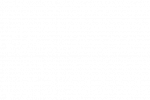Cameroun : à Bamenda, ville morte et rentrée « fantôme » pour les élèves

Cameroun : à Bamenda, ville morte et rentrée « fantôme » pour les élèves
Par Josiane Kouagheu (Bamenda, envoyée spéciale)
Malgré le geste d’apaisement de Yaoundé qui a annoncé libérer plus de 50 leaders anglophones emprisonnés, les familles n’ont pas retrouvé la confiance.
A l’école catholique Saint-Joseph de Mankon, l’inspecteur de l’éducation de base demande aux deux garçons d’aller se changer pour porter leur uniforme scolaire. / Josiane Kouagheu
Sur le tableau noir, le dernier cours de mathématiques date du 18 novembre 2016. Dans la salle nettoyée « avec amour » et aux tables-bancs parfaitement alignés, il n’y a aucun élève. A l’école catholique Saint-Joseph de Mankon, l’une des plus prestigieuses et anciennes écoles de Bamenda, les enseignantes, maquillées avec soin, ont revêtu leurs plus beaux vêtements pour accueillir les élèves pour cette rentrée scolaire 2017-2018. « Il n’y a encore personne. Nous avons pourtant organisé plus de trois réunions de sensibilisation avec les parents et je pensais qu’ils avaient compris », explique avec peine, Monica Shiri Chi, la directrice.
Dans la cour de cette école primaire ouverte depuis 1935, deux petits garçons, tongs aux pieds, courent dans tous les sens, indifférents aux appels de Monica Shiri qui les supplie d’aller revêtir leur tenue de classe afin d’« apprendre pour devenir de grands hommes ». Des femmes, venues voir si l’école « est vraiment ouverte », repartent peu convaincues. « Je ne crois pas que je pourrai scolariser mon enfant. On ne sait pas encore ce qui va se passer », avoue l’une d’elles.
Enlisement de la crise
Au Cameroun, ce 4 septembre sonnait le retour des classes après les grandes vacances sur l’ensemble du territoire national. Mais, au Sud-Ouest et Nord-Ouest du pays, deux régions anglophones qui représentent 20 % de la population, cette rentrée tombait mal : un lundi, journée décrétée « ville morte » quasiment depuis le début de la crise, fin 2016. Au mois d’octobre, les avocats anglophones étaient descendus dans la rue pour exiger l’application du Common Law – système judiciaire hérité de la colonisation anglaise – et pour s’insurger contre l’affectation des magistrats francophones ne maîtrisant pas l’anglais dans leurs régions.
Un mois plus tard, c’était au tour des habitants qui profitaient d’une grève des enseignants pour dénoncer la discrimination dont ils se disent victimes et « la francophonisation » du sous-système éducatif anglophone. Au fil des mois et de l’enlisement de la crise, les plus modérés ont fini par réclamer un retour au fédéralisme – en vigueur jusqu’en 1972 – et les plus radicaux, l’indépendance. En janvier, en guise de représailles, Yaoundé avait coupé Internet durant trois mois dans la partie anglophone. Des leaders de la contestation avaient été arrêtés dans la foulée et poursuivis, entre autres, pour « actes terroristes ». Ils risquaient la peine de mort.
Mais, à Bamenda, épicentre de la contestation, les habitants n’ont jamais faibli : les journées « ville morte » se sont multipliées et même institutionnalisées, et les élèves ont peu à peu oublié le chemin des classes. L’année scolaire 2016-2017 a été un échec dans la partie anglophone. « Ils ont cru que nous luttions pour rien, s’énerve Peter*, père de cinq enfants, habitant le centre-ville et fonctionnaire à la retraite. Notre combat est très légitime et c’est pour nos enfants que nous le menons, pour qu’ils aient un avenir meilleur. En 2017, il ne faut pas se tromper, ceux qui parlent de rentrée ici parlent d’une rentrée fantôme. »
Face à tant de résistance, le président de la République, Paul Biya, a fini par signer, jeudi 31 août, un décret ordonnant l’arrêt des poursuites judiciaires contre trois leaders anglophones emprisonnés, Nkongho Agbor Félix, Fontem Aforteka’a Neba, responsables du consortium Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (Cacsc), Paul Ayah Abine et plus de 50 personnes arrêtées durant la crise.
« Libérez Mancho et on verra ! »
Libérés à trois jours de la reprise des classes, ces leaders du Cacsc ont « plaidé pour une rentrée normale et pacifique », à travers un communiqué signé par leurs avocats. « Ils nous ont trahis ! Ce sont des traîtres car, où est passé Mancho Bibixy ? C’est lui qui a porté aussi haut notre combat. Paul Biya l’a laissé en prison en pensant que nous allions écouter les autres ? Il se trompe. Nos enfants n’iront pas à l’école », poursuit Peter. Mancho Bibxy, alias « BBC », journaliste radio très écouté, avait fini par engager sa voix pour dénoncer l’attitude de Yaoundé dans la crise. Il est emprisonné depuis janvier.
Pour Anny, garder Mancho en prison est le « signe que le gouvernement s’en fout des anglophones ». Pour cette vendeuse ambulante de bananes et d’aubergines, « BBC » devait être le premier « prisonnier libre ». Mère de deux enfants, inscrits respectivement en 2016 en première et 4e, cette femme de 43 ans a décidé de les laisser « cette année encore » à la maison, comme les « autres », « tant qu’ils ne seront pas entendus ». « Libérez Mancho et on verra ! », crie-t-elle, sous le regard amusé de deux mécaniciens occupés à réparer un bus en panne dans une agence de voyages.
Dans les rues désertées de la capitale régionale du Nord-Ouest, les boutiques, banques, stations-service, agences de voyages, marchés… sont fermés. Dans les quartiers, les enfants, accompagnés de leurs parents, vont au champ, machettes à la main. Ou jouent sur un terrain vague en poussant des cris de joie. L’école semble loin d’eux.
Pour les convaincre, la ministre de l’éducation a fait le déplacement à Bamenda, vantant la valeur de l’éducation. Plus de 1 000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés pour protéger les élèves des « protestataires violents ». Rien n’y fait. « L’éducation est actuellement la chose la plus importante dans la vie d’un enfant, assure Paul Foncham, inspecteur de l’éducation de Bamenda II. Cette importance va au-delà des problèmes politiques. Le président de la République a déjà libéré des leaders, ce qui prouve qu’il prend très à cœur ce problème. » Jusqu’à aujourd’hui, seule une vingtaine des libérations promises est effective.
Au lycée bilingue Down-Town où a lieu la cérémonie de lancement de cette rentrée scolaire dans la région, des policiers et vigiles font la ronde. Le proviseur, George Nditafon, drapé dans un boubou traditionnel, a le sourire aux lèvres. « La rentrée se passe très bien ici, dit-il. Les enseignants sont là et les élèves aussi. » Combien ? « Plus de 100 », lâche-t-il évasif.
Au lycée bilingue Down-Town, une classe de troisième francophone. Seuls une centaine d’élèves ont fait leur rentrée le 4 septembre 2017 dans cet établissement qui accueille d’ordinaire plus de 1000 élèves. / Josiane Kouagheu
Pourtant, la capacité d’accueil de l’établissement dépasse les 1 000 élèves. D’ailleurs, interdiction de faire des photos des salles de classe. En 4e, seuls deux élèves sont présents face à une enseignante visiblement gênée par la situation. Une dizaine en 2de et en 3e. La plupart parlent français et ne portent pas d’uniforme scolaire.
Risque de fermeture
« Le même scénario se poursuit. Les élèves anglophones sont chez eux et les francophones viennent en civil de peur de représailles dans les quartiers », regrette un enseignant rencontré à l’entrée du lycée bilingue de Bamenda. Là aussi, les salles de classe sont vides. Le vigile interdit toute prise de photo sans l’accord de « Madame la Proviseure » qui « s’est déplacée ».
A l’école catholique Saint-Joseph de Mankon, trois élèves vêtus de leur uniforme scolaire ont finalement fait leur entrée dans l’enceinte de l’établissement. Insuffisant pour rassurer les enseignantes qui cumulent plus de sept mois d’arriérés de salaires. « L’année dernière, on a arrêté les cours en novembre et il n’y avait plus d’argent pour nous payer, s’alarme Juliette, enseignante maternelle et mère de trois enfants. Si ça continue, on va fermer l’école et nous serons vraiment au chômage. » Une crainte partagée par de nombreux enseignants et responsables d’établissements privés de la partie anglophone.
Faut-il alors reprendre le chemin de l’école ? « Je ne pense pas. Le gouvernement n’a même pas présenté un signe d’apaisement car, croyez-moi, cette liberté des leaders est un piège », affirme un journaliste d’une radio privée. Pourquoi ? « Les routes de Bamenda sont toujours en très mauvais état, rien n’a changé, dit-il. Les leaders avaient donc raison. »
*Le prénom de Peter a été changé car il est non seulement ancien fonctionnaire, mais aussi notable dans l’un des villages de Bamenda.