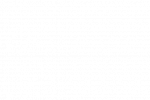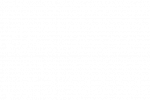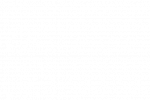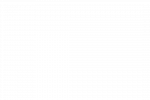Maintenir le contact avec la Turquie, malgré Erdogan

Maintenir le contact avec la Turquie, malgré Erdogan
Editorial. L’UE doit passer outre les insultes et les provocations du président turc à son égard pour garder des liens avec une puissance économique et démographique incontournable aux portes du Vieux Continent.
Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le président turc Recep Tayyip Erdogan, à Ankara le 14 septembre. / AP
Editorial du « Monde ». Dans leurs relations avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, les Européens font face à cette impitoyable réalité : le président turc est incontournable. C’est l’une des figures imposées de la vie diplomatique que de devoir traiter avec des personnalités qui disent ouvertement tout le mal qu’elles pensent de vous, affichent leur mépris à votre égard et cherchent, quand elles le peuvent, à vous porter tort.
Et telle est, grosso modo, l’attitude du président Erdogan vis-à-vis de ses homologues de l’Union européenne (UE). Le président de la commission de Bruxelles, Jean-Claude Juncker, rappelait, mercredi 13 septembre, qu’il arrive au numéro un turc de parler de « fascisme » ou de « nazisme » pour commenter certaines décisions des dirigeants de l’Union.
Ce sont évidemment des qualificatifs qui n’incitent guère à entretenir un dialogue chaleureux avec Ankara. M. Juncker relevait encore que la justice turque n’avait rien de plus urgent à faire que d’embastiller et de dresser des procès à l’encontre d’un journaliste français, Loup Bureau, et d’un de ses collègues turco-allemand, Deniz Yücel, correspondant de Die Welt.
Ce dernier est emprisonné depuis le 14 février 2017. Quant à Loup Bureau, dont le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a évoqué, jeudi à Ankara, la situation, il est détenu depuis plus d’un mois. Professionnels consciencieux, les deux hommes sont avant tout victimes de la dégradation constante des relations entre la Turquie et l’UE.
Depuis le putsch raté du 15 juillet 2016, la Turquie vit au rythme d’une répression qui a pris des allures de vengeance personnelle de la part du président Erdogan. A juste titre, l’UE a dénoncé l’érosion constante de l’Etat de droit en Turquie et une répression tous azimuts dont l’objet paraît souvent être de museler toute opposition à l’émergence du pouvoir autocratique de M. Erdogan.
Un pays clé
Quel que soit l’état des négociations sur l’adhésion de la Turquie à l’UE, et l’hypocrisie de nombre d’Européens à ce sujet, c’est d’abord le président turc qui s’éloigne de l’Europe. C’est lui qui revient sur les avancées démocratiques de ces dernières années ; lui encore qui tire son pays loin des normes libérales des sociétés occidentales ; lui toujours qui, membre de l’OTAN, entend acheter des armes à la Russie.
Le choix de tourner le dos à l’UE est celui d’Ankara, pas celui de Bruxelles. Pour autant, l’Europe ne peut pas se couper de la Turquie. Puissance économique et démographique aux portes du Vieux Continent, elle doit être un partenaire. Elle l’est dans la gestion des flux migratoires. Elle compte dans l’immense chantier à entreprendre, ensemble, pour apaiser la tourmente moyen-orientale. Elle est un pays clé dans la relation complexe qui se noue entre l’UE et la Russie, d’une part, l’UE et l’Iran, de l’autre. Faut-il le dire aussi ? Elle compte par la richesse de sa culture, l’infinie beauté du pays et la merveilleuse complexité de l’identité turque.
Enfin, il faut penser à ces quelque 50 % de Turcs – ceux d’Ankara et d’Istanbul, notamment – qui ont refusé de signer un chèque en blanc à M. Erdogan lors du référendum d’août. Quand le président manie l’insulte et la provocation à l’adresse de l’UE, c’est peut-être plus un signe de faiblesse que d’autre chose. Bref, tout impose de passer outre à la personnalité d’un homme et de maintenir le contact avec les Turcs. L’exercice requiert de la patience, et celle-ci s’apprend en contemplant le Bosphore à la tombée de la nuit.